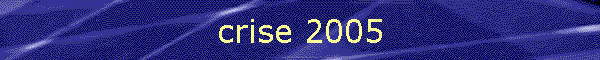
|
|
|
|
Banlieues : comment éteindre le feu ?
Sonia Imloul "... Nous sommes assignés à résidence, c'est-à-dire que nous avons très peu de chance de pouvoir prétendre à un avenir meilleur..." Jean-Luc Garnier
"... La stigmatiqation d'un tel, d'un ministre ou d'un autre, dans cette affaire ne va que attiser la flambée de violence..."
Patrick Braouezec
"... Qu'est-ce qui fonctionnait avant ? L'ascensseur social. Au-délà des mots, qui ne sont pas neutres, il y a une responsabilité gouvernementale..
Yves Jego "... Le ministre de l'Intérieur, c'est un homme de convictions (...) Il pense que dans ce pays, on a trop d'hommes politiques qui ne pensent rien..."
http://www.france5.fr/ripostes/D00069/110/129843.cfm
Banlieues : miroir des peurs françaises ?
Djida Tazdaït "Il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilité, au lieu de compter les points..."
Alain Finkielkraut
"C'est une véritable OPA que de parler de la population de ces quartiers..."
Alain Finkielkraut et Djida Tazdaït "... La discrimination à l'embauche doit être combattue sans relâche, et je pense que l'on ne peut pas dire que rien ne sait fait..."
Hamida Ben Sadia "... Je pense que ce qui se passe là est de l'ordre (...) des jacqueries du XXIe siècle..."
http://www.france5.fr/ripostes/D00069/111/130042.cfm
Crise dans les banlieues : la réponse politique est-elle à la hauteur ? LEMONDE.FR | 09.11.05 | 09h15 • Mis à jour le 10.11.05 | 20h38
Aurélie : Que pensez-vous de la violence urbaine actuelle ? Y a-t-il des causes qui justifient cette violence urbaine, selon vous ? Patrick Braouezec : Je serais tenté de dire que rien ne justifie ces violences et notamment les conséquences de celles-ci. Mais beaucoup de choses les expliquent. Ces violences sont comme d'autres symptômes moins médiatiques et moins dramatiques – je pense à l'abstention lors des scrutins électoraux, au rejet des politiques –, des symptômes d'une crise de société qui n'est pas spécifique aux banlieues dont on parle, mais qui est une crise plus globale qui prend, y compris d'autres formes, dans le milieu rural par exemple. Si l'on ne fait que constater ces violences et qu'on n'analyse pas en profondeur les causes qui les provoquent, on aura beau mettre un couvercle sur la marmite, à la prochaine étincelle, la marmite débordera de nouveau. "NO FUTURE" Bekir192005 : Quelles sont les causes de cette "révolution" selon vous ? Seulement une inégalité entre couches sociales ? Patrick Braouezec : C'est une part des raisons. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes et flagrantes. Ce sont à la fois des inégalités sociales, de traitement territorial. Ce n'est pas la seule raison, quoique les discriminations que subissent aujourd'hui un certain nombre de jeunes – discrimination au logement, à l'embauche, aux stages, à l'accès à des endroits publics ou privés – ajoutent des éléments de révolte aux inégalités sociales premières. Et j'ajouterai que l'une des raisons est aussi sans doute ce "no future" que ressentent beaucoup de gens, et pas que des jeunes. Aujourd'hui, dans notre société, il n'y a plus de projet politique porteur qui permette à chacun de se projeter dans l'avenir. Bas-de-casse : On parle d'un "plan banlieue". Pensez-vous que la question des banlieues puisse être isolée et traitée à part dans le cadre d'un projet politique alternatif ? Patrick Braouezec : Non, il ne peut pas être traité à part. Mais je crois que c'est à partir de ce projet, non pas pour les banlieues, mais pour les quartiers populaires, que l'on peut justement nourrir un projet politique alternatif. Quand nous réclamons un Grenelle des quartiers populaires, ce n'est pas pour avoir un énième plan pour les banlieues, mais bien pour faire valoir que c'est de ces quartiers populaires, de ce qui en émerge, qu'on construira une société du vivre-ensemble qui concernera l'ensemble de la société française. De fait, c'est des quartiers populaires, à partir d'eux, que l'on peut construire une alternative politique. Socebe : Banlieues en crise, dit-on. La crise sociale est évidente, mais les émeutes ne sont-elles pas aussi et surtout le résultat d'une crise politique, d'une défiance profonde à l'égard des "élites" ? Patrick Braouezec : J'ai déjà en partie répondu précédemment. A mes yeux, il n'y a pas de crise de banlieue, il y a une crise de l'Etat, une crise de société, dont les banlieues ne sont finalement que le révélateur. Et pour cause, puisque c'est dans ces quartiers que sont vécues les conséquences directes de cette crise de l'Etat et de la crise de société. Mais de manière plus profonde, c'est à une mutation de société que l'on est confronté. La crise étant cette période incertaine qui nous fait passer d'un Etat clos, d'un monde clos, à un monde à construire, mais dont on a beaucoup de mal à dessiner les formes. Leo : Vous parlez de "no future", quel futur peut à court et moyen termes offrir la société à ces jeunes. Cela passe-t-il d'abord par des mesures économiques et sociales ou par un discours différent sur les banlieues ? Patrick Braouezec : Je pense d'abord qu'on n'a pas à offrir quelque chose. On a à écouter, on a à prendre en compte un certain nombre d'exigences qui émaneront justement de ces quartiers populaires. Et d'après les premiers retours que l'on a aujourd'hui de rencontres avec les gens de ces quartiers populaires, il y a diverses exigences : d'abord, effectivement, un autre traitement de la question des moyens, des réponses en termes d'emplois, de formation, de logement ; mais aussi l'exigence d'un autre regard et de considérer que les gens qui vivent dans les quartiers populaires méritent autant de respect, de considération que ceux qui vivent dans des quartiers plus riches. Harry : Comment, maintenant et dans l'urgence, entrer en contact avec ces jeunes qui vivent dans leur monde régi par leurs codes, qui ne croient plus à la sincérité des élus de notre société ? Comment le faire alors que toutes les médiations (associatives par exemple) ont été cassées par le manque de crédits ? Patrick Braouezec : D'abord, tous les ressorts ne sont pas cassés. Pour avoir réuni, dimanche midi, le tissu associatif de la communauté d'agglomérations que je préside, le lien entre le monde politique, le tissu associatif et ces jeunes qui ne se reconnaissent pas dans n'importe quel collectif n'est pas complètement rompu. La preuve en est que depuis dimanche, le retour au calme se fait, sans doute grâce à cette action concertée des élus locaux et des citoyens adultes associatifs. Reste que le discrédit du monde politique est une réalité, qu'il faut reconstruire une relation de confiance, que celle-ci ne peut pas se faire sur la base de propos soit démagogiques ou, à l'inverse, de seuls propos de fermeté. Les jeunes, comme l'ensemble des gens qui vivent dans ces quartiers populaires, sont conscients que l'on ne fera pas tout du jour au lendemain, mais que des engagements doivent être pris et que l'on doit se donner les moyens d'un vrai contrôle par les citoyens du respect de ces engagements. Belineo : Que pensez-vous de l'apprentissage dès 14 ans ? Patrick Braouezec : C'est une remise en cause larvée de l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans. Si l'intention du premier ministre avait été de rapprocher le monde enseignant, éducatif du monde du travail et de permettre à des jeunes de s'orienter vers des filières d'apprentissage ou des filières techniques en toute connaissance de cause, il aurait fallu faire en sorte que la réalité de l'entreprise soit connue par l'ensemble des élèves des collèges. Les mots qu'a prononcés le premier ministre sont graves, il a parlé de "doués" et de "non doués" et de fait, il crée de nouveau une ségrégation supplémentaire. Benoit : Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensiez de la réponse qui a été donnée avant la crise par M. Borloo concernant la restructuration et la reconstruction de logements sociaux ? N'était-ce pas une mesure, colossale en termes financiers, répondant finalement assez bien à la demande actuelle des personnes en difficulté en banlieue ? Patrick Braouezec : La réponse apportée par Jean-Louis Borloo avant cette période de troubles consistait à restructurer un grand nombre de quartiers dits en difficulté. Personne ne nie la nécessité de cette restructuration. Personne ne nie qu'il faille démolir, réhabiliter un certain nombre de logements. Mais par contre, sous-jacente à ce projet, il reste une certaine stigmatisation du logement social et des quartiers à dominante de logement social. Le constat que l'on peut faire, c'est que certains élus locaux ont profité de l'aubaine pour tenter de diminuer le nombre de logements sociaux. Dans la phase de réalisation de ce projet Borloo, on constate aujourd'hui plus de démolitions que de constructions, ce qui tend à ajouter encore plus de difficultés dans les quartiers concernés. LE PLAN VILLEPIN "DRAMATISE LA SITUATION RÉELLE" Syb : Que pensez-vous du volet répressif du plan Villepin ? Patrick Braouezec : Il conduit à mes yeux d'abord à dramatiser la situation réelle. Nous ne sommes pas en état de guerre. Il est vrai que pour ceux qui ne vivent pas dans les villes concernées par ces troubles, l'image des médias tend à montrer qu'on serait dans une sorte de guerre permanente. Alors que la réalité n'est pas celle-là. Je crains que cela soit plus d'ailleurs de l'effet d'annonce – je pense notamment à l'état d'urgence et au couvre-feu – parce que je doute qu'on puisse réellement mettre en pratique de telles mesures et je note au passage que ces deux mesures n'ont été appliquées que dans des périodes sombres de notre histoire et visant les populations étrangères ou d'origine étrangère. Je ne voudrais pas que les jeunes qui se sentiraient concernés par ces mesures se rappellent que ce sont des mesures qui avaient été prises à l'encontre de leurs pères ou de leurs grands-pères. Agathe : Faut-il faire le lien entre les affrontements entre les "jeunes" et l'immigration ? Patrick Braouezec : Il est difficile de ne pas le faire, puisque bon nombre de ces jeunes sont issus de l'immigration. Mais il faut le constater avec le regret de voir que nous n'avons pas su faire en sorte que ces jeunes se sentent partie prenante d'un corps social, d'une unité nationale. La question qui est donc posée à l'ensemble des politiques, c'est de tordre le cou à tous les racismes, à toutes les discriminations et à toutes les ségrégations. Riri16 : Que penser d'un gouvenement qui abrite en son sein un pompier pyromane, en l'occurrence M. Sarkozy ? Patrick Braouezec : Le problème est de savoir si le pompier pyromane est seul dans la caserne ou bien si c'est une grande partie de la caserne qui laisse faire le pompier pyromane... L'intervention de M. de Villepin à la télévision avant-hier soir était – tout écart de langage excepté – du même ordre que celles du ministre de l'intérieur. Pour ma part, je ne crois pas que ce dernier ait utilisé les mots provocateurs sans y avoir réfléchi. Et sans avoir quelque part pensé qu'il pouvait être soutenu par une majorité de ce gouvernement. Je crains qu'on ait un gouvernement qui ne mesure pas la souffrance dans laquelle se trouvent aujourd'hui une majorité de gens qui vivent dans ces quartiers populaires. Claivoyant : Bonjour ! Vos propositions pour tordre le cou aux "préjugés raciaux", M. le député ? Patrick Braouezec : Ça ne se décrète pas, de mettre à mal les préjugés raciaux ou socio-économiques. Il y a un certain nombre de responsables, à la fois politiques, syndicaux, économiques, et je place au centre de ceux-ci les chefs d'entreprise, qui doivent modifier du tout au tout leur comportement, leur regard, leurs propos vis-à-vis de ceux qui sont différents, quelles que soient d'ailleurs leurs différences. De fait, il y a dans ces quartiers populaires des ressources inexploitées sur le plan humain, des ressources d'imagination, d'innovation, des ressources de solidarité, qui en surprendraient plus d'un dans les quartiers bourgeois. Benjamim : Nous avons des alertes de "ras-le-bol" des banlieues depuis plus de vingt-cinq ans. Comment se fait-il que si peu de partis politiques et de conseil municipaux, de gauche ou de droite d'ailleurs, aient intégré des personnes issues de l'immigration ? Patrick Braouezec : Je pense qu'il y a un décalage très important entre la diversité de la vie, de la société, et la représentation politique, mais aussi économique, et aussi des autres pouvoirs – je pense notamment au pouvoir médiatique –, et qu'il est effectivement de notre fait de réduire ce décalage. La crise des partis politiques explique en grande partie aussi cet écart. Peu de partis politiques aujourd'hui sont composés de jeunes, et encore moins de jeunes issus de l'immigration. Et comme ce sont les partis politiques qui font la représentation au sein des Assemblées, il n'est pas étonnant que ce décalage s'accroisse. Jmle93 : Seriez-vous prêt à vous associer à d'autres maires (quelle que soit leur couleur politique) de communes abritant des quartiers "sensibles", et ce, afin de trouver quelques solutions concrètes ? Jeanne: Serait-il possible de mettre en place une assemblée, puisqu'on parle d'état d'urgence..., des états généraux des banlieues ? Patrick Braouezec : C'est la proposition que j'ai faite lors de la conférence de presse de dimanche dernier, et la proposition que nous allons émettre à l'ensemble des maires des grandes villes de France, quelle que soit leur couleur politique. L'idée étant que l'on puisse recenser, dans chacune des villes, des revendications, des exigences, des souhaits, des rêves, et que l'on aille, si bien sûr la réponse était partagée, à des états généraux non pas des banlieues, j'insiste, mais des quartiers populaires. Pau, Rennes, Toulouse, ce ne sont pas des banlieues, ce sont des villes qui en leur sein ont des quartiers populaires où les gens vivent des difficultés. Et c'est bien à partir de ces quartiers populaires, de leurs exigences que l'on construira la société de demain. Et cette société concernera tout le monde. Zbil : Ces violences sont-elles un mal pour un bien, selon vous ? Patrick Braouezec : Il est toujours difficile de dire que ce qui s'est passé est un mal pour un bien. Les familles des quatre personnes qui ont péri durant cette période, les personnes qui ont perdu un bien, une voiture, des équipements publics, montrent qu'il est difficile de dire cela. Par contre, si l'on veut justement que tout cela ne se soit pas passé pour rien, que ces quatre personnes ne soient pas mortes pour rien, il faut sans doute faire un effort d'analyse, de compréhension de ce qui s'est passé et de recherche de solutions qui ne soient pas un énième plan d'urgence, mais qui posent bien la place centrale que doivent jouer les quartiers populaires dans le devenir de notre société. Chat modéré par Constance Baudry et Pierre Rubenach
Violences urbaines : apaisement ou crise durable ? LEMONDE.FR | 10.11.05 | 10h34 • Mis à jour le 10.11.05 | 18h10 L'intégralité du débat avec Manuel Valls, député (PS) et maire d'Evry (Essonne), auteur de "La Laïcité en face" (éd. Desclée de Brouwer), jeudi 10 novembre 2005.
Rayan : L'expulsion des étrangers en situation régulière ou le couvre-feu et la mise en place de l'état d'urgence dans un moment de décrue de la crise sont-ils les mesures que l'Etat devait adopter, selon vous ? Manuel Valls : Ne confondons pas les sujets. Si, dans une situation exceptionnelle, il faut une mesure exceptionnelle, c'est-à-dire le couvre-feu, sur un temps limité, en concertation avec les maires, et si la situation l'exige, je n'y suis pas défavorable. En revanche, les annonces concernant les immigrés présentent un amalgame dangereux, car elles laissent entendre que les violences seraient liées à l'immigration, aux étrangers. Je les condamne. Quand à la décrue, elle ne doit pas nous aveugler : sur le terrain, nous restons vigilants. Des actes de violence ciblés sont toujours possibles. Elkalam.com : Bonjour, ayant vécu dans un quartier difficile pendant toute ma jeunesse, je n'ai jamais rien vu changer, aussi bien sous la gauche que sous la droite. Comment expliquez-vous que durant toutes ces années, aucun gouvernement ne se soit vraiment préoccupé du problème ? Manuel Valls : Vous avez raison, nous payons trente ans de ségrégation territoriale, sociale et ethnique jamais véritablement endiguée. La prise de conscience existe de part et d'autre, d'où la politique de la ville, mais les moyens mis pour résoudre cette crise n'ont jamais suivi. C'est donc une responsabilité partagée, et il faut changer de politique. Elkalam.com : La gauche, son leader en tête, a été très peu entendu lors des derniers événements dans les banlieues. Comment expliquez-vous un tel effacement ? Aucune proposition concrète n'est venue du banc de l'opposition à l'Assemblée... Pierre : Que propose la gauche pour résoudre ces émeutes ? Manuel Valls : Vous êtes un peu injuste. Pour résoudre les émeutes, la seule réponse est l'ordre public. Notez que la plupart des grands leaders politiques ont du mal à se faire entendre, et je ne parle même pas de Jacques Chirac. C'est un signe supplémentaire de nos crises politiques. Ce sont les maires qui parlent beaucoup. J'ai des propositions qui, pour beaucoup, recoupent celles du PS : sur l'éducation, je pense aux moyens à mettre sur les ZEP, mais j'en défends d'autres, différentes, comme la discrimination positive. Mais les emplois-jeunes, le soutien aux associations, la police de proximité, la loi SRU, c'est tout de même la gauche, et tout cela a été défait par le pouvoir actuel. Rayan : J'ai un bac+6, je cherche un emploi depuis trois ans et je suis toujours au RMI. Qu'est-ce que je réponds aux gamins de mon quartier quand ils me disent "à quoi ça sert de faire des effort pour être dans ta situation ?" ? Manuel Valls : Votre situation n'est pas caricaturale, elle est malheureusement une réalité, et c'est notre système de valeurs qui est donc mis en cause. La lutte contre les discriminations ou le blocage de l'ascenseur social, la nécessité pour la fonction publique ou pour les entreprises d'embaucher des jeunes diplômés comme vous ou non s'impose. C'est pour moi l'urgence si l'on veut vous redonner confiance. Arnaud_B : Vous êtes pour la discrimination positive, mais sur quels critères alors ? Jean_yanne : Vous parlez de discrimination positive, mais sur quels critères ? Raciaux ? De naissance ? N'est-ce pas revenir alors à des critères non républicains ? Manuel Valls : Sur des critères territoriaux et sociaux. Comme pour les zones d'éducation prioritaire, comme pour la politique de la ville, comme pour les conventions entre les lycées et certaines écoles, en les appuyant sur un système de bourses réellement performant, pas sur des critères ethniques, raciaux ni religieux. Je suis contre la nomination d'un préfet "musulman", comme l'a fait Nicolas Sarkozy. Mais la discrimination positive, ou l'action positive, doivent être un volontarisme qui, aujourd'hui, manque. Urbain : Pensez-vous que les ZEP ont été une réussite ? Manuel Valls : Si elles n'avaient pas existé, où en serions-nous ? Mais elles concentrent uniquement 13 % de moyens supplémentaires par rapport aux autres territoires. C'est 100 % qu'il faut mettre en plus. Et pour lutter contre l'échec scolaire, il faut des classes de 17-18 élèves, surtout en élémentaire. Il faut des enseignants formés et expérimentés, nettement mieux payés. C'est tout le système qu'il faut revoir. C'est sur l'élève, sa famille et son environnement qu'il faut faire porter l'effort. "UN '21 AVRIL' SOCIAL" Vepe : La difficulté des politiques à proposer et à mettre en œuvre des solutions pertinentes n'est-elle pas surtout le signe que les politiques n'ont plus guère de prise sur le cours des choses ? Vous-même, comment voyez-vous vos capacité d'agir sur le réel dans le territoire qui est le vôtre ? Manuel Valls : Comme maire, on a toujours le sentiment d'agir sur le réel. Mais il nous manque des moyens financiers. Les villes qui accueillent les populations les plus défavorisées sont les moins riches. Sans une réforme fiscale profonde, nous n'y arriverons pas. Savez-vous qu'à Evry, les impôts sont plus lourds qu'à Paris, parce que le Parlement n'a pas eu le courage de modifier depuis trente ans les valeurs locatives ? C'est à ces conditions, en changeant la réalité, qu'on redonnera confiance à nos concitoyens. Mais il faut aussi de la continuité. Et en changeant de majorité à chaque élection, notre pays ne permet pas cette continuité. Même si, en 2007, je vous encourage encore à changer de majorité... Mr_mkl : Pensez-vous que nous allons inexorablement vers un "21 avril" 2007 ? Manuel Valls : Nous vivons un "21 avril" social, actuellement. Et tout cela ne m'étonne pas. Et rien ne nous dit qu'en 2007 nous ne connaîtrons pas de nouveau un tremblement de terre politique. Notre crise urbaine et sociale se déroule sur fond de crise politique et morale. Il faut donc un sursaut, et la responsabilité sur les épaules de gauche est donc importante. Sans un projet, sans redonner du sens à la France, le désenchantement continuera à faire des ravages. Arnaud_B : Certaines villes peuvent payer pour ne pas avoir à accueillir des logements sociaux, ce qui contribue parfaitement à une centralisation des problèmes. Pensez-vous que l'on pourrait "mixer" les populations ou que les différences sont trop grandes ? Manuel Valls : Vous avez raison, il faut revoir la loi SRU, obliger les villes à construire au moins 20 % de logements sociaux. La sanction financière doit être beaucoup plus élevée, car aujourd'hui, certaines villes se contentent, comme vous le dites, de payer une amende. Ce sont les mêmes villes, les mêmes quartiers qui accueillent les populations les plus en difficulté. C'est cela qui crée le ghetto. Sans la fiscalité locale, sans une mixité sociale à l'échelle des territoires, nous n'arriverons pas à endiguer les difficultés actuelles. Les politiques éducatives et sociales n'y suffiront pas. Sofiane : En matière de crise politique et morale, les médias tout comme les politiques ont une part de responsabilité dans le traitement qui est réservé aux minorités. Qu'en pensez-vous ? Manuel Valls : Nous vivons à la fois la faillite du modèle d'intégration français et la montée des communautarismes, ou ce que j'appelle l'hystérie identitaire. Et la France vit avec un ascenseur social bloqué. En Grande-Bretagne, le système communautaire, qui crée des inégalités très profondes, permet cependant à des Britanniques d'origine pakistanaise ou indienne d'être élus à la Chambre des communes, de présenter des journaux télévisés, de faire partie des élites économiques et culturelles. Ce n'est pas le cas chez nous. Il n'y a aucun parlementaire d'origine maghrébine ou africaine à l'Assemblée. C'est donc que notre classe politique ne représente pas la société. C'est vrai aussi en ce qui concerne les femmes ou les couches sociales. A Evry, mon conseil municipal représente toute la diversité d'une ville. Il est temps qu'au niveau des dirigeants de ce pays on fasse le même effort. Si nous voulons réconcilier la politique avec les citoyens, c'est un impératif. Frank : Ne pensez-vous pas que ces événements illustrent une fois de plus l'échec total de l'intégration et que se restreindre à analyser cela d'un point de vue uniquement social, c'est ne voir que la moitié du problème, et qu'il existe également une réelle fracture ethnique ? Manuel Valls : Je parle de ségrégation ethnique. Cela renvoie bien à des politiques éducatives, sociales, urbaines, de logement, etc. Mais il y a sans doute un échec plus profond qui est culturel ou identitaire. Nous n'avons pas su transmettre des valeurs communes. Faire vivre à la fois des doubles cultures et faire aimer la France. Parce que la France n'a pas su aimer une partie de cette jeunesse. Cela passe par l'éducation, les médias, la famille, c'est donc toute notre société qui est interrogée. Jean_yanne : Comment expliquez-vous que certaines populations immigrées s'intègrent parfaitement et utilisent pleinement l'ascenseur social, et que d'autres ne trouvent pas le bouton ? Manuel Valls : L'immigration des années 1950 ou 1960 s'est faite dans un contexte de croissance et de plein emploi. Celle des années 1970-1980, celle d'aujourd'hui, se font essentiellement sur fond de misère, de guerre, de famine du Sud vers des pays à la fois riches mais confrontés aussi à la crise économique. C'est le cas de la France. Cela explique qu'une grande partie de notre immigration et de ses enfants vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles. Le regroupement familial couplé à la construction de grands ensembles pour accueillir les ouvriers et leurs familles, la crise dans la sidérurgie, le charbon, l'automobile, ont provoqué une fracture sociale, un chômage de masse dans des populations peu qualifiées, peu formées, pas aidées. Nous sommes aujourd'hui en train d'en vivre une partie des conséquences. Mais il n'y a pas de prédétermination ethnique, évidemment. Cela serait insupportable à entendre. Mais il y a une crise d'identité, j'y reviens, des enfants et des petits-enfants de l'immigration. Ils sont français, mais ils ne se sentent pas toujours français. Ce n'est pas leur faute. C'est à la société tout entière de répondre à ce cri de désespoir qu'ils nous lancent parfois à la figure. Par ailleurs, il faut que la France accepte qu'un Français n'est pas forcément blanc. Je cite une intellectuelle d'origine africaine qui dit qu'on peut être français et noir. Totalement français et totalement noir. Cela vaut pour toutes les origines. Etre français, c'est adhérer à un système de valeurs. Le sang et les origines n'ont rien à voir avec cela. J'en suis moi-même l'illustration : je suis fils d'Espagnols, né à Barcelone, naturalisé en 1982, et je représente la nation à l'Assemblée nationale. Momo : Pourquoi une telle ampleur et une telle durée de violence urbaine arrivent-elles en France et pas ailleurs ? Manuel Valls : Ce n'est pas tout à fait exact. La Grande-Bretagne est secouée régulièrement depuis vingt ans par des émeutes urbaines et raciales. Et si les autres pays voisins nous observent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent être aussi concernés par ce problème. Mais peut-être que notre modèle supporte encore moins que d'autres les ghettos, la misère reléguée dans les quartiers, et c'est la raison pour laquelle c'est tout l'édifice républicain qui aujourd'hui se lézarde. Elkalam.com : L'opinion semble favorable aux différentes mesures proposées par M. Sarkozy. Ne craignez-vous que cette période de trouble engendre une accentuation du tout sécuritaire dans les banlieues, au détriment d'une politique de l'emploi plus innovante ? Manuel Valls : Nos quartiers ont besoin de sécurité, car la délinquance touche d'abord les plus modestes, les plus fragiles de notre société. La lutte contre le crime, les réseaux mafieux, les trafics de drogue, de voitures, d'armes doit être d'autant plus prioritaire pour la gauche qu'ils se développent dans les quartiers populaires. Je n'oppose pas sécurité et justice sociale, bien au contraire. Et puis cela dépend de ce que l'on met dans une politique de sécurité. Je crois beaucoup à la continuité du travail d'une vraie police de proximité. Mais c'est vrai : sans emploi, sans formation, il sera difficile de redonner de l'espoir. Sofiane : Une journaliste de la BBC disait que la devise "liberté, égalité, fraternité" s'arrêtait aux portes des banlieues. Qu'en pensez-vous ? Manuel Valls : Il ne faut pas exagérer ! Il y a beaucoup de générosité dans nos quartiers. Une volonté de vivre ensemble, de s'en sortir, de réussir. L'immense majorité de la jeunesse veut réussir. Mais c'est vrai que notre devise républicaine est mise à mal par la violence sociale que subissent nos villes. Alors nous devons tout faire pour qu'elle se traduise dans la réalité. Djibril6ctp : Comment expliquez-vous que les jeunes ne voient plus dans le bulletin de vote la première des "armes" de revendication ? Manuel Valls : Dans les sociétés modernes, dans les vieilles démocraties, le vote, le rôle des politiques, la participation citoyenne ont tendance à s'affadir. Et pourtant, la démocratie ne peut pas se développer dans la violence. A Evry, tous les ans, nous menons des campagnes d'inscription sur les listes électorales. Nos conseils de quartier sont ouverts à tous les citoyens de la ville. Nous essayons de redonner goût à la démocratie. J'encourage tout le monde à utiliser son bulletin de vote. Mais pour cela, il faut que les élus, les responsables politiques, par leur comportement ou par leur courage, redonnent confiance dans la chose politique, c'est-à-dire tout simplement dans la République. Chat modéré par Constance Baudry et Karim El Hadj
Banlieues : des territoires abandonnés ? LEMONDE.FR | 04.11.05 | 11h54 • Mis à jour le 07.11.05 | 20h04 L'intégralité du débat avec Eric Macé, chercheur au Centre d'analyse et d'intervention sociologique (EHESS - CNRS) et maître de conférences à l'université Paris-III et à l'IEP de Paris, lundi 7 novembre 2005
Lacruze : D'après vous, quels sont les différents groupes, groupuscules ou individus à l'origine de ces actes de violence ? Eric Macé : Il y a plusieurs catégories. Concernant la première émeute, celle de Clichy, il s'agit de violences spontanées de la part du tout-venant : gamins, jeunes adultes, la plupart du temps scolarisés, certains même travaillant ou même jeune parent. Car là, c'était la logique de l'émotion, de la rage, qui sont collectives.
Après l'épisode de Clichy, concernant l'extension depuis une dizaine de jours, il y a la catégorie la plus importante : un ensemble de jeunes qui ont des comptes à régler avec la police et voient là l'occasion d'inverser un rapport de forces, ou même s'ils n'ont rien à se reprocher, des rapports d'humiliation, de vexation. Plus la griserie juvénile de ce type de conduite à risque. Mais à mesure que le phénomène s'élargit et s'étend – et c'est le problème de la logique de la violence –, on va voir venir d'autres groupes qui auront cette fois des visées qui peuvent être beaucoup plus criminelles, qui vont profiter de l'occasion pour des règlements de comptes contre des commerçants ou d'autres personnes privées. Et il ne faut pas exclure non plus des groupes de type fasciste qui vont profiter du désordre pour aggraver cette situation de violence en prenant pour cibles notamment, on l'a vu, un foyer Sonacotra. C'est une espèce de stratégie de la tension. C'est le problème en général de la violence : une fois qu'elle est partie, tout est possible, y compris des provocations qui ne sont pas le fait des jeunes émeutiers dont on a parlé. lt : Comment doit-on qualifier ces événements : émeutes, crise, guérillas ? Eric Macé : Je crois que la séquence de Clichy est clairement une émeute, dont le scénario est connu depuis vingt ans. Ce qui est nouveau, c'est l'extension et la persistance. Et là, on peut parler de guérilla, mais je dirais de guérilla "émeutière" si l'on accorde à l'émeute un sens qui, au fond, conserve malgré tout une dimension politique. Dimension politique d'action collective et pas seulement de conduite délinquante. Helix : Cette situation est-elle caractéristique de la France, et si oui, pourquoi ? Eric Macé : On connaît tous les exemples des émeutes de Los Angeles aux Etats-Unis et Bradford en Grande-Bretagne. Les ingrédients sont exactement les mêmes. Mais ce qui est tout à fait nouveau aujourd'hui, c'est l'attitude du gouvernement et du ministre de l'intérieur, qui sont à l'origine d'une stratégie de la tension et qui, au lieu d'ouvrir des espaces de parole ou des espaces permettant le passage au politique, persistent dans la provocation et dans la fermeture concernant les significations de ces émeutes. Les ingrédients dont je parle, c'est, particulièrement en France, un chômage des jeunes le plus élevé d'Europe, des discriminations racistes et des relégations urbaines aggravées et, depuis le début des années 1990, une stigmatisation des jeunes des banlieues populaires qui les fait apparaître comme étrangers à la société française, qui les constitue en menace avec une surenchère dont les étapes sont les suivantes : ils ont d'abord été assimilés à des voleurs, puis, avec l'affaire des tournantes, à des violeurs, puis, avec l'affaire du foulard à l'école, à des "voileurs", et dernièrement, à de la racaille qu'on nettoie au Kärcher. Ça commence à faire beaucoup. Coolbens : Pensez-vous que l'attitude provocatrice de Nicolas Sarkozy soit à l'origine de la révolte des banlieues ? Sirius2 : Avant Nicolas Sarkozy, Azouz Begag et Malek Boutih avaient utilisé le terme de "racaille". En quoi ce mot est-il choquant ? Eric Macé : La responsabilité est collective depuis vingt ans. Concernant la responsabilité de Nicolas Sarkozy, il faut revenir à la présidentielle d'avril 2002. La droite a gagné la présidentielle de 2002 sur la base d'une campagne électorale ultra-sécuritaire, en discréditant la gauche sur cette question, au point que la gauche elle-même avait adopté ce langage ultra-sécuritaire. Donc, la droite a gagné sur une campagne finalement d'extrême droite, et la mission qui a été confiée à Nicolas Sarkozy par Jacques Chirac était d'incarner cette droite dure afin de satisfaire aux demandes sécuritaires de cet électorat. Mais ce qui est nouveau, c'est que Nicolas Sarkozy ne s'est pas contenté de jouer le rôle qui lui a été imparti par Jacques Chirac. Il a joué son propre rôle de surenchère au sein du gouvernement sur les questions de sécurité. Et donc le résultat, c'est qu'il en est venu à incarner à lui tout seul la question de sécurité, à incarner à lui tout seul l'ordre de la police, et il se retrouve donc dans un face-à-face direct avec les jeunes, ce qui explique aussi le nouveau rôle joué par les médias. Puisque, dorénavant, chaque voiture qui brûle a un effet direct sur l'autorité gouvernementale, car Nicolas Sarkozy a ruiné l'ensemble des médiations qui permettent de faire tenir des politiques publiques de sécurité. Sur le terme "racaille", j'ai un peu répondu. La fin du gouvernement Jospin a été une période de durcissement sécuritaire de la gauche, précisément en prévision de l'offensive sécuritaire de la droite. On a aujourd'hui au PS des dirigeants qui tiennent le même type de discours sécuritaire que la droite, qui sont des discours qui finalement empêchent de penser les situations en utilisant des termes qui sont des attrape-sens commun, qui vont dans le sens d'un imaginaire des banlieues comme menace et qui contribuent à dépolitiser la question des inégalités, des exclusions et des discriminations. GGGG68 : Les émeutiers ont-ils conscience que tous leurs actes donnent une opinion bien négative des quartiers, qui les dessert eux et leurs proches, en favorisant la discrimination (travail, etc.), et qu'ils contribuent ainsi à renforcer le malaise des banlieues ? Eric Macé : Dans les banlieues populaires, il y a une intelligence des situations. Pour tout le monde, il est clair qu'en temps ordinaire les violences économiques, sociales, symboliques qui s'exercent sur les habitants des banlieues populaires sont parfaitement invisibles. Et donc il est parfaitement clair pour tous que les émeutes sont l'un des rares moyens qui permettent, par la violence émeutière, de rendre visible cette violence structurelle. C'est comme si l'on reprochait aux émeutiers de la Commune de Paris d'utiliser la violence contre la République bourgeoise alliée aux troupes d'occupation allemandes dans les années 1870-1871, ou comme si l'on reprochait la violence des guerres de décolonisation. "CES GAMINS SONT COMME DES CATALYSEURS, DES DISJONCTEURS, QUI RISQUENT DE CRAMER" Luicito : Que vont devenir ces jeunes qui aujourd'hui participent aux émeutes, sachant qu'il n y a pas véritablement de conscience politique derrière ces flambée de violence et qu'une partie de la classe politique récupère ces événements pour redorer son blason ? Eric Macé : Il y a toujours une vertu politique de l'émeute qui est la constitution de collectifs de parole, d'expérience qui marquent une expérience personnelle et collective. Le drame, néanmoins, c'est que l'on a affaire à des adolescents qui portent sur leurs épaules le poids d'une révolte, le poids d'une confrontation qui est bien trop lourd pour eux. Ces gamins ont beaucoup de risques d'être détruits ou écrasés par, finalement, le désert qui a été créé entre les institutions répressives et les populations. Il n'y a plus de médiation, plus de politique, et ces gamins sont comme des catalyseurs, des disjoncteurs, qui risquent de cramer. Régis : Le fait que ces groupes s'attaquent aux institutions n'est-il pas le reflet de l'incapacité croissante de mettre en application une réelle politique d'acceptation des populations issues de l'immigration dans la société française. N'y a-t-il pas sans cesse une volonté politique de stigmatiser et discriminer ces populations ? Eric Macé : Je crois – tout le monde l'a vu à la télévision – qu'ils sont tous Noirs et Arabes. On fait mine de découvrir la dimension profondément raciste et disons néocoloniale de la relégation urbaine. Et il y a un rapport étroit avec le caractère abstrait du modèle français d'intégration qui, d'une part, est aveugle aux discriminations réelles et, d'autre part, laisse se développer des rhétoriques de refus de la différence. Et qui continue à parler d'immigrés pour des gens dont les parents mêmes sont nés en France. On voit bien que l'imaginaire républicain recouvre en réalité un imaginaire blanc et chrétien. Et tout le reste est différent. Julia : Je suis anglaise et je veux savoir si vous pensez qu'il y a une espèce de racisme "institutionnel" en France ? On en a beaucoup parlé ici en Angleterre, il y a quelques années, et ça a mené à des changements significatifs dans la police. Eric Macé : Tout à fait, c'est exactement le terme, il existe un racisme institutionnel, c'est-à-dire un racisme non intentionnel mais qui a des effets profonds de discrimination. La question a été prise en compte en Grande-Bretagne parce qu'il était légitime politiquement de considérer les discriminations sur une base ethnique, ce qui est impossible en France puisque la loi républicaine interdit de prendre en compte – ne serait-ce que d'un point de vue statistique – les discriminations raciales. En France, on a donc un racisme institutionnel qu'il est interdit de traiter institutionnellement. QUEL MODÈLE FRANÇAIS D'INTÉGRATION ? Mylady : Vous parlez de "modèle français d'intégration". Mais quel est donc ce modèle ? Eric Macé : Ce modèle, c'est que la République ne reconnaît que des individus égaux en droit quelles que soient leurs différences par ailleurs. Donc l'effet positif, c'est que chacun est reconnu comme un individu, l'effet négatif, c'est que lorsque cette égalité en droits est bafouée par des inégalités de fait, le modèle français est incapable de voir et de traiter ces inégalités de fait, au nom de l'égalité en droits. Par ailleurs, le modèle français d'intégration se pense universel. En réalité, comme je l'ai dit, il recouvre une "normalité" qui, dans l'imaginaire national, est celle des Français blancs de culture chrétienne. Mat : Vous semblez défendre les jeunes en argumentant sur un point de vue politique, mais ne devrions pas nous préoccuper plus de ceux dont les voitures ont brûlé, et appeler ceux qui font ça des délinquants, sans vouloir faire dans le politiquement correct ? Gache : M. Macé, oui les émeutes sont le moyen de se faire entendre.... ou d'être vu à la télé. Certes la vie dans les cités n'est pas acceptable. Mais vous-même, et si vous possédiez une entreprise, iriez-vous vous installer dans ces zones ? Arrêtons de pleurer. Eric Macé : Lorsque des syndicalistes exercent un rapport de forces, y compris violent par des manifestations, des occupations, tout le monde comprend bien (parlons même de Mai 68) que les dommages privés de ceux dont les voitures brûlent ne peuvent pas réduire la signification de ces violences. La question posée est la suivante : soit on réduit ces violences à leur seule dimension délinquante, et on s'empêche d'en comprendre les significations et donc d'agir sur elles en profondeur ; soit on accepte que ces conduites, qui sont de fait délinquantes, ont aussi une dimension politique qu'on ne peut pas négliger. On peut toujours prendre les effets pour les causes. On peut toujours penser qu'une fois ces quartiers dégradés, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Le raisonnement est confortable et montre bien que le prix à payer pour réhabiliter ces quartiers est beaucoup plus élevé que la capacité d'action d'un chef d'entreprise isolé ou même d'un maire, ou même d'une association. On voit bien qu'après vingt ans de dégradation de la situation, il faudra bien des politiques publiques d'envergure permettant d'établir la confiance nécessaire à une vie meilleure.
Bannidemploi : Les mots d'ordre du gouvernement sont "fermeté", "tolérance zéro", "justice". Dans l'esprit du gouvernement, justice veut dire condamner les émeutiers tout de suite avec fermeté et pour l'exemple. Le cri de désespoir des émeutiers, et au-delà des émeutiers, c'est pour plus de justice. Que les CV ne soient pas rejetés juste au vu du nom, comme c'est si souvent le cas. On voit si souvent des diplômés d'origine maghrébine, même de hautes écoles, ne pas trouver d'emploi alors que tous leurs camarades de promo ont trouvé des emplois. Comment voulez-vous qu'un jeune de 22 ou 24 ans, soumis à une telle injustice et un tel racisme, ne veuille pas se révolter ?
Ardent : Que pensez-vous de l'intervention de M. Chirac tant sur la forme que sur le fond ? Eric Macé : La dimension raciste et quasi néo-coloniale de la gestion des banlieues est évidente. Jusqu'à présent, le système politique français s'est trouvé totalement incapable de prendre en compte cette dimension de la société française. Tout comme il s'est montré totalement incapable de prendre en compte la question de la participation des femmes à la politique, puisque la loi sur la parité est systématiquement contournée pour une raison qui a des effets directs sur la question du racisme : le personnel politique français refuse de se renouveler, refuse malgré la loi de laisser place aux femmes, comme il refuse de laisser place à des Français qui ne sont pas blancs. Sur l'intervention de Jacques Chirac : de nouveau, le président apparaît comme quelqu'un qui crée lui-même les situations difficiles qu'il doit ensuite résoudre. C'est lui qui a demandé à Nicolas Sarkozy de faire une politique ultra-sécuritaire. C'est lui qui attise la compétition entre son premier ministre et son ministre de l'intérieur. Et donc c'est lui qui doit à la fois augmenter la tension politique au sein du gouvernement et dans le pays, tout en ne pouvant pas faire baisser la tension sociale dans ce même pays. DES TERRITOIRES "ABANDONNÉS" AUTANT PAR LES PARENTS QUE PAR L'ÉTAT ? Aurélien : On parle de chômage et de racisme. Ne devrait-on pas mettre en avant l'éducation parentale ? Mes amis et moi, d'origines ethniques et religieuses diverses, vivons dans une cité et nous nous en sortons tous bien. Dès 10 ans, certains enfants insultent la police, rackettent et restent dehors après 22 heures. Vincent : Ne pensez-vous pas que ces territoires sont autant "abandonnés" par les parents que par l' Etat ? Eric Macé : L'autonomisation des adolescents par rapport à leurs parents est un trait général dans les sociétés contemporaines, et on observe donc une perte d'emprise parentale sur les adolescents dans tous les milieux, puisque c'est un trait de nos sociétés. On a donc partout le même souci des parents d'être des bons parents, et partout le même désir des adolescents d'échapper à l'autorité des parents. C'est valable aussi dans les banlieues populaires. La différence, c'est que dans les banlieues populaires, on trouve de nombreuses familles dont le fonctionnement est cassé par un ensemble de contraintes ou de violences sociales et économiques. On a beaucoup de mères célibataires qui doivent travailler, par exemple. On a donc des familles qui sont de bonne volonté mais dont les moyens d'autorité sont ruinés par la dureté de leurs conditions d'existence. Et les situations d'indifférence parentale ou de mauvaise éducation parentale existent, mais elles sont marginales ; elles ne constituent pas, en tout cas, une forme d'explication. Enrique : Ce qui est frappant dans les reportages sur les banlieues, ce sont les nombreux exemples de solidarité parmi les habitants. En fait, ce sont surtout les "jeunes" (sans avenir) qui sont révoltés. Les autres catégories d'habitants (adultes, personnes âgées, RMIstes, chômeurs, etc.) ne manifestent-ils pas des sentiments de révolte ? Par quels moyens ? Eric Macé : On est dans un monde dont l'expérience sociale est extrêmement dure, dont l'environnement social et économique est brutal et qui ne dispose plus de relais politiques pour exprimer des formes de résistance ou d'opposition à ces conditions d'existence. Donc on observe en temps normal des formes de violences contre soi, pour les plus âgés, c'est l'alcool, les médicaments, et pour les plus jeunes, des formes d'autodestruction, soit suicidaires, soit de conduites à risque, soit de violences contre autrui. De ce point de vue, l'émeute a, encore une fois, une dimension positive car elle permet d'exprimer cette révolte autrement que de façon privée et autodestructrice. Riccina : J'habite dans le 93, et il est flagrant de constater qu'en plus nous disposons des enseignants les moins expérimentés, de jeunes policiers incapables de faire face à de telles situations. Ne pensez-vous qu'il s'agit d'une "double peine" pour nos banlieues, déjà peu favorisées ? Eric Macé : Prenons l'exemple des ZEP, qui sont un début de prise en compte des inégalités par les institutions. Le résultat est totalement paradoxal : un récent rapport montre que les établissements classés en ZEP, en tout cas en Seine-Saint-Denis, bénéficient de moins de dotations, y compris de dotations d'enseignants expérimentés, que les établissements qui ne sont pas en ZEP, en particulier des établissements de centre-ville. On a une situation extrêmement contradictoire et tendue, qui est que le label ZEP, qui devrait donner plus, donne moins et, en plus, contribue à la stigmatisation des établissements classés en ZEP, donc à la fuite des familles qui le peuvent, donc à une augmentation de la ségrégation. Martin : Pourquoi la police ne parvient-elle pas à rétablir l'ordre ? Ne dispose-t-elle pas des moyens nécessaires ? Eric Macé : C'est tout le problème de l'ordre public. Il est évident que l'ordre public, en temps normal, tient sans que la répression soit nécessaire. De sorte qu'en temps normal la police n'a pas à rétablir l'ordre public, puisque chacun y contribue. Y compris la police dans son rôle de "gardien de la paix". Or la situation aujourd'hui est que la police a radicalisé son extériorité, sa distance par rapport aux populations et aux quartiers, qu'elle a été instrumentalisée par le ministre de l'intérieur comme seule force d'occupation, et qu'elle est donc de ce fait nécessairement débordée. LA QUESTION ESSENTIELLE EST CETTE NOTION DE DISCRIMINATION INSTITUTIONNELLE" Hubert : Bannidemploi a raison, mais que faire ? Les CV anonymes ? La discrimination positive prônée par Sarkozy ? Pensez-vous que des quotas ou des mesures comme la parité sont de bonnes solutions ? Ne risque-t-on pas, à terme, de créer encore plus de discrimination ? Eric Macé : Sur les discriminations à l'embauche, je crois que la question essentielle est cette notion de discrimination institutionnelle. Cela veut dire qu'on se donne les moyens de disposer d'indicateurs permettant de mesurer les discriminations racistes. Et à partir de là, si, par exemple dans la fonction publique, on observe qu'il n'y a que 5 % de non-Blancs alors qu'en France ils sont 20 %, on met en place non pas des quotas, mais des mesures d'incitation permettant d'être beaucoup plus attentif aux candidatures concernées. Même chose pour les entreprises : les syndicats et le patronat peuvent reconnaître la nécessité de lutter contre les discriminations à l'embauche, et s'ils disposaient d'indicateurs, ils se fixeraient comme objectif, comme en Grande-Bretagne, d'atteindre une représentativité significative. Il y a deux limites à ce raisonnement. Première limite : le refus français absolu de ce type de mesures. Deuxième limite : sa relative inefficacité technique, au sens où– on le voit avec les discriminations envers les femmes – l'ensemble des mesures disponibles et des actions entreprises n'a pas conduit à des changements significatifs. On voit donc bien que la question renvoie en réalité à des rapports de forces politiques qui, aujourd'hui, en France ne sont favorables ni aux femmes ni aux minorités. Pere Steve : Quelle est la part d'explication spatiale dans l'origine de ces phénomènes ? La ghettoïsation des quartiers bâtis durant les "trente glorieuses" paraît évidente, et me semble à l'origine du phénomène identitaire qui conduit les banlieues de province à se révolter aussi. Quelles seraient alors pour vous les meilleures solutions en matière d'aménagement urbain ? Eric Macé : D'abord, il n'y a pas de rapport entre l'urbanisme et les effets de ségrégation ou de relégation, puisque si l'on prend l'exemple américain ou anglais, les quartiers de relégation sont des quartiers pavillonnaires et qu'il n'y existe pratiquement pas de grands ensembles. La question n'est pas à proprement parler une question d'urbanisme, elle est plus large : celle de rapports sociaux, d'exclusion, qui contribuent à enfermer des populations entières dans des sites urbains qui sont abandonnés par les politiques publiques. On parle beaucoup de mixité, mais là il y a une illusion. La mixité veut dire en réalité déstructurer encore plus les quartiers populaires en chassant une partie de la population pour la remplacer éventuellement par des petites classes moyennes. Donc, au fond, la mixité conduit à radicaliser les tensions internes à ces quartiers. Il vaudrait peut-être mieux prendre ces quartiers populaires pour ce qu'ils sont : une expérience sociale commune des difficultés de la vie, des ressources personnelles et collectives très importantes, mais qui sont toujours non reconnues, voire disqualifiées, par les aménageurs et par les représentants des classes moyennes que sont les élus. On a des exemples, en particulier aux Etats-Unis, de prise au sérieux de la capacité d'action des acteurs populaires qui conduit à de bien meilleurs résultats que l'imposition d'une mixité finalement désorganisatrice. Chat modéré par Constance Baudry et Stéphane Mazzorato
Vingt ans après la Marche des beurs par Boris Thiolay Au slogan "black-blanc-beur" ont peu à peu succédé les revendications religieuses Deux gamins dévorent des yeux les piles de gâteaux qui emplissent la vitrine d'une pâtisserie orientale. La pizzeria halal ouvre enfin ses portes. Les groupes de jeunes adultes, scotchés depuis des heures au pied des immeubles, se dispersent. Il est 17 h 20 et le jour décline rapidement. C'est le moment du ftour, l'heure où les musulmans se retrouvent en famille pour rompre le jeûne du ramadan. A Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, la cité des Minguettes est plus qu'une ville dans la ville. C'est un ghetto géographique, social, ethnique. A 500 mètres du centre, près de la moitié des habitants de la ville - 21 000 sur 56 000 - s'entassent sur le "plateau", un dédale de tours de 15 étages. Ils sont majoritairement d'origine maghrébine. 40% d'entre eux sont au chômage. Ici, il y a dix ans, aucun jeune issu de l'immigration ne se définissait comme musulman. Aujourd'hui, leur référence à l'islam est omniprésente. "Nous avons été instrumentalisés par la gauche, qui a voulu faire de nous les bons Arabes de service" Il y a vingt ans, pourtant, les Minguettes furent à l'origine d'un formidable espoir de fusion black-blanc-beur. A l'automne 1983, après de graves émeutes répondant à des violences policières, une quinzaine d'habitants du quartier entamèrent une Marche pour l'égalité et contre le racisme qui, rebaptisée Marche des beurs, draina 100 000 personnes à Paris le 3 décembre 1983 et dont une délégation fut reçue à l'Elysée. Une partie de la France scanda un an plus tard le slogan de SOS-Racisme "Touche pas à mon pote". Vingt ans après, les jeunes des Minguettes affirment que le pays est passé d'un racisme antiarabe à un racisme antimusulman. Une conviction qui a germé sur la frustration vécue par les "grands frères" et les vétérans de la marche. "Nous avons été instrumentalisés par la gauche, qui a voulu faire de nous les bons Arabes de service. Quelques-uns ont obtenu des postes, mais ici rien n'a changé, affirme Toufik Kabouya, 48 ans, l'un des premiers marcheurs. Tout est fait pour que les gens des Minguettes restent entre eux, naissent, grandissent et meurent dans la ZUP." Les "Gaulois", eux, sont partis. Y compris les enseignants et les travailleurs sociaux qui hier résidaient dans le quartier. Ingénieur en informatique, Toufik Kabouya dénonce les discriminations au logement et à l'embauche. Il s'indigne des "offres d'emploi qui parviennent à l'ANPE frappées d'un code signifiant "pas d'Arabe"" - ce que l'administration dément. "Il y a un mur invisible autour de la ZUP", renchérit Patrick Henry, 42 ans, autre ancien marcheur. "Comment, dans une classe avec 90% d'élèves étrangers ou d'origine étrangère, les enfants peuvent-ils s'identifier aux valeurs françaises? demande un éducateur. Des trois grands principes républicains, le seul qui nous reste, c'est la fraternité, mais elle est communautaire. Et, quand les autorités s'appuient sur les imams plutôt que sur les associations pour prévenir les problèmes, qui laisse prospérer le communautarisme?" "Le temps du paternalisme est terminé : nous voulons être reconnus à part entière" Pour des jeunes en quête d'identité ou en rupture sociale, il est tentant de se revaloriser ou de se venger de la société en se tournant vers la religion. Aux Minguettes, une minorité a succombé au prosélytisme des imams salafistes, qui prônent un islam total et élargissent la fracture communautaire en affirmant aux jeunes que "voter, c'est pécher". On rencontre ces nouveaux fidèles aux abords des salles de prière, arborant le total look muslim: calotte sur la tête, barbe de 7 centimètres, khamis tombant à mi-mollet et souvent... baskets de marque aux pieds et téléphone portable en sautoir. Deux jeunes du quartier ont même rejoint les rangs du jihad. Arrêtés en 2001 en Afghanistan, Mourad Benchellali, 22 ans, fils de l'imam du boulevard Lénine, et Nizar Sassi, 23 ans, sont détenus à Guantanamo, à Cuba: ils sont suspectés d'appartenir aux réseaux d'Al-Qaeda. A présent, de nombreux jeunes appartenant à la troisième génération issue de l'immigration militent sur le terrain associatif et politique en s'affirmant "français musulmans" et estiment que la reconnaissance publique de leur foi est indissociable de leur citoyenneté. Le siège de DiversCité, collectif regroupant une quinzaine d'associations de l'agglomération lyonnaise, est une tour de Babel de la lutte contre les discriminations: logement, emploi, sexisme, racisme et... "islamophobie". Abdelaziz Chaambi, 46 ans, insiste: "Il y a vingt ans, nous cherchions à nier nos origines. Nous nous donnions des diminutifs neutres, Momo, Mouss... Aujourd'hui, le temps du paternalisme est terminé. Nous voulons être reconnus à part entière." Travailleur social depuis vingt-cinq ans, ancien militant trotskiste revenu à la religion, Chaambi est aussi l'un des cofondateurs, à Lyon, en 1987, de l'Union des jeunes musulmans (UJM). Cette association, couplée à la maison d'édition islamique Tawhid, a largement contribué à la diffusion des écrits de Tariq Ramadan. De quoi accabler le père Christian Delorme, l'un des initiateurs de la Marche des beurs, qui a pris ses distances avec l'UJM. "En focalisant les jeunes issus de l'immigration sur leur appartenance religieuse, cette association alimente le phénomène de repli identitaire", souligne l'ancien "curé des Minguettes". La semaine dernière, plusieurs membres de DiversCité participaient au Forum social européen, le rassemblement des altermondialistes. Une alliance contre nature? "Pas du tout, reprend Abdelaziz Chaambi. Chômage, délocalisations, consommation aveugle, déficit de services publics: nos quartiers sont les premières victimes de la mondialisation." Olivier Roy, spécialiste de l'islam, explique que l'extrême gauche et les groupes de jeunes réislamisés se rejoignent sur les thèmes de l'anti-impérialisme et de l'anticapitalisme. "Mais, pour les jeunes musulmans qui se situent dans le sillage de Ramadan, la demande d'intégration revêt une forme communautaire, précise-t-il. Ils veulent être reconnus en tant que groupe porteur d'une identité religieuse." Les 2 millions de Français issus de l'immigration maghrébine constituent aujourd'hui le plus gros gisement d'électeurs en friche. Elevé dans la banlieue lyonnaise au sein d'une famille de neuf enfants, Amar Dib, 39 ans, actuellement membre du Conseil économique et social, veut "tirer vers le haut" les jeunes des quartiers. "L'Etat, les entreprises publiques et les partis politiques doivent montrer l'exemple en donnant leur place aux Français issus de l'immigration", prévient-il. L'intégration contre le repli.
L'Express du 06/10/2005 Intégration Ascenseurs pour l'élite par Delphine Saubaber Comment favoriser l'égalité des chances dans le système scolaire? Du lycée aux classes prépa, en passant par l'université, les initiatives se multiplient pour "donner plus à ceux qui ont moins" Dans l'univers frileux des prépas, ils ne courent pas les préaux, les apôtres de l'égalité des chances. Jean-Claude Lafay en est un. Voilà un proviseur qui pourrait très bien se contenter de gouverner son fief élitiste, le lycée parisien Saint-Louis, ex-collège d'Harcourt - 60% d'admis dans les plus grandes écoles - sans s'émouvoir de son taux de boursiers. Justement, non. "Parce que les prépas doivent faciliter la mobilité sociale et démocratiser les élites", Jean-Claude Lafay a décidé de se pencher sur le sort de deux publics notoirement sous-représentés en prépa scientifique: les filles et les boursiers. En une poignée d'années, il a fait passer le taux des premières de 30 à 44% et celui des seconds de 10 à 15% dans son lycée. Comment? En instaurant, pour les filles, des "quotas temporaires" en 1999: 40% des lits de l'internat leur ont été réservés, cela a duré deux ans. Aujourd'hui, exit les quotas, elles affluent d'elles-mêmes. Pour les boursiers, pas de places réservées mais un système de points supplémentaires qui permet d'accorder en priorité à un étudiant aux revenus modestes une place à l'internat, à dossier égal et même légèrement inférieur à celui d'un autre élève. Aujourd'hui, le lycée recrute pour moitié en banlieue parisienne. Ses résultats n'ont pas flanché. Et le mérite est sauf: "Ces élèves sont sélectionnés sur leur dossier, traités comme les autres. Nous compensons simplement une inégalité."
Bourses au mérite Donner un coup de pouce à ceux dont le parcours sans faute est plombé par les origines sociales, en allant au-delà des traditionnelles bourses allouées selon des critères sociaux. C'est le principe des bourses au mérite, instaurées en 1998 pour démocratiser l'accès aux grandes écoles et destinées aux bacheliers titulaires de la mention très bien. Après un effort de 300 bourses supplémentaires consenti par l'Education nationale à la rentrée 2005, 1 100 bacheliers bénéficient aujourd'hui, pour une durée minimale de quatre ans, d'une bourse annuelle de 6 102 euros - soit près du double du montant de la bourse sur critères sociaux, cinquième échelon, qui s'élève à 3 607 euros. Des entreprises s'y mettent aussi, telle la fondation Euris, créée par Jean-Charles Naouri et présidée par Roger Fauroux, qui décerne 50 bourses de 7 630 euros par an à de brillants bacheliers au projet professionnel ambitieux. Une bourse renouvelable une fois si l'étudiant passe en année supérieure, avec de bons résultats et sans changer de filière. D'autres ont choisi d'allouer des bourses au mérite dès le collège, tel le groupe Pinault-Printemps-Redoute, qui a octroyé 30 bourses en 2005 à des élèves boursiers, étudiant en ZEP et ayant au moins 14 de moyenne. La loi Fillon prévoit, quant à elle, de débloquer 4,7 millions d'euros pour financer le développement des bourses attribuées aux élèves boursiers titulaires d'une mention au brevet ou remarqués pour leurs efforts scolaires. Leur nombre devrait avoisiner les 45 300 en 2006-2007, avec un montant revalorisé (+ 25 euros, soit 800 euros à la rentrée 2006). Le royaume de la méritocratie est frappé de consanguinité sociale, les statistiques le serinent depuis des lustres: les trois quarts des diplômés de troisième cycle universitaire et des grandes écoles ont au moins un parent cadre, les enfants d'ouvriers ne sont que 5% dans les grandes écoles - contre 12% à l'université. Plus on monte dans la hiérarchie scolaire, plus le milieu s'embourgeoise. Bref, "le système fonctionne comme une colonne à distiller, plus ségrégative que sélective", comme le dit l'inspecteur général Claude Boichot, chargé par Gilles de Robien de réfléchir à la diversification sociale en prépa. Propulser des jeunes talents en friche On assiste aujourd'hui à une prise de conscience générale. Ici et là, des initiatives bourgeonnent pour propulser de jeunes talents laissés en friche dans les quartiers relégués, des profils qui tranchent avec ceux des "héritiers", coulés dans le moule dès le berceau. Le 12 septembre, François Goulard, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, et Azouz Begag, ministre délégué à la Promotion de l'égalité des chances, ont lancé aux universités un "appel à projets", doté de 3 millions d'euros. Elles ont jusqu'à la fin de novembre pour y répondre: tutorat, soutien… "L'idée, c'est aussi d'inclure dans les contrats quadriennaux des universités des objectifs en matière d'égalité des chances: nous donnerons plus de moyens à celles qui auront des politiques spécifiques sur ce sujet", déclare François Goulard à L'Express. "Cet appel est un signal fort, admet Yannick Vallée, patron de la Conférence des présidents d'université (CPU). Mais, avec nos moyens actuels, on ne pourra pas encadrer nos étudiants les plus fragiles. Les difficultés rencontrées à Rouen ou à Grenoble II reflètent une situation plus générale." De leur côté, sur le modèle de l'Essec, pionnière en la matière, 57 grandes écoles se lancent, cette rentrée, dans le tutorat: des étudiants accompagneront, dès la seconde, 500 lycéens prometteurs et défavorisés. Histoire de lutter contre la ségrégation sociale, qui, selon la sociologue Marie Duru-Bellat, est "à son apogée dans les plus grandes écoles, qui scolarisent environ 1% d'une classe d'âge". Le Conseil d'analyse de la société, présidé par Luc Ferry, en appelle à son tour à généraliser les expériences de Sciences po ou de l'Essec, prônant une "approche républicaine de la discrimination positive". En fait, la réprobation unanime devant la "discrimination négative" se double d'un pugilat sémantique sur fond de hantises communautaires dès lors que l'on aborde son pendant "positif". Introduire des quotas - prohibés par la Cour suprême aux Etats-Unis depuis 1978 - ébrécherait l'égalitarisme républicain. Pourtant, l'idée de "donner plus à ceux qui ont moins" a déjà préludé à la naissance, en France, de zones d'éducation prioritaire (ZEP) en 1982 - identifiées par des critères sociaux et scolaires, non de race ou de sexe. Vingt ans plus tard, l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris surenchérit en créant pour des lycéens de ZEP un examen spécifique. Sciences po, il est vrai, est très connoté: 17% des étudiants viennent des 2% des familles les plus nanties de France.
Des collèges ghettos C'est une étude statistique, inédite, accablante, sur un sujet encore tabou à l'école de la République: l'existence, en son sein, d'un "apartheid scolaire", titre choc du livre de Georges Felouzis, Françoise Liot et Joëlle Perroton qui paraît le 7 octobre au Seuil. Ces sociologues ont mené une enquête sur le choix des établissements par les familles, dans l'académie de Bordeaux. A des lieues des discours officiels sur l'école qui gomment les différences communautaires, ils décrivent un monde "très fortement marqué par l'ethnicité […] en rupture totale avec les fondements les plus universalistes du collège unique". 10% des collèges scolarisent plus de 40% des élèves issus du Maghreb, d'Afrique noire et de Turquie - soit huit fois plus que la moyenne académique! De vrais "ghettos" où les élèves cumulent handicap scolaire et milieu souvent défavorisé. Cette ségrégation ethnique, qui encourage la "spirale identitaire", puise dans la ségrégation urbaine et surtout dans l'évitement de la carte scolaire par les familles, une fuite qui gagne les classes populaires. Faute d'indicateurs suffisants sur les origines, les auteurs ont rusé pour étudier la répartition des 144 000 collégiens: ils l'ont fait à partir de leur prénom… La méthode est critiquable. Mais le livre éclaire les ressorts du communautarisme et les discriminations, dont chacun sait qu'elles continuent de prospérer, sans entraves. Il faut que le lycée ait passé une convention avec la Rue Saint-Guillaume pour que ses élèves soient présentés: ils étaient sept établissements en 2001, ils sont 23 aujourd'hui. "Nous regardons les performances scolaires de chaque élève, mais aussi sa personnalité et son potentiel, souligne Cyril Delhay, responsable du programme. Chaque année, on retrouve certains de ces étudiants parmi les meilleurs de leur promo, même s'ils n'avaient que 12 au bac." 189 élèves ZEP ont été admis en quatre ans (17 en 2001, 57 en 2005). De 50 à 70% d'entre eux sont enfants de chômeurs, d'ouvriers et d'employés. Et les deux tiers ont au moins un parent né à l'étranger. S'agit-il d'un concours au rabais? "Une nouvelle voie d'accès parmi les 13 procédures de sélection", tranche le directeur, Richard Descoings, familier des plaidoyers pour la diversité. Et l'IEP de Lille, qui a créé un concours spécifique en deuxième année pour les BTS, vient de souscrire à la démarche. Moins connue mais tout aussi audacieuse, la prépa spé-IEP du lycée Thiers, à Marseille, est parrainée depuis 2002 par l'IEP d'Aix-en-Provence. Et réservée à des élèves issus de lycées classés en ZEP. "C'est de l'intégration positive, qui ne touche pas au concours, explique le proviseur du lycée, Pierre-Jean Bravo. Je souhaiterais tout de même qu'on remplace la note du bac, pénalisante pour ces jeunes, par d'autres épreuves à l'entrée à l'IEP." L'éclosion n'a pas été facile. "Il fallait donner leur chance aux très bons élèves de ces lycées, créer des conditions d'études privilégiées pour ceux qui en sont privés. Il a fallu convaincre le rectorat et l'expliquer aux parents des bacheliers des autres lycées." Les cours sont assurés par des professeurs de ces lycées de ZEP et par des enseignants de prépa. Résultat: deux admis en IEP sur une quinzaine de candidatures. "Les autres passent en deuxième année de fac, où ils ont tous réussi." La voie alternative: le tutorat Autant dire que, quand Nassuf Djailani a posé les pieds au lycée Thiers - dont le palmarès a gratifié en célébrités les rues de Marseille et le gotha entrepreneurial - il s'est senti un peu "en décalage". "Ce n'est pas marqué sur ma face que je suis français, raconte-t-il avec humour. On était deux Noirs chez les "fils de…". Et puis les profs nous ont mélangés avec les autres prépas, pour les colles. Quand ils faisaient des bourdes, on ne les ratait pas. Ça égalisait les rapports! Et on s'est bien intégrés." Lui n'a pas eu l'IEP mais l'IUT de journalisme de Bordeaux. Et il vient de décrocher le prix Bayard des jeunes journalistes. Sujet: "Fils de…". Ni coup de boutoir dans le moule français ni concours revisité, l'Essec a donc choisi, elle, la voie alternative du tutorat. "Les jeunes défavorisés doutent d'eux-mêmes et ne connaissent pas les grandes écoles, souligne Thierry Sibieude, responsable du programme. Il faut d'abord lutter contre l'autocensure et leur délivrer un bagage, de la seconde à la terminale, qui les aide à se projeter dans le supérieur." Chaque mercredi après-midi, des étudiants bénévoles de l'Essec coachent des jeunes sélectionnés parmi les meilleurs et les plus défavorisés, encadrés par des profs de lycée. Au menu: culture générale, cours de "codes sociaux", sorties culturelles, immersion d'un jour en entreprise… Depuis 2003, 85 lycéens ont bénéficié du programme. Bilan de la première "promo": sur 23, 5 ont abandonné, 7 sont en prépa, 3 à la fac, 1 en DUT, 2 dans une école du groupe Essec, 3 ont raté le bac… Ce système ne garantit pas l'entrée dans l'école. "Le tutorat ne doit être ni du patronage ni une BA!" souligne Marie Reynier, directrice générale de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam). Et le modèle Essec est désormais relayé par 57 établissements de la très élitiste Conférence des grandes écoles, qui ont signé en janvier une charte sur l'égalité des chances. "Il n'y a pas de modèle absolu" C'est un choix pragmatique, admet Marie Reynier: "Une politique plus volontariste coûterait très cher en enseignants…" HEC, qui a accru de 45% son budget "bourses" il y a deux ans, envoie le mois prochain ses étudiants, avec ceux d'autres écoles, coacher 20 jeunes de l'académie de Versailles. Supélec commence en janvier 2006, en partenariat avec Centrale. Depuis l'an dernier, l'Insa de Lyon arpente trois lycées de la banlieue pour encourager les jeunes à se présenter, en dispensant les boursiers de droits de candidature - la pompe s'amorce: 11 admis en juillet. Et le dispositif, comme ceux de Sciences po ou de l'Essec, a des effets de levier dans les lycées, où les candidatures se multiplient. Marie Reynier expérimente, pour sa part, encore une autre stratégie, dite "du diplôme intermédiaire". "En janvier, nous allons faire passer à des lycéens de ZEP des tests d'aptitude, non académiques. Ils suivront un programme commun à l'Ensam et à l'IUT de Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) pour se préparer au concours de l'école. Avec la garantie de décrocher, en cas d'échec, le DUT, sorte de parachute professionnel." Elle n'exclut pas non plus de créer une prépa réservée aux lycéens de milieu modeste, dans les murs mêmes de l'Ensam. Dans La République et sa diversité (Seuil), Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS, évoque une autre piste, plus conforme aux canons de la méritocratie: réserver des places en prépa ou en IEP à environ 7% des meilleurs bacheliers de chaque lycée, à l'image de ce qui se pratique au Texas. "Tout le monde aurait sa chance, y compris les élèves exclus des programmes Essec ou Sciences po. Et cela n'empêche pas le tutorat…" Qu'il faut doper le plus tôt possible, sous toutes ses formes, insiste l'inspecteur général Claude Boichot. "SFR, par exemple, a placé des tuteurs auprès de 90 élèves en prépa aux écoles d'ingénieurs." Dans ses propositions au ministre, Boichot suggérera sans doute aussi de développer les prépas ouvertes aux bacheliers technologiques, au taux élevé de boursiers… D'autant que, chaque année, 2 000 places restent vacantes dans les écoles d'ingénieurs. Le débat entre les tenants de l'accompagnement de lycéens défavorisés et ceux des concours spécifiques est loin d'être clos. "Il n'y a pas de modèle absolu, observe le ministre François Goulard. Cela dit, je souhaite vivement que se développent des cursus complets allant jusqu'à l'entrée dans l'école, et non pas seulement une aide à passer des concours." Dans le plus grand secret, certaines grandes écoles planchent justement sur des concours pour publics spécifiques… Au lycée Edmond-Rostand de Saint-Ouen-l'Aumône (Val- d'Oise), la proviseure Patricia Orsi a choisi, elle, le cumul. Déjà en cheville avec Sciences po, elle vient d'intégrer le programme Essec. "Et pourquoi pas?" Car la pente est encore raide. Et l'ascenseur bien verrouillé.
Blandine Kriegel "L'intégration par les femmes" propos recueillis par Boris Thiolay Le 26 janvier, le Haut Conseil à l'intégration (HCI) remet au Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, son rapport sur "Le contrat et l'intégration" réaffirmant les droits individuels des personnes issues de l'immigration. Blandine Kriegel, présidente du HCI, expose son point de vue à L'Express L'intégration à la française connaît des ratés. Pour quelles raisons? Le phénomène le plus évident est que les jeunes issus de l'immigration subissent trois fois plus le chômage que les autres personnes de leur classe d'âge. Mais il faut sortir de la logique de la culpabilité. Ni les immigrés ni la société française ne sont responsables du retard accumulé dans la compréhension de l'immigration. Pendant des décennies, la société et les responsables politiques ont pensé que les immigrés étaient ici seulement pour travailler et qu'une fois leur temps accompli ils repartiraient chez eux. La politique d'accueil se résumait à un accompagnement social des travailleurs immigrés et de leur famille. On a pris tardivement conscience que ces familles restaient, faisaient souche et que le problème était non seulement le travail, mais leur place dans la cité. Dès lors, des logiques antagonistes se sont succédé. La première, spontanée, a été celle de l'assimilation: "Ces gens doivent, comme les vagues d'immigration précédentes - Espagnols, Italiens, Portugais - s'assimiler, devenir comme nous." Et on a mis en accusation les immigrés: "S'ils ne s'assimilent pas, ce sont eux les coupables." La deuxième logique, que l'on doit en particulier à Martine Aubry, a renversé l'incrimination: c'est la société française qui est coupable, parce qu'elle pratique des discriminations. Au terme d'intégration, on a dès lors préféré celui de lutte contre les discriminations - par ailleurs réelles - au logement, à l'embauche, etc. Et vous, que suggérez-vous? Une refondation de la politique d'intégration qui se caractérise par trois points essentiels. 1. Mettre en place une politique contractuelle, proposée par François Fillon, une politique qui équilibre la générosité et la fermeté: l'Etat s'engage à offrir aux immigrants des formations linguistiques, civiques - c'est une nouveauté - et un suivi social. En retour, les immigrés doivent s'engager à respecter les lois de la République. C'est un contrat réciproque qui doit permettre de sortir de la logique d'incrimination perpétuelle. 2. Le HCI a proposé d'emblée une politique positive. Il y a une importante classe moyenne issue de l'immigration qui a réussi, mais elle n'est pas suffisamment visible ni soutenue. Le principe que nous retenons est celui d'une promotion positive, reposant sur le mérite individuel: l'Etat doit montrer l'exemple en promouvant des gens selon leurs compétences. 3. Il faut appliquer une politique plus sensible au droit individuel de la personne (essentiel pour les femmes), intégrer et assurer la promotion sociale de ces nouveaux citoyens, un par un et non par groupes ethniques ou religieux.
"Dès leur arrivée en France, on doit avertir les femmes de leurs droits, leur rappeler l'égalité entre les sexes" Le voile est-il un frein à l'intégration? Le voile peut représenter l'expression d'une liberté de croyance, mais il est aussi le symbole de l'inégalité entre hommes et femmes. C'est l'arbre qui cache la forêt de l'ensemble des problèmes que peuvent vivre les femmes issues de l'immigration. Mais également un véritable problème de santé publique. Lorsqu'un médecin homme ne peut plus approcher une femme ou une élève, c'est toute la santé publique qui est déstabilisée, car ses règles s'appliquent à tous ou à personne. Pendant des années, on a passé sous silence des faits intolérables. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait 35 000 excisions par an en France, que 70 000 jeunes filles soient concernées par les mariages forcés. Lorsqu'il s'agit de mineures, voire de jeunes filles de 12 ans, le mariage forcé peut s'apparenter à un viol... Ayons le courage de regarder en face ces drames indignes d'une société républicaine et démocratique. Que préconisez-vous pour défendre les droits des femmes? Il faut cesser de les considérer seulement comme des épouses ou des membres de la famille. Elles sont aussi des individus. Dès leur arrivée en France, on doit les avertir de leurs droits, leur fournir une formation civique rappelant l'égalité entre les sexes. Il est primordial que le contrat d'accueil et d'intégration, symbole de l'adhésion des arrivants aux lois républicaines, soit remis personnellement aux femmes, sans passer par leur mari. Même chose pour le titre de séjour. Le contrat d'intégration est une grande opération d'intervention républicaine. Auparavant, on expliquait aux arrivants le fonctionnement de l'ANPE et des Assedic... mais rien de ce qui concerne la loi républicaine ou la culture française. Dorénavant, on leur offre la possibilité d'apprendre à parler notre langue, de comprendre les lois et la Constitution française. C'est un moyen de prévenir la tentation du communautarisme. Mais la France a passé des conventions avec des pays qui traitent les femmes en inférieures... Le Haut Conseil a demandé que ces conventions bilatérales soient dénoncées lorsqu'elles bafouent le principe constitutionnel d'égalité. Dans certains pays, le Code de la famille est très défavorable aux femmes, considérées comme mineures sur le plan civil. Leur témoignage vaut la moitié de celui d'un homme, un mari peut répudier son épouse, mais celle-ci ne peut divorcer, une femme ne peut pas obtenir l'autorité parentale en cas de séparation... Tout cela est absolument contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux textes adoptés par l'Union européenne. Enfin, pour éviter aux femmes ayant la double nationalité l'application du statut défavorable en vigueur dans le pays d'origine, nous avons demandé que l'on fasse prévaloir la loi française. Nous avons été suivis par le ministère des Affaires étrangères. Lorsqu'une femme se marie dans le pays d'origine de son époux, les consuls français demandent à voir les épouses pour vérifier qu'il ne s'agit pas de mariages forcés: on doit pouvoir l'annuler. Aux yeux du HCI, la vigilance doit être renforcée. Le sort des femmes est aussi la pierre de touche de l'intégration. (Express 26/01/2004)
Rebonds Les jeunes des quartiers difficiles ne voient du "modèle social français" qu'une grise prison. Piégés par la République Par Didier LAPEYRONNIE et Laurent MUCCHIELLI mercredi 09 novembre 2005
les émeutiers sont seuls. Ils n'ont aucun soutien politique. Il est vrai qu'ils sont difficilement défendables. Ils sont agressifs et violents. Ils ont souvent un présent ou un passé de délinquants. Ils brûlent des voitures et affrontent durement la police. Les photos des journaux et les reportages télévisuels nous abreuvent de ces images de véhicules ou de bâtiments en flammes autour desquels dansent des silhouettes menaçantes. Images inquiétantes, toutes prises derrière le paravent policier, du point de vue de l'ordre et de la loi, mais qui nous interdisent à jamais d'avoir le point de vue inverse, le point de vue de celui qui fait face à la police et à l'ordre de la bonne société. Sous les capuches rabattues de leur jogging, les "jeunes " sont sans visage, anonymes et sans parole. Comme l'a rappelé le lynchage d'Epinay-sur-Seine, la violence écoeurante dont ils usent semble bien le signe qu'ils sont hors de notre société, des "sauvageons" ou une "racaille" dont il faut se protéger et surtout dont il faut protéger les "braves gens" qui ont le malheur de vivre dans les mêmes cités et qui, eux, voudraient "s'en sortir" et "s'intégrer". N'ayant rien à dire, si ce n'est exprimer le mélange d'émotion et de rage qui les a saisis à la suite de la mort de Ziad B. et Banou T., puis des propos du ministre de l'Intérieur, ils seront maintenant l'objet de tous les discours et de tous les usages politiques, un instrument destiné à justifier la répression et l'appel toujours plus pressant à la loi. L'ordre et la justice, a répondu le gouvernement après avoir liquidé les emplois jeunes et la police de proximité, le budget des associations et de la politique de la ville. Ces jeunes sont ainsi enfermés dans le rapport exclusif à la norme et à la morale, irrémédiablement marginalisés et construits comme des problèmes : ceux qu'ils subiraient et ceux qu'ils feraient subir. Et la violence dont ils usent, par effet de sidération, renforce le cercle vicieux et justifie qu'ils soient tenus à l'écart. Certes, l'émeute libère la colère et la violence, les petits délinquants s'en donnent à coeur joie. Pourtant, ces "violences urbaines" ne sauraient être réduites à la seule question de la loi et de la norme. Dans les années 1960, il aurait été absurde de ramener les petits groupes de Black Panthers à de simples délinquants. Il y a un siècle et demi, Gavroche, qui effrayait tant la bonne société, aurait pu mourir en volant le portefeuille d'un bourgeois aussi bien que sur une barricade. L'émeute et la violence urbaine charrient toutes les déviances qu'elles mêlent au sentiment d'une humiliation démultipliée. Une humiliation scolaire. L'école n'est pas vécue par une partie de ces jeunes comme un instrument de promotion mais comme le lieu d'une sélection qui transforme leur destin social en autant d'humiliations personnelles. A leurs yeux, la promotion par l'école est réservée à d'autres, qui savent tirer tous les bénéfices et qui sont généralement des "Blancs" quand eux sont généralement des jeunes issus de l'immigration. Ne serait-ce pas ces mêmes "jeunes de banlieue" qui, au mois de mars dernier, dépouillaient et frappaient les lycéens venus manifester pour défendre leur école ? Une humiliation économique. Tandis que nous commentons des hausses ou des baisses d'un taux de chômage national entre 8 et 9 %, la situation d'une partie de la jeunesse est sans commune mesure. Le taux de chômage des jeunes à Clichy-sous-Bois tourne autour de 30 %. Et si l'on cible les jeunes nés de père ouvrier et sortis de l'école sans diplôme ou avec un simple CAP, le taux de chômage dépasse les 50 % dans la plupart de ces quartiers qui s'enflamment de nouveau aujourd'hui. Sans emploi, impossible d'accéder à un logement et d'envisager de pouvoir fonder sa propre famille. La vie "normale" est interdite. Une humiliation quotidienne dans les rapports avec la police. Les pouvoirs publics ne mesurent sans doute pas à quel point cette interaction est devenue au fil des ans un élément du problème. Lorsque des policiers presque tous "blancs" interviennent sur des populations qu'ils ne connaissent pas, contrôlent indistinctement tous ceux qui leur paraissent "suspects" (qui sont presque tous black ou beurs) et sont capables de faire preuve de la même violence verbale et physique que les délinquants qu'ils voudraient arrêter, alors il n'est pas surprenant que cette relation quotidienne soit perçue par ces jeunes comme le symbole d'une oppression et d'un racisme. Une humiliation politique. Après l'échec du "mouvement beur" du début des années 1980, et tandis que les militants politiques et syndicaux ont déserté les quartiers populaires, la jeunesse de ces quartiers ne parvient pas à faire entendre sa parole dans l'espace politique. Pire : quand elle tente de s'exprimer et de s'affirmer d'une autre façon, ceci se retourne contre elle. Son engouement pour le rap est traité avec crainte ou condescendance. Son affirmation identitaire est accusée d'être une forme de "communautarisme" qui menacerait l'unicité de la République. Son affirmation religieuse est criminalisée au nom de la peur du terrorisme ou de la liberté des femmes. Dans ces conditions, est-il si difficile de comprendre que cette jeunesse a avant tout besoin de reconnaissance et de dignité (le fameux "respect") ? Et lorsque l'émeute éclate et que la violence se déchaîne, est-il si difficile de comprendre qu'à côté des incendies de voitures les jeunes s'en prennent aussi aux institutions : police, transports collectifs, antennes ANPE, centres sociaux et même écoles ? Pour eux, ces services publics ne sont plus guère des instruments d'amélioration de la vie sociale et plus du tout des vecteurs d'intégration, ce sont des aides qu'ils finissent par rejeter comme de la charité, quand ce ne sont pas à leurs yeux des obstacles à franchir, voire des frontières qui les maintiennent à l'écart de la "vie normale" à laquelle ils n'osent plus rêver. Du "modèle social français", ils ne connaissent que le chômage ou l'intérim, les emplois aidés et la dépendance aux services sociaux, tout un univers "gris" protégeant de la misère mais enfermant dans la précarité et semblant n'avoir aucune issue. Cet univers est alors vécu comme un "piège" dans lequel ils survivent loin de la "vie normale" des "nantis", et dans lequel ils ont le sentiment que leur vie s'en va sans pouvoir être véritablement vécue. Ils se sentent coincés dans une "nasse" qui sert finalement à les maintenir à l'écart d'une société qui ne veut pas d'eux. Aussi, les mots de la République se vident-ils de leur sens et sont-ils perçus comme les masques d'une société "blanche" qui racialise et humilie sans même vouloir le reconnaître. Ne nous rappelle-t-on pas régulièrement que la France possède un modèle d'intégration que tout le monde nous envie, que la France n'est pas l'Amérique ou la Grande-Bretagne libérales et n'a pas de ghettos ? Qui cherche ainsi à se rassurer ? Qui ne veut pas comprendre que ces jeunes, eux, ont le sentiment de vivre dans des ghettos ? Alors les mots finissent par déchaîner la rage puisque leur sens n'est plus partagé et qu'ils ont perdu leur contenu. Centrée sur la défense du "modèle social français" et de plus en plus tentée par le repli national autour des "services publics" et des "petits fonctionnaires", réaffirmant sans cesse les vertus d'une République égalitariste pourtant en faillite, devenue adepte d'une "laïcité" pure et dure hostile à tout "communautarisme", la gauche elle-même a abandonné le monde populaire et celui des immigrés. A travers elle, les "classes moyennes" et les "fonctionnaires" monopolisent l'espace public et défendent leurs intérêts, excluant de fait toute forme alternative de représentation et d'expression : combien de "jeunes de banlieue" dans les défilés pour défendre le "service public" ? Combien travaillent dans ces mêmes services publics (police, justice, école) ? Combien de citoyens "issus de l'immigration" dans les instances représentatives ? L'émeute naît ainsi d'abord du vide politique. La violence surgit quand la politique est absente, quand il n'y a plus d'acteurs sociaux ni même de conflit, quand il ne reste plus que la défense de l'ordre et de l'identité nationale. Certes, il est urgent de rétablir un minimum de politique sociale, de lutter contre les discriminations, d'en finir avec des pratiques policières indignes d'une démocratie et surtout de stopper cette ségrégation urbaine qui structure de plus en plus nos modes de vie. Mais les émeutes nous rappellent qu'il est avant tout indispensable de reconnaître et de respecter toute une population, de considérer qu'elle ne constitue pas un problème mais qu'il s'agit bien de citoyens de notre pays. Face à un gouvernement qui n'a que l'ordre à la bouche, le travail de la gauche aujourd'hui devrait être de faire entrer cette parole dans l'espace public et de lui donner un sens politique. Elle ne semble pas en prendre le chemin. http://www.liberation.fr/page.php?Article=337030
Nos ghettos vus d'Angleterre, par Tariq Ramadan LE MONDE | 08.11.05 | 14h56 • Mis à jour le 08.11.05 | 14h57
Les émeutes de Clichy et des banlieues avoisinantes suscitent un très vif intérêt en Angleterre. On cherche à comprendre les "défaillances du système français d'intégration" . Il s'agit du scénario inversé de l'été dernier où, après les attentats du 7 juillet à Londres, on analysait en France les points de fracture du multiculturalisme britannique. Tout se passe comme si, de chaque côté de la Manche, on essayait à tour de rôle de se rassurer sur ses propres doutes en se penchant avec force certitudes sur les déficiences de l'autre. La comparaison sur le mode : "Quelle société a mieux réussi le processus d'intégration ?" nous paraît inopérante. Le modèle français n'est pas meilleur ni moins bon que le modèle anglais. Dans les faits, chaque société, compte tenu de son histoire, de sa culture et de sa psychologie collective, a développé des mécanismes d'intégration et l'on y trouve des acquis et des défaillances. Chaque société a son génie et elle doit s'appuyer sur sa créativité politique et collective pour résoudre les crises qui la traversent. Ce qui devrait nous intéresser au premier chef tient à l'analyse de certaines similitudes qui, dans les termes des débats ou les politiques gouvernementales, provoquent dans ces deux sociétés (comme ailleurs en Europe) des tensions sociales, culturelles ou religieuses. En amont, on trouve partout discutée la question de l'islam et de "l'intégration des musulmans". Que ce soit autour des questions de la laïcité ou de l'identité, on semble obsédé par l'idée que l'islam fait problème, qu'il représente une menace pour la paix sociale. On observe un jeu politique très malsain qui cherche à tirer un profit électoral de ces peurs en banalisant des thèmes qui étaient hier l'apanage des partis d'extrême droite : discours sécuritaire, préférence nationale, politique discriminatoire qui se confond avec la question de l'immigration. Le retour obsessionnel des thèmes de l'intégration et de l'identité est la preuve d'un double phénomène : d'une part, de l'incapacité d'entendre les voix musulmanes qui depuis des années affirment que l'islam ne fait pas problème et que des millions de musulmans assument parfaitement le fait d'être européens, musulmans et démocrates. D'autre part, et plus gravement, on y perçoit, à gauche comme à droite, l'absence de volonté politique de traiter des vraies questions sociales. Entretenir la peur pour récolter des voix est plus facile que de proposer des politiques courageuses en matière éducative et sociale. Que ce soit sur des bases ethniques ou économiques, les deux modèles, français et britannique, ont construit de véritables ghettos. Dans le système anglo-saxon, la nature du lien ethnico-social régule davantage les relations interpersonnelles à l'intérieur des "communautés importées" et provoque donc moins de violence sociale, mais il n'en demeure pas moins que les communautés sont isolées et ne se mélangent pas. Les banlieues françaises comme les quartiers résidentiels sont de véritables ghettos sociaux et économiques. Le discours politique français voue aux gémonies la référence au "communautarisme religieux" sans voir que le véritable "communautarisme" qui mine et fracture sa société est de nature socio-économique. Or il se trouve que les Noirs, les Arabes et les musulmans sont proportionnellement les plus pauvres et les plus marginalisés. Ce que l'Angleterre a déterminé par l'ethnie, la France l'organise par le porte-monnaie. On ne dira jamais assez combien les deux modèles s'alimentent de conceptions xénophobes et les nourrissent. Dans ces sociétés morcelées, les discours entretenus sur les Asiatiques, les Turcs, les Arabes, les Noirs et les musulmans tiennent de la xénophobie, et les politiques discriminatoires en matière d'emploi et de logement sont du racisme institutionnalisé. Les causes sont certes multiples, de la peur à l'ignorance, mais les faits sont là et exigent une politique éducative et civique volontariste. Le coeur des débats n'est pas religieux mais social. Contre la ghettoïsation et le racisme, nous avons besoin d'une nouvelle créativité politique qui ose et qui risque. Ce n'est malheureusement pas ce que l'on voit poindre à gauche comme à droite. A celles et à ceux qui s'affirment français ou britanniques, on renvoie l'image qu'ils sont d'abord des Arabes, des Asiatiques ou des musulmans. Comment des individus, marginalisés socialement et/ou psychologiquement, pourraient-ils ne pas être attirés par les discours littéralistes ou radicaux qui leur expliquent qu'ils sont rejetés pour ce qu'ils sont et qu'il n'y a d'autre voie que celle de la confrontation des identités et des civilisations. Les discours récurrents sur l'islam et l'intégration donnent raison à ceux qui, du côté musulman, islamisent tous les problèmes et, de l'autre, alimentent l'idée d'un irrémédiable conflit avec l'islam. Enfermés jusqu'à l'étouffement dans les débats aussi passionnés que stériles autour de "qui est Français", "qui est British", on n'entend plus les revendications sociales légitimes de citoyens désormais français et britanniques. Leur violence, usant de moyens illégitimes, est une réaction malheureusement compréhensible face à cette surdité : à force d'imposer un faux débat sur l'intégration pour éviter le vrai débat sur l'égalité des chances et le partage des pouvoirs, on récolte ce que certains semblent machiavéliquement désirer : stigmatiser des appartenances, entretenir la peur, monopoliser et pérenniser leur pouvoir symbolique autant qu'économique et politique. L'histoire leur apprendra, bon gré mal gré, à partager. Tariq Ramadan islamologue de nationalité suisse, est actuellement professeur invité au Saint Antony's College de l'université d'Oxford. TARIQ RAMADAN Article paru dans l'édition du 09.11.05
Politique de la ville: trente ans de traitements d'urgence Besoins de logements, violences à répétitions, c'est à partir de 1975 que les gouvernements commencent à se pencher sur les problèmes urbains. Retour sur trois décennies d'actions menées sans cohérence. par Tonino SERAFINI, Patricia TOURANCHEAU et Brigitte VITAL-DURAND QUOTIDIEN : mardi 08 novembre 2005 HLM et ZUP dans tous leurs états, les habitants oubliés. L'intégration des jeunes beurs à marche forcée. La création d'un grand ministère. De 1975 à 2005 : visite de la politique de la Ville en quatre grandes étapes. Sur le même sujet * Sciences-Po, exemple peu suivi * Vaulx s'est reconstruit sur ses cendres * De la fin des barres à la rénovation * "La cité enferme, favorise les phénomènes de bande" * "C'est avec les pires qu'il faut parler" Le traitement par le béton Dans les années 1960-1973, le béton coule à flots dans la périphérie des grandes villes. On construit jusqu'à 600 000 logements par an. Les grues sont partout pour juguler la crise du logement, pour résorber les bidonvilles comme à Nanterre ou à Villeurbanne, ou voit le jour le ministre Azouz Bégag. On bâtit aussi pour loger les rapatriés d'Algérie et les travailleurs des bassins industriels qui font appel à une main d'oeuvre étrangère abondante. C'est ainsi que naît le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie où "7 000 logements sont créés de toutes pièces sur le terrain d'un ancien aérodrome", rappelle Pierre Bédier l'ex-maire (UMP). Pour mener ses programmes, l'Etat créé des ZUP (Zone d'urbanisation prioritaire) souvent dénuées de commerces ou de services publics, vite rebaptisées "cité dortoirs". La plupart d'entre elles deviendront au fil des années des ZUS (Zones urbaines sensibles), objet de la politique de la ville. Traduction aujourd'hui, 717 quartiers représentant 4,5 millions d'habitants et une addition de difficultés : chômage de masse de 20 à 30 %, spécialement parmi les jeunes, familles aux revenus précaires, échec scolaire, déliquance... Tous les voyants sont au rouge. Le tout donnant aux habitants de ces quartiers le sentiment d'être victimes de discriminations et d'injustices. A l'origine : le premier choc pétrolier et la progression du chômage frapperont en premier lieu ces quartiers, habités souvent par des salariés non-qualifiés sacrifiés sur l'autel des restructurations industrielles. Les parents perdent leur statut et leur enfants leurs repères. Face à cette réalité, la politique de la Ville consistera en une série d'atermoiements. On met d'abord le cap sur le bâti et la réhabilitation des immeubles. Dès 1977, Jacques Barrot, secrétaire d'Etat au Logement du gouvernement Barre, lance un Plan banlieue avec de conventions Habitat et vie sociale qui financent des programmes de rénovation de HLM. Ce traitement de problèmes humains par l'urbain est manifestement très ancré dans les esprits, puisque la loi Borloo d'août 2003, dotée pourtant d'un budget de 30 milliards d'euros sur cinq ans, est totalement centrée sur la question des tours et des barres qu'il faut faire tomber à coup de bulldozer. "Donner un meilleur cadre de vie aux gens, personne ne contestera ça. Mais on ne règle en rien les problèmes de fond des familles, c'est à dire l'emploi, l'insertion, et les questions éducatives", critique une responsable associative de Seine-Saint-Denis, département particulièrement touché par la flambée de ces derniers jours. Une flambée qui en rappelle d'autres. Cela a commence il y a presque un quart de siècle, en juillet 1981. C'est "l'été chaud" dans la banlieue lyonnaise. Dans la cité des Minguettes, à Vénissieux, des jeunes se livrent à des rodéo et brûlent 250 voitures. L'Etat a sa réponse. Achevées dix sept ans plus tôt (en 1966), les Minguettes vont subir un premier traîtement de choc. Trois tours sont dynamitées en 1983, dont une en présence du président Mitterrand. A l'époque, on considère que la France compte 22 quartiers à "problème". Mais dans les mois suivant, la liste va très vite grossir pour atteindre les 148. Et comme les jeunes sont le fer de lance de la révolte, on ajoute à l'urbain une couche de politique éducative. En 1981, Alain Savary, ministre de l'Education, annonce la création de Zones d'éducation prioritaires (ZEP). Le dispositif est prévu pour durer quatre ans et concerne 363 ZEP. Vingt-quatre ans plus tard, 911 ZEP scolarisent 20 % des élèves. Dernier pilier : la sécurité. Mais là, au grès des ministres successifs, on passera du plan de prévention de la délinquance concocté en 1982 par Gilbert Bonnemaison, député-maire PS d'Epinay-sur-Seine, (avec 64 axes, contrats d'action dans les quartiers) aux politiques axés sur la répression de Pasqua (1986-1988) ou de Sarkozy. En juillet 1991, Delebarre (lire ci-contre) fait voter la loi d'orientation pour la ville (LOV), qui oblige les communes ayant peu de HLM sur leur territoire à en construire, afin de mieux répartir les logement sociaux et d'éviter la constitution de ghettos. Une loi qui sera vidée de sa subtance par la gouvernement Balladur. Celui de Juppé a sa réponse, libérale : il crée 41 Zones franches urbaines (ZFU) pour inciter les entreprises à s'installer dans des ZUS (exonération d'impôt sur les bénéfices, sur les charges sociales). 700 quartiers sont classés ZUS. Un plan de "100 000 emplois-ville" destinés aux 18-25 ans est annoncé. Aucun bilan ne suivra. Les soubresauts de la politique d'intégration La gauche crée en 1983 le Conseil national de prévention de la délinquance (CNDP), puis décline la structure dans les départements, dans les villes. Mais ça ne suffit pas. Dans les quartiers, fils d'Algériens et de Marocains sont victimes de racisme. Le 13 juillet 1983, à la Courneuve, un habitant excédé tue un enfant de 9 ans, Toufik, tiré comme un pigeon. A l'automne, une quinzaine de jeunes des Minguettes acteurs de l'été chaud de 1981 organisent la Marche des Beurs et scandent "La France, c'est comme une mobylette, pour avancer, faut du mélange !". La manifestation "pour l'égalité et contre le racisme" rassemble 100 000 "black-blanc-beur" à Paris, où le Président reçoit les leaders, accorde à tous une carte de séjour et de travail valable dix ans. Ce mouvement spontané de la jeunesse arabe représente un espoir formidable. En octobre 1984 est lancé SOS Racisme, avec le slogan "Touche pas à mon pote". "Mais ces deux références n'ont jamais vraiment gravi les marches du pouvoir : la gauche a raté une occasion incroyable, dit René Rousseau de la CFDT inter-co (logement, pompiers, policiers, AS, etc). Les banlieues ont été traitées comme du social, jamais de manière politique. On a mis les immigrés à l'écart, et on les y a laissés. Les hommes politiques se sont repassés le grisby des banlieues comme une patate chaude." L'arrivée de Charles Pasqua à l'Intérieur en 1986, dans un contexte d'attentats chez Tati, avec la répression des manifestations étudiantes contre la loi Devaquet mort de Malik Oussekine suscitent un climat de tension dans les banlieues. C'est la fin de la prévention. Les "marcheurs" pour l'égalité qui ont y cru finissent "dégoutés par les politique, écoeurés" selon Yazid Kherfi (lire page 10). Les "grands frères" baissent les bras. En 1989, de jeunes musulmans reprennent en main petits toxicos et voleurs, montent des salles de prières, parfois dans des caves. A Vénissieux, Toumi Djaïdja, le héros de la "marche des Beurs" a fait le "retour" à l'islam, tient un atelier de couture, a coupé ses boucles brunes, laissé poussé sa barbe : "Je mène le même combat, j'ai simplement changé d'étendard." A Creil, éclate la première affaire du voile islamique : trois jeunes musulmanes sont exclues de leur collège pour avoir refusé de retirer leur foulard en classe. Jospin, alors ministre de l'Education, temporise : l'école accepte les signes religieux dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun prosélytisme. Petit à petit, des laissés pour compte plongent dans l'intégrisme, soutiennent les "maquis" en Algérie. L'enquête sur les attentats de 1995 révèle l'apparition stupéfiante, parmi les poseurs de bombe, de Khaled Kelkal, 25 ans, petit délinquant de Vaulx-en-Velin, converti à l'islam en prison. En battant le Brésil en finale de la coupe du monde de football, le 12 juillet 1998, l'équipe de France "black-blanc-beur" déclenche un torrent de commentaires triomphalistes sur "l'intégration qui réussit". Trois ans plus tard, le symbole vole en éclat : le 6 octobre 2001, la Marseillaise est sifflée au Stade de France lors de France-Algérie. En 2003, les filles de banlieues de "Ni Putes, ni Soumises" organisent une marche en France, puis l'éclosion, en 2005, du mouvement des Indigènes de la République témoigne que certains ne se sentent pas Français. La loi sur la laïcité qui a interdit le port de foulard à l'école a suscité une incompréhension dans les cités et... quelques vocations de jeunes musulmanes pour se couvrir du hijab. Ainsi, Khadija El-Hakim, habitante d'une petite cité de Paris et soeur ainée de deux frères partis faire le Jihad en Irak (Redouane a été tué au combat à 19 ans) a démissionné de son travail pour porter le voile et sent les siens, arabes, rejetés : "En France, on nous a appellés les beurs, puis les clandestins, les étrangers, les musulmans et maintenant les islamistes, les terroristes." Un ministre pour représenter les banlieues 21 décembre 1990 : les banlieues siègent pour la première fois, et très officiellement, en conseil des ministres. Ces cités, où des violences, saccages, pillages et feux de voitures, viennent encore d'éclater après la mort, en octobre, dans un affrontement avec la police, d'un jeune habitant de Vaulx-en-Velin, ont désormais leur représentant à Paris. Et ce n'est pas n'importe qui : un poids lourd du parti socialiste, Michel Delebarre, qui de plus a rang de ministre d'Etat. La politique de la Ville, jusqu'alors représentée discrètement par le délégué à la Ville, Yves Dauge, est intronisée en grandes pompes. Les 5, 6, 7 et 8 décembre 1990, à Bron, ville voisine de Vaulx et des Minguettes, les DSQ (Développement social des quartiers) sortent de l'ombre. C'est la fin des bonnes intentions : on passe à l'action. Mitterrand annonce, dans son "discours de Bron" qu'il se donne cinq ans pour "réussir la politique de la ville". Le Président ne lésine pas sur les grands mots en lançant la création du ministère de la Ville. L'élu devra être "l'animateur, le pourfendeur, l'avocat, l'intervenant permanent qui attirera l'attention (de ceux) qui ne demandent pas mieux de réussir cette grande aventure mais qui pensent à autre chose, qui ont d'autres soucis, d'autrees compétences". Suit un séminaire gouvernemental, où s'organise un plan de bataille tous azimuts sous l'égide de Michel Rocard, Premier ministre : il y aura 20 mesures pour "changer la ville" dans "quatre cents quartiers". Cette large géographie elle a presque doublé aujourd'hui- dilue le caractère d'urgence et d'exception que préconisait jusqu'alors la politique de la ville dans quelque 150 cités. Mais, à l'époque, les maires en difficulté avec leurs grands ensembles de HLM, rêvaient de la puissante main de l'Etat, et des finances qui bien sûr ne sauraient tarder. Quand Michel Delebarre prend ses fonctions, en 1991, il nomme 13 "sous-préfets à la ville", vigiles en avant-poste dans toutes les préfectures chaudes. L'ancienne Délégation à la ville lui sert d'administration. Quoiqu'étoffée, elle demeure toute petite (une poignée de fonctionnaires). Qu'importe. L'élan était donné, et il venait de haut. Les autres ministres (Logement, Education, Sport, etc) n'avaient qu'à suivre. Six mois plus tard, mai 1991, le Val-Fourré explose après la mort d'un jeune homme asthmatique au commissariat, celle d'une gardienne de la paix renversée par une voiture volée et d'un jeune tué par une balle policière. Le 20 mai 1992, Bernard Tapie succède à Delebarre. Le nouveau ministre de la Ville, qui n'est plus "d'Etat", a à peine le temps de présenter son "plan pour les banlieues", qu'il démissionne le 23, poursuivi par les affaires. Le poste ne va cesser de péricliter. Quand le gouvernement Jospin arrive aux affaires, en 1997, il ne comporte même pas de ministre de la Ville. Claude Bartelone arrivera bien plus tard. Mais en privilégiant toujours le bâti et non les habitants. Depuis 2002, Borloo en a fait son dossier principal. Avec le succès que l'on mesure aujourd'hui.
jeudi 17 novembre 2005
In Politis Banlieues : " Pas de paix sans justice " Clotilde Monteiro Aucun système, ni républicain, ni anglo-saxon, n’est à l’abri des révoltes urbaines quand sont réunis les trois grands facteurs que sont l’injustice sociale, une discrimination raciale, réelle ou ressentie, et la violence policière. Retour sur quelques grandes flambées, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Brixton, Bradford, Watts, South Central, Soweto, les Minguettes ou Clichy-sous-Bois, quels que soient le lieu et l’époque, les violences urbaines ont un terreau commun fait d’abandon social et de concentration ethnique. Il s’y ajoute toujours comme élément déclencheur une violence policière ou une déclaration provocatrice. Le tout aggravé par un sentiment diffus d’impasse et une absence totale de représentation politique. Dans la banlieue de Londres en 1981 (Brixton), au nord de Leeds (Bradford, en 2001), comme au coeur de Los Angeles en 1965 (Watts) ou en 1992 (South Central), sans même parler du township de Johannesbourg (Soweto), ce sont toujours des années de violences quotidiennes faites aux habitants qui débouchent sur ces poussées éruptives. Brixton, 1981. Comme Nicolas Sarkozy, Margaret Thatcher souhaitait, en 1981, " rétablir la loi et l’ordre ", ignorant obstinément les causes profondes de l’émeute. Entre 1978 et 1982, le taux de chômage avait pourtant augmenté en Grande-Bretagne de 300 % ! Mais la Dame de fer décide de renforcer les contrôles policiers pour mater les mécontentements. Dans les quartiers pauvres tels que Brixton (au sud de Londres), les populations antillaises et indiennes subissent la crise de plein fouet ainsi qu’un harcèlement policier aveugle et incessant. À l’instar des provocations verbales de Nicolas Sarkozy aujourd’hui, celles de Margaret Thatcher transforment les problèmes sociaux en problèmes ethniques. En considérant que la misère de ces quartiers ne peut s’expliquer que par la démission de parents laxistes, elle contribue à mettre le feu aux poudres. Les émeutes de Brixton en 1981 sont les affrontements les plus violents qu’aura connus l’Angleterre depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans aucun doute, ce sont ces événements du début de l’ère ultralibérale qui ressemblent le plus aux violences que connaît actuellement la France. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le département de la Seine-Saint-Denis (93), la banlieue d’où sont partis ces affrontements, recense quelque 120 000 demandeurs d’emploi, ce qui représente 17 % de la population active. Et que 18 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Bradford, 2001. Mais beaucoup d’autres révoltes urbaines jalonnent l’histoire récente de la Grande-Bretagne, dont notamment les heurts entre manifestants d’origines indienne et pakistanaise avec les policiers, en juillet 2001, à Bradford, dans le nord du pays. Il y avait eu une centaine de blessés. Watts, 1965. Il y a quarante ans, l’un des quartiers les plus pauvres de Los Angeles, Watts, peuplé à 80 % de Noirs, avait été le théâtre de violentes émeutes. Mais, à l’inverse de la Grande-Bretagne des années Thatcher, les États-Unis connaissent à l’époque une croissance faramineuse qui renforce le sentiment d’injustice dans les quartiers les plus misérables. Aux frustrations ressenties par les Noirs s’ajoutent les propos racistes régulièrement tenus par le chef de la police de Los Angeles. Dans ce contexte explosif, le 11 août 1965, l’arrestation abusive de Marquette Frye, un Noir de 21 ans, va mettre le quartier à feu et à sang. La population élève des barricades, la police est bombardée de briques et de cocktails Molotov. Malgré l’instauration du couvre-feu par l’armée, les émeutes ne cesseront que six jours et 34 morts plus tard. South Central, 1992. La grande métropole californienne n’en est pas quitte avec la violence. En avril et mai 1992, des émeutes et une répression encore plus meurtirère ravageront le quartier pauvre de South Central. La révolte éclate à la suite de l’acquittement prononcé à l’endroit de policiers qui ont tabassé un automobiliste noir, Rodney King, devant la caméra d’un cinéaste amateur. Dès l’annonce du verdict, les manifestants se rassemblent. Leur mot d’ordre, qu’ils ont le mérite de formuler, pourrait servir de cri de ralliement à toutes les émeutes urbaines : " Pas de paix sans justice ! " La répression fera 55 morts, deux mille blessés et un milliard de dollars de dégâts. Lire la suite et l’ensemble de notre dossier dans Politis n° 876 Un entretien ave le philosophe Mathieu Potte-Bonneville Un reportage dans une cité près d’Orléans Quatre économistes répondent à Villepin
jeudi 17 novembre 2005
Une société bloquée Denis Sieffert À chaque lundi sa peine, et son couvre-feu. Une semaine après Dominique de Villepin, et l’annonce d’une disposition martiale peu ordinaire en démocratie, c’était au tour de Jacques Chirac de s’exprimer ce lundi à la télévision, et de justifier la prorogation pour trois mois de l’état d’urgence dans nos banlieues. Le président de la République, comme il sied à sa fonction, l’a fait dans un registre plus solennel. Mais l’architecture de son discours était la même : moitié répression réelle, moitié semblant de dialogue. C’est, en temps de crise, une figure électoralement imposée : d’abord " l’ordre républicain " qu’il faut restaurer, la " sécurité " qu’il faut assurer, avec cette fois ce supplément de menaces contre les familles qui " éduquent mal leurs enfants " (salauds de pauvres !). Puis, la main tendue aux habitants des " quartiers difficiles ", l’invitation à combattre " le poison des discriminations ", et, enfin, une pincée de mesures qui doivent avoir l’apparence du concret. Par les temps qui courent, il ne viendrait à l’esprit d’aucun dirigeant politique socialistes compris d’inverser ce schéma. Devant un tel classicisme, on en est réduit à peser les mots au trébuchet. Celui-ci a-t-il été plus carotte que bâton, et celui-là plus bâton que carotte ? Dans cet exercice, assurément, Jacques Chirac s’est appliqué à apparaître moins répressif et moins droitier que son ministre de l’Intérieur, lequel pêche définitivement dans les eaux troubles du Front national. Chirac, lui, n’en finit pas d’illustrer cette " politique à la voix passive " dont parle plus loin dans ce journal le philosophe Mathieu Potte-Bonneville. Il n’est responsable de rien, n’a jamais, ô grand jamais, promis de colmater la " fracture sociale ". Pour lui, " Je " est un autre, un éternel nouveau venu qui visite notre société comme un touriste. Il découvre avec une troublante émotion les ravages de la politique libérale menée au cours des dernières années. Et il propose, comme au premier jour. Hélas, mise à part la création d’un " service civil volontaire ", fin 2006, mesure qui en soi n’est pas antipathique mais d’un vague absolu (notamment en ce qui concerne le pécule accordé aux jeunes récipiendaires), le reste de ses propositions appartient au registre de l’incantation. Comme ces appels en direction des syndicats, des entreprises, des médias, et des communes afin qu’elles acceptent d’accueillir les vingt pour cent de logements sociaux auxquels les oblige la loi (mais où est donc ici le bâton de " l’ordre républicain " contre les édiles récalcitrants ?). L’incrédulité est donc totale. Mais il y a au moins une chose derrière ce discours : c’est l’aveu. Après vingt nuits d’émeute, des milliers de voitures brûlées, plus de 2 500 gardes à vue, près de 600 mesures d’emprisonnement, et des dizaines de blessés, un président de la République est venu à la télévision et il a reconnu qu’il y a un problème de discrimination dans nos banlieues, et que la France refuse d’" assumer " sa propre " diversité ". La violence visible des voitures brûlées a soudain rendu perceptible la violence invisible du quotidien. Celle que la télévision ne voit pas, mais que voient et vivent les jeunes des cités. Comme s’il avait fallu ces émeutes pour que le plus haut responsable de l’État en vienne à prononcer ces mots terribles. Voilà qui interpelle les mécanismes de notre démocratie. Dans une société totalement bloquée, qui ne bouge même pas d’un millimètre quand une forte majorité d’électeurs dit " non " au dogme libéral (comme ce fut finalement le cas avec le référendum européen de mai dernier), face à une politique sourde à tous les signaux démocratiques, qui n’en finit pas de privatiser et de liquider les services publics, contre l’évidente majorité de l’opinion, c’est la violence triste constat qui aura, un instant, attiré l’attention sur le sort des quartiers en difficulté. Il ne s’agit surtout pas ici d’en faire l’apologie, mais de constater qu’elle a obtenu ce que les mécanismes démocratiques n’obtiennent plus : ne serait-ce qu’un discours et un moment de considération officielle. Rien de plus. Puis, soyons-en sûr, quand la dernière carcasse de bagnole aura refroidi, on oubliera. En attendant la prochaine explosion. Et cela parce que la politique est une chose simple. Il s’agit toujours, pour finir, de la répartition des richesses. De prendre aux uns pour donner aux autres. On aurait tort de croire que l’actuelle crise des banlieues, par son apparente complexité, ses facteurs culturels et ethniques, échappe à ce schéma général. Elle en est même l’illustration la plus criante. C’est de la politique toute nue, sans apprêt. On n’ira donc pas plus loin qu’un saupoudrage. Parce que c’est tout un système qui vacillerait. Les actuels dirigeants socialistes, eux-mêmes, en sont conscients, et ils ne feraient guère autrement. Ils n’ont cessé de délivrer ce message embarrassé tout au long de la crise. Une opposition qui ne s’oppose jamais, cela fait d’ailleurs partie de la société bloquée. À propos, vendredi s’ouvre le congrès du Mans. Vous en auriez des choses à discuter, camarades !
Semaine du jeudi 10 novembre 2005 - n°2140 - Dossier |