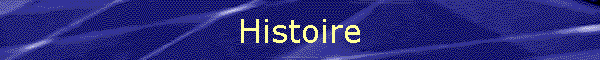|
| |
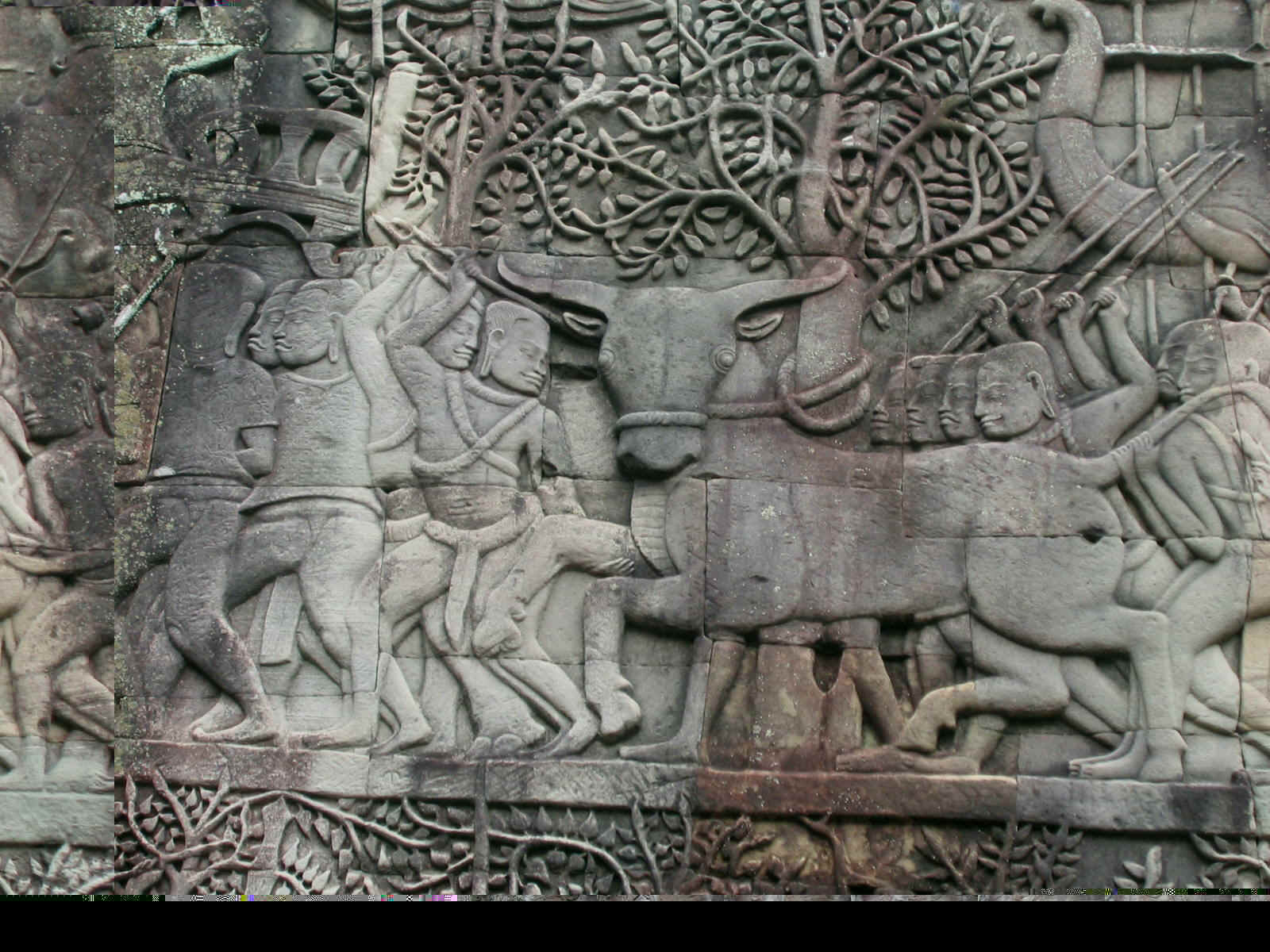
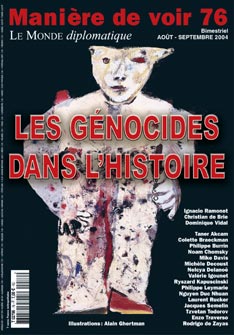
Quelques références qui permettent de savoir ce qui s'est
passé, si ce n'est compendre.
http://www.dccam.org/
http://www.efeo.fr/
http://ckn.free.fr/
http://www.cambodgevision.fr/
http://www.lemonde.fr/web/portfolio/0,12-0@2-3216,31-817635@51-956856,0.html
http://lecritdangkor.free.fr/site/
http://aefek.free.fr/

Prêtre au Cambodge : Benoit Fidelin . Albin Michel 1999.
Sur la piste de Samrang : Henry Noullet . Presse de la Cité
1993.
La Pagode Rouge : Henry Noullet .Presse de la cité 1988.
Revenue de l'enfer : Claire Ly : Les Ed de l'atelier :2002
J'ai cru aux Khmers Rouges : Ong Thong Hoeung
Buchet/Chastel 2003
Cambodge, mon pays , ma douleur . Méas Pech-Métral ; HB
Editions 2006


Approfondir

|
|
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2007/cambodge/biblio.php
 |
|
De l'histoire aux témoignages, des romans aux pièces de théâtre, toute une sélection
d'ouvrages sur le Cambodge...
|
|
 Le Cambodge et l'histoire Le Cambodge et l'histoire |
|
|
|
|

|
Solomon
Kane 
Dictionnaire des Khmers rouges
Aux lieux d'être - 2007
 |
|

Entre 1975 et 1979, au Cambodge, périssent près de deux millions
de personnes, soit un quart de la population, victimes directes et indirectes des
autorités du Kampuchea démocratique, plus connu sous le nom de régime des Khmers
rouges. La folie meurtrière des « années Pol Pot » reste inscrite dans les courbes des
démographes, et les traumatismes psychologiques qui en résultent continuent d'affecter
des dizaines de milliers de Cambodgiens.
Comment comprendre ce qui s'est passé précisément durant les trois années, huit mois
et vingt jours d'existence de ce régime figurant parmi les plus barbares qu'ait connu le
XXe siècle ? Derrière ces atrocités, il y eut des institutions, des hommes, une
idéologie, et un contexte historique et politique. Cette tragédie connut une genèse et
une logique ; elle eut également des suites, marquées notamment par la relative
impunité dont ont bénéficié ces responsables.
L'histoire du mouvement ne s'arrête pas en 1979 : après la chute du régime, la
communauté internationale persiste pendant plus de dix ans à le reconnaître comme seule
autorité légitime du Cambodge, et les derniers Khmers rouges ne déposent les armes
qu'en 1998, année de la mort de Pol Pot. Ce n'est qu'aujourd'hui, près de trente ans
après les faits, qu'on juge les responsables.
Ce dictionnaire, avec ses 370 entrées et son abondante iconographie, offre les clefs
nécessaires au décryptage de cette histoire. Solomon Kane procède ici à une véritable
anatomie du totalitarisme khmer rouge. Ce travail sans précédent dissèque les rouages
du mouvement, élucide le parcours des protagonistes, cartographie un territoire soumis à
la terreur et met au jour les ressorts et les séquelles de cette aventure funeste. En
perçant le secret et l'hermétisme entretenus par les Khmers rouges à propos de leurs
pratiques, ce dictionnaire contribue efficacement à éclaircir l'une des questions
fondamentales du contemporain : qu'est-ce qu'une administration politique criminelle ?
- 4ème de couverture -
|
|
|

|
Khieu Samphan 
L'Histoire récente du Cambodge et mes prises de position
L'Harmattan - 2004
 |
|

Au printemps 1975, face à une résistance cambodgienne acharnée,
les Américains devront abandonner Phnom Penh et le régime qu'ils y maintenaient,
quelques semaines avant de devoir faire de même pour Saigon. Une page terrifiante de
l'Histoire du Cambodge s'ouvre alors, lorsque la petite poignée de leaders du mouvement
victorieux, les Khmers rouges, installe un régime d'une brutalité inouïe, qui,
généralisant le travail forcé, semant le pays de fosses communes, broiera la population
durant leurs presque quatre années de pouvoir, de 1975 à 1979.
Peut-on comprendre cette tragédie ? Celui qui s'exprime ici a été, durant toute cette
période, la figure de proue du régime. Jeune parlementaire contraint de "prendre le
maquis" pour échapper à la répression féroce qui s'abat à la fin des années 60
sur les progressistes cambodgiens, sa fidélité comme compagnon de route du mouvement
khmer rouge ne se démentira plus. Khieu Samphan représentera la résistance intérieure
dans les années qui précèdent la victoire, puis assumera, après le retrait du Prince
Norodom Sihanouk et 1976, la position de chef de l'Etat du Kampuchéa Démocratique,
jusqu'à la déroute du régime, balayé par l'intervention des troupes vietnamiennes, en
janvier 1979. Il s'explique dans ce texte unique sur son itinéraire, les raisons de son
engagement, son compagnonnage avec le mouvement khmer rouge et en particulier Pol Pot, sa
vision d'alors et de maintenant sur la situation et le rôle de la paysannerie
cambodgienne, la difficile question de la survie du Cambodge comme nation indépendante.
Au terme de ce récit Khieu Samphan exprime cette interrogation désolée : "La
défense de la nation peut-elle légitimement en appeler à tant de sacrifies de la part
de la population ? Respect des droits de l'homme et du citoyen, défense de la patrie,
comment être fidèle à ces deux devoirs avec harmonie ?". "L'Histoire récente
du Cambodge et mes prises de position" est un texte à la fois pointilliste et
minutieux, qui par sa modestie même déstabilise les interprétations unilatérales et
réintroduit toute la complexité de la période historique en cause, écartelée par des
contradictions dont la proximité avec les interrogations actuelles est frappante.
- Préface de Jacques Vergès -
|
|
|

|
Sacha
Sher 
Le Kampuchéa des Khmers rouges : essai de compréhension d'une
tentative de révolution
L'Harmattan - 2004
 |
|

Que s'est-il passé sous la révolution "khmère rouge" ?
Pour quelles raisons a-t-elle abouti à une impasse historique ? Pourquoi le Cambodge
a-t-il été déchiré par des problèmes de pénurie persistants, une division profonde
de la population, et une répression plus ou moins brutale, et contrôlée ? Quelles
furent les origines sociales ou idéologiques des méthodes d'organisation de cette
société du Kampuchéa dit Démocratique (évacuation des villes, auto-suffisance
économique, suppression de la monnaie, interdiction de l'alimentation privée, etc.) ?
Quelle est la dose de nationalisme qui anima ses dirigeants ? Que penser de leur tentative
largement administrative d'imposer le communisme économique le plus abouti qui ait pu
exister ? Qui furent les véritables maîtres d'oeuvre de cette politique ? Cette étude
s'efforce d'y répondre à la lumière du parcours politique des principales figures
dirigeantes, et en croisant les témoignages, les confessions de prisonniers, les
retranscriptions d'émissions radio, les analyses d'auteurs méconnus du public français,
ainsi que les textes internes du Parti Communiste du Kampuchéa (plans, statuts, journaux,
notes de cadres, rapports émanant des échelons inférieurs, ou minutes de réunions de
l'état-major de l'armée). La tentative de révolution cambodgienne est ici analysée
sous ses aspects diversement humains, politique, psychologique, polémique,
polémologique, géopolitique, économique, sociologique et démographique.
|
|
|

|
Somanos
Sar 
Apocalypse Khmère
Jean Picollec - 13 octobre 2003
 |

 |

Sous le Kampuchéa démocratique, alors dirigé par les Khmers
rouges de Pol Pot, un million sept cent mille Cambodgiens ont trouvé la mort. Exécutions
sommaires, travaux forcés, mauvais traitements, privation, famine et désespoir, tel fut
le lot quotidien du peuple khmer d'avril 1975 à janvier 1979.
Dans ce témoignage sobre mais sans détour, l'auteur retrace ces quatre années vécues
sous la férule impitoyable d'Angkar, nom de l'organisation chargée de façonner un
peuple nouveau, quatre années d'une vie dans les camps de la mort, où il a vu sa
famille, père, frères, soeurs, tantes, oncles, cousins dévorés par le monstre
communiste. Quatre années d'apocalypse.
- Présentation de l'éditeur -
|
|
|

|
Rithy
Pahn et Christine Chaumeau 
La machine khmere rouge
Flammarion - 2003
 |
|

Pendant plusieurs années, l'auteur a tenté de retrouver des
victimes rescapées de Tuol Sleng, le centre de torture et d'extermination de Phnom Penh
et leurs anciens bourreaux, pour témoigner de la tragédie qui a frappé le Cambodge il y
a maintenant 28 ans.
|
|
|

|
David
Chandler 
S-21 ou le crime impuni des Khmers rouges
Autrement - Janvier 2002
 |

 |

L’un des plus grands spécialistes de l’histoire récente
du Cambodge analyse les archives de la « prison secrète de Pol Pot ». Au sein de S-21
ont été enfermés, torturés, et dans la grande majorité des cas, tués près de 14 000
Cambodgiens, soupçonnés d’activités contre-révolutionnaires. Au-delà de
l’étude des archives, David Chandler tente de nous faire entendre les voix de ces
victimes, des rares survivants et surtout d’un peuple décimé par les siens au nom
d’une rationalité qui dépasse l’entendement.
- Présentation de l'éditeur -
|
|
|

|
Ros
Chantrabot 
Cambodge, la répétition de l'histoire : de 1991 aux élections de
juillet 1998
Libr. You-Feng - 2000
 |
|

Le 18 mars 1970, le prince Norodom Sihanouk fut déchu de sa
fonction de chef de l'Etat du Cambodge. Le 17 avril 1975, les Khmers Rouges entrèrent
dans Phnom Penh. Leur génocide avait fait 2 millions de victimes dans la population
cambodgienne. Le 7 janvier 1979, les troupes vietnamiennes les chassèrent, et entrèrent
à leur tour dans la capitale. Ainsi s'éclata la guerre entre communistes, après celle
des Américains.
Le 23 octobre 1991, la paix fut signée à Paris. Il n'avait pas réussi à y jeter une
base politique saine. Depuis les élections de mai 1991, celles de juillet 1993, le
Cambodge n'arrive pas encore à retrouver la sereinité, la stabilité, la sécurité, la
paix, la justice et la prospérité, comme on l'espérait. Le déchirement entre factions
continue toujours à envenimer le pays, à le diviser et à l'affaiblir, comme dans le
passé. Il semble que l'histoire du Cambodge se répète sans fin.
L'auteur - qui a suivi les affaires politiques cambodgiennes depuis sa jeunesse, et vécu
certains événements - essaie d'analyser le conflit, depuis l'Accord de Paris, pour en
tirer des enseignements utiles, à commencer à connaître ses causes, ses maux et, à
comprendre le passé, le présent et le futur du Cambodge.
-4ème de couverture-
|
|
|

|
Henri
Locard 
Le petit livre rouge de Pol Pot ou les paroles de l'Angkar
L'Harmattan - Mai 2000
 |

 |

Un recueil des slogans, maximes, sentences, injonctions, sommations,
mises en demeure, menaces émanant des leaders khmers rouges qui parlaient au nom de
l'Angkar, l'organisation sans visage et sans loi qui conduisit le Cambodge jusqu'à
l'enfer de "l'utopie meurtrière" de Pin Yatay.
|
|
|

|
François
Ponchaud 
Cambodge année zéro
Kailash - Juin 1998
 |

 |

Où en est aujourd'hui, le Cambodge, après le 17 avril 1975, date
de la victoire des révolutionnaires khmères ? Témoin oculaire de la prise de Phnom
Penh, François Ponchaud nous en fait revivre les péripéties : entrée des
révolutionnaires, exode forcé de toute la population. Il évoque ensuite la prise du
pouvoir dans les provinces, la désertion des villes et des bourgades par un peuple livré
de force au travail de production agricole. Par une analyse du discours officiel tenu par
la radio, l'auteur décrypte les buts poursuivis par la révolution, l'organisation de la
nouvelle société, la formation idéologique du peuple, la création d'une nouvelle
culture. Par sa radicalité même, cette révolution comporte des traits spécifiques que
l'auteur situe dans le contexte historico-social qui l'a vue naître, ainsi que dans
l'histoire personnelle de ses leaders actuels. Révolution fascinante et terrifiante...
L'expérience cambodgienne est un défi qui interpelle tout homme.
|
|
|

|
Ben
Kiernan 
Le Génocide au Cambodge
Gallimard - Avril 1998
 |

 |

Imagine-t-on les Alliés, en toute connaissance du génocide des
juifs, ne déférant pas en 1945 l'amiral Dönitz au tribunal de Nuremberg, mais le
maintenant au pouvoir pour contrer les ambitions de Staline ? Ce fut, toutes proportions
gardées, pourtant le cas au Cambodge.Sur une population estimée à 7 900 000 habitants,
le régime de Pol Pot causa la mort de quelque 1 700 000 personnes, soit plus de 20% de la
population. L'unicité du génocide au Cambodge ne tient cependant pas seulement à ce
bilan, sans égal en ce siècle, de la liquidation de presque un quart de la population
d'un pays, mais à la mobilisation totale des formes raciales et sociales du crime.
|
|
|

|
Jennar,
Raoul M. 
Les clés du Cambodge
Maisonneuve et Larose - 1995
 |
|

Ce livre est une banque de données. L'auteur a réuni les
informations indispensables pour celui qui s'intéresse au Cambodge, et veut connaître
son passé et comprendre son présent. On y trouve des faits, des chiffres, des
informations administratives, démographiques, économiques sur le Cambodge d'aujourd'hui.
Une chronologie importante fait l'objet d'une seconde partie avec pas moins de 1667 dates.
|
|
|

|
Marek Sliwinski 
Le génocide khmer rouge : une analyse démographique
L'Harmattan - 1995
 |
|

|
|
|

|
Elizabeth
Becker 
Les Larmes du Cambodge
Presses de la Cité - 1988
 |
|

traduit de l'anglais par Jacques Martinache
|
|
|

|
Marie
Alexandrine Martin 
Le Mal cambodgien : histoire d'une société traditionnelle face à
ses leaders politiques, 1946-1987
Hachette Littératures - 1988
 |
|

|
|
|

|
Esmeralda
Luciolli 
Le Mur de bambou : le Cambodge après Pol Pot
R. Deforges Médecins sans frontières - 1988
 |
|

|
|
|

|
David
Chandler 
Pol Pot : frère numéro un
Plon - 1993
 |
|

|
|
|

|
Jean
Lacouture 
Survive le peuple cambodgien!
Seuil - 1978
 |
|

|
|
|
 Témoignages, romans, pièces de théâtre Témoignages, romans, pièces de théâtre |
|
|
|
|

|
Séra 
L'eau et la terre
Delcourt - Collection : Mirages - 2005
 |
|

Des destins se croisent sur une route, au lendemain du 17 avril
1975, quand les Khmers rouges ont brutalement évacué toutes les villes du pays. Les
personnages se savent en sursis au point de se définir comme des gens "n'étant pas
encore morts". Ils font partie des trois groupes qui seront au coeur de la tragédie
à venir : paysans, citadins et Khmers.
-4ème de couverture-
|
|
|

|
Séra

Lendemains de cendres
Delcourt - Collection : Mirages - 2007
 |
|

1979. Les troupes vietnamiennes ont envahi le Cambodge. Le régime
de Pol Pot s’effondre, mais la chasse aux contre-révolutionnaires est toujours
ouverte à travers tout le pays. Nhek, fuyant pour la Thaïlande, croise en chemin
d’autres déportés en exil et partage le destin des prisonniers de camps de
regroupement. Il y retrouve également les humiliations, les représailles, les
traumatismes… Et la mort.
-présentation de l'éditeur-
|
|
|

|
Denise
Affonco 
La digue des veuves - Rescapée de l'enfer des Khmers Rouges
Presses de la Renaissance - Mars 2005
 |

 |

De mère vietnamienne et de père français, Denise Affonço était
promise à une existence paisible au Cambodge jusqu’à ce que les Khmers rouges
fassent basculer sa vie. En avril 1975, les autorités françaises rapatrient leurs
ressortissants. Denise Affonço fait le choix de rester aux côtés de son mari, chinois
et communiste convaincu, espérant que les Khmers rouges mettront fin aux cinq années de
guerre civile contre la république khmère pro-américaine corrompue.
Mais rapidement, Denise et sa famille, tout comme des millions de citadins, sont
déportés vers les campagnes, où ils découvrent l’enfer des camps de travail, la
famine, la maladie et la mort. C’est ce cauchemar que se remémore l’auteur.
Son conjoint, jugé « trop intellectuel », est exécuté – elle en sera
officiellement avertie lorsqu’on l’assignera à la construction de la « digue
des veuves » ; sa fille âgée de neuf ans meurt de faim sous ses yeux ; son fils aîné
est déporté vers un autre camp. Quatre années d’horreur auxquelles mettra fin
l’arrivée des Vietnamiens en janvier 1979, qui permettront à Denise de retrouver
son enfant et d’être rapatriée en France.
Le récit bouleversant d’une « mère Courage » qui, au milieu du chaos et du
désespoir, n’a jamais cessé de se battre pour la vie.
|
|
|

|
François Bizot 
Le Portail
La Table Ronde - Août 2000
 |

 |

François Bizot, membre de l'École française d'Extrême-Orient,
est fait prisonnier au Cambodge par les Khmers rouges, en 1971. Enchaîné, il passe trois
mois dans un camp de maquisards. Chaque jour, il est interrogé par l'un des plus grands
bourreaux du vingtième siècle, futur responsable de plusieurs dizaines de milliers de
morts, aujourd'hui jugé pour crimes contre l'humanité : Douch. Au moment de la chute de
Phnom Penh, en 1975, François Bizot est désigné par les Khmers rouges comme
l'interprète du Comité de sécurité militaire de la ville chargé des étrangers
auprès des autorités françaises. Il est le témoin privilégié d'une des grandes
tragédies dont certains intellectuels français ont été les complices. Pour la
première fois, François Bizot raconte sa détention, décrit une révolution méconnue,
démonte les mécanismes de l'épouvante et fait tomber le masque du bourreau monstre.
Grâce à une écriture splendide et à un retour tragique sur son passé, l'auteur nous
fait pénétrer au coeur du pays khmer, tout en nous dévoilant les terribles
contradictions qui - dans les forêts du Cambodge comme ailleurs - habitent l'homme depuis
toujours.
- Quatrième de couverture -
|
|
|

|
Randal
Douc 
Les hommes désertés
L'Harmattan - 2004
 |
|

Un jour, dans un pays lointain, aux dernières heures d'une guerre
civile, venant d'un autre continent, une femme pose ses pieds nus sur les traces de son
père. Ainsi commence Les hommes désertés. L'Histoire, la grande, celle qui fait rouler
les vies dans les fleuves, se mêle à l'autre, la petite, celle d'une enfant cherchant
son père, étrangère à tout, portant en elle le droit de savoir, celui de connaître.
Ce jour est un dix-sept avril. La fin de la guerre. On y parle de fuite, de désertion,
d'urgence, d'acceptation et bien sûr de mémoire. L'humanité disparue, les corps
s'emplissent d'une autre substance. Inconnue. Pourtant, cette nuit est aussi celle d'une
merveille physique. Une voix traversera la distance la séparant d'une autre voix,
s'entourera d'une nouvelle bouche et plus tard, bien plus tard, se mélangera. Alors, par
cette étrange mélodie, quelque part en notre chair, elle continuera d'exister.
-4ème de couverture-
|
|
|

|
Claire
Ly 
Revenue de l'enfer : quatre ans dans les camps des Khmers rouges
Ed. de l'Atelier - 2007
 |
|

Avril 1975, les Khmers rouges deviennent les maîtres du Cambodge.
Une femme, sa mère et ses deux enfants prennent la route de la Thaïlande. Leur fuite est
bientôt stoppée par les soldats de Pol Pot. Commence alors un long calvaire: camp de
travail à la campagne, exécutions sommaires, endoctrinement des enfants, malnutrition,
chasse aux bourgeois et aux intellectuels. Dans un récit bouleversant et rare, Claire Ly
raconte sa lutte obstinée pour la survie.
Que peut faire une jeune femme contre la folie génocidaire de soldats et de militants qui
sont sciemment décidé d'éliminer les ennemis du peuple?
Les principes de l'éducation cambodgienne fondés sur une certaine conception du
bouddhisme enseignent l'impassibilité, «la voie du milieu», le détachement à l'égard
des souffrances endurées. Pourtant, pour survivre Claire Ly ne peut plus taire sa haine
et sa révolte. Bousculant ces valeurs ancestrales, elle choisit de demander des comptes
au Dieu des Occidentaux. Pourquoi a-t-il permis ces horreurs? Peu à peu, ce Dieu
étranger devient un compagnon qui la conduira vers une voie étonnante.
Cette traversée de l'enfer est un document exceptionnel sur la façon dont une femme a
vécu l'un des plus grands drame du XXe siècle.
La Vie au Coeur : l'engagement d'hommes et de femmes qui mettent leur foi en actes pour
rendre la terre plus humaine.
- 4ème de couverture -
|
|
|

|
Claire Ly 
Retour au Cambodge : le chemin de liberté
d'une survivante des Khmers rouges
Ed. de l'Atelier - 2007
 |
|

Elle avait juré ne jamais y revenir. Après s'être échappée des
camps khmers rouges, s'être installée en France et avoir demandé le baptême, Claire Ly
pensait avoir définitivement quitté le Cambodge. Comment retourner sur les lieux d'un
tel enfer ?
Voici le récit de trois voyages improbables. Vingt-cinq ans après l'avoir fui, une femme
ose poser à nouveau le pied sur le sol de son pays natal. D'abord paralysée par le
cauchemar du génocide, elle affronte sa peur et retrouve sa maison, ses compagnons de
camps, les survivants de sa famille... On la conduit sur les lieux de l'assassinat de son
mari et de son père. Peu à peu, par-delà le fracas des deuils, une sérénité
s'instaure: la chrétienne convertie qu'elle est devenue accorde l'hospitalité à la
femme bouddhiste qu'elle était. Entre les deux identités, s'ouvre un espace de dialogue,
le lieu d'une passionnante quête de soi.
Document exceptionnel sur les suites du génocide khmer rouge, ce livre est aussi
l'histoire d'une femme façonnée par deux cultures et deux religions, en recherche
d'unité et de liberté. Il nous place au coeur de l'une des grandes questions de notre
temps: la rencontre des cultures et des religions.
- 4ème de couverture -
|
|
|

|
Norodom
Sihanouk 
Prisonnier des Khmers rouges
Hachette Littératures - 1986
 |
|

Voici l'épisode le plus poignant de l'une des vies les plus
romantiques de ce siècle.
Jusqu'en 1970, la biographie de Norodom Sihanouk suscitait l'étonnement. A partir de
cette date, elle se fait stupéfiante. Renversé par un coup d'État pro-américain, il
devient l'hôte des Chinois et l'allié des Khmers Rouges qui depuis dix ans luttaient
contre lui par les armes. Ses ennemis vaincus, cinq ans plus tard, il ne rentre dans sa
capitale que pour y être emprisonné dans son palais, sans cesse menacé de mort par des
gardiens dont il apprend peu à peu qu'ils soumettent sa patrie à un épouvantable
génocide.
C'est le récit de cette captivité, du sauvetage de l'ancien souverain par ses alliés
chinois, de sa rocambolesque évasion du siège de la délégation des Khmers Rouges à
l'ONU et de sa tragique et inévitable alliance avec les bourreaux du Cambodge que raconte
ici celui que son peuple appelait le « prince-papa ».
- présentation de l'éditeur -
|
|
|

|
Ong
Thong Hoeung 
J'ai cru aux Khmers rouges : retour sur une illusion
Buchet Chastel - 2003
 |
|

En avril 1975, les Khmers rouges prenaient le pouvoir à Phnom Penh.
Nombreux furent ceux qui applaudirent alors. Parmi eux, des Cambodgiens expatriés en
France ou aux États-Unis, étudiants, intellectuels, anciens fonctionnaires ou
militaires... Ong Thong Hoeung était un de ceux-là. En juillet 1976, il quitte Paris,
où il suivait des études, pour rentrer au pays. Comme la plupart de ses amis,
«progressiste», mais pas communiste, il espère alors pouvoir se mettre au service d'un
pays libéré. Mais à leur arrivée, les «étrangers» sont aussitôt dirigés vers un
camp de rééducation. Le rêve tourne au cauchemar. C'est le récit bouleversant de cette
traversée de l'enfer que l'on lira ici.
Beaucoup de ceux qui firent ce «voyage de retour» sont morts. Ong Thong Hoeung et sa
femme ont survécu. C'est dans un camp qu'est né, dans des conditions terrifiantes, leur
premier enfant.
La plupart de ceux qui en sont «revenus» ont le plus souvent gardé le silence ou
considéré que la fatalité s'était abattue sur eux, comme sur le Cambodge. Avec ce
Retour sur une illusion, Ong Thong Hoeung va beaucoup plus loin. Il reconnaît s'être
trompé et montre comment, même dans les camps, en dépit des souffrances qu'ils
enduraient, lui et ses compagnons ont encore voulu «y croire». Presque jusqu'à la fin.
Un témoignage exceptionnel sur la folie idéologique et l'aveuglement qui peuvent
s'emparer de tout un chacun, avec les meilleures intentions du monde. Une pièce
considérable à verser au dossier du futur procès des Khmers rouges qui devrait enfin
s'ouvrir au Cambodge, près de trente ans après leur règne criminel.
- 4ème de couverture -
|
|
|

|
Méas
Pech Métral 
Cambodge, je me souviens
HB Editions - 2003
 |
|

Intimes
Le témoignage de Méas est unique. C'est un petit morceau de la mémoire d'un peuple, le
journal d'une enfant que ses concitoyens ont tenté d'exterminer, qui a grandi dans des
camps de travaux forcés, séparée de sa famille, manipulée par [l']idéologie [des
Khmers rouges], proche de celle des nazis, et qui a pu s'enfuir vers d'autres camps [en
Thaïlande], ceux de la survie.
Mireille Lemaresquier
J'ai été très ému par la lecture du premier récit de Méas Pech-Métral, que Mireille
Lemaresquier m'avait fait ensuite connaître et rencontrer. Je l'avais personnellement
encouragée à écrire la suite de son histoire, et de ses poèmes, dès la publication de
son premier témoignage en 2003 [...]. Aujourd'hui, France Info s'associe à la
réédition du premier livre de Méas Pech Métral Cambodge je me souviens et, comme je
l'ai souhaité, à l'édition du second volume de sa mémoire d'enfant martyrisée :
Cambodge, mon pays, ma douleur.
Michel Polacco, directeur de France Info
Méas Pech-Métral a cette sensibilité des vrais écrivains qui trouvent dans leur
mémoire et leur vie des instants, des images, des cris pour les faire fleurir dans un
récit qui dépasse le simple témoignage.
Michèle Gazier, Télérama
-4ème de couverture-
|
|
|

|
Ung Daravichet Chai 
Soma, l'enfant de l'Angkar : dans l'apocalypse khmère rouge
Rocher - 2006
 |
|

Un certain nombre de témoignages ont été écrits par des
survivants du génocide perpétré par Pol Pot. Celui-ci est particulier. À l'époque des
faits, l'auteur, Daravichet Chai est une jeune maman réfugiée en France avec son mari et
leurs deux fils. Enceinte d'un troisième enfant en 1973, elle rentre accoucher au
Cambodge et met au monde une petite fille. Un mois plus tard, la confiant à ses tantes,
elle revient à Paris. Une séparation déchirante qui aurait dû être de courte durée.
Quand la famille est en mesure de regagner le Cambodge, les Khmers rouges viennent
d'envahir Phnom Penh. Plus aucune nouvelle ne filtre du pays, sinon les rumeurs
d'événements sanglants. Débute alors une attente interminable. Dans ce livre, Ung
Daravichet Chai raconte l'épopée dramatique de sa fille qui traversera l'enfer et la
barbarie. À travers cette épopée, c'est de son pays que l'auteur veut aussi parler,
d'une civilisation brillante anéantie en une journée. Ce livre vient à point nommé
alors que se déroule, enfin, le procès des Khmers rouges.
- 4ème de couverture -
|
|
|

|
Hélène
Cixous 
L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge
Théâtre du Soleil - 1987
 |
|

|
|
|

|
Pin
Yathay 
L'Utopie meurtrière : un rescapé du génocide cambodgien
témoigne
R. Laffont - 1980
 |
|

|
|
|
 Une sélection de films Une sélection de films |
|
|
|
|

|
Rithy
Panh 
Les gens de la rizière
Blaq Out - 2004
 |
|

C'est l'histoire de Vong Poeuv, de sa femme Yim Om et de leurs sept
filles. La culture du riz anime leurs vies, leurs joies, leurs croyances, leur survie...
La terre est petite, la famille nombreuse, les enfants grandissent...
Sélection officielle Cannes 1994.
Bonus : Interview de Rithy Panh (40') - Bande annonce.
|
|
|

|
Rithy
Panh 
S21, la machine de mort khmère rouge
Montparnasse - 19 octobre 2004
 |

 |

Un documentaire de Rithy Panh.
Synopsis : Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le principal « bureau
de la sécurité ». Dans ce centre de détention de Tuol Sleng, situé au coeur de la
capitale Phnom Penh, entre 14 000 et 17 000 prisonniers ont été torturés, interrogés
puis exécutés entre 1975 et 1979. Sept seulement ont survécu. Trois sont encore en vie.
Et, pour S21, la machine de mort khmère rouge, deux sont revenus à Tuol Sleng : Vann
Nath, dont le directeur du S21 avait fait son peintre officiel, et Chum Mey, qui savait
réparer les machines à écrire.
|
|
"Le diable par excellence"
NOUVELOBS.COM | 20.09.2007 | 10:55

par François Bizot,
ethnologue à l'Ecole française
d'Extrême-Orient
Quel était le rôle exact de Nuon Chea dans le régime de Pol Pot ?
- Il était notamment chargé de la sécurité, le diable par excellence dit-on. Les
arrestations et les exécutions étaient du ressort des membres permanents du comité
central, et en définitive décidées par Pol Pot (décédé), Nuon Chea, Son Sen
(décédé) et Ta Mok (décédé). Douch, le responsable du centre de Tuol Sleng à Phnom
Penh, où furent torturés et envoyés à la mort des dizaines de milliers de personnes,
recevait ses ordres d’abord de Son Sen et, à partir du mois de juillet 1978, de Nuon
Chea. Si Nuon Chea lui-même ne s’est jamais rendu à Tuol Sleng, il en fut le
véritable patron. Pour autant, sa responsabilité dans les exécutions ne
s’arrêtait probablement pas là : on a déjà retrouvé au Cambodge 350 charniers
comprenant plus de 20.000 fosses communes. Cela porte le nombre des victimes du régime
khmer rouge à un total bien supérieur aux 2 millions de morts généralement admis, sur
une population d’environ 6 millions d’habitants.
Pourquoi la justice cambodgienne n'a jamais jugé elle-même les ex-dirigeants
khmers ?
- Ni la Chine ni les États-Unis ne voulaient de ce procès. En outre, il s’est
passé un autre phénomène. Dès les années 90, au sein de ce pays peuplé d’un
monde de survivants, victimes et assassins durent apprendre à vivre ensemble, à se
côtoyer, à essayer de comprendre ce qui avait décidé du rôle de chacun, sans toujours
parvenir à faire une distinction très nette. Dans ce régime fondé sur la terreur, la
mort avait plané sur tout le monde. Mais chercher à comprendre, ce n’est pas
vouloir pardonner. Chacun au Cambodge vit dans le désespoir et le souvenir déchirant de
ses morts. Le besoin de consolation des Khmers est inextinguible. Aucun procès ne pourra
punir les Khmers rouges à la hauteur de leurs crimes. C’est la raison pour laquelle
le procès international qui se dessine risque de ne pas répondre au besoin légitime des
victimes.
D’une certaine manière, en effet, le principe d’une justice internationale est
de faire des procès exemplaires. Elle se met en place pour juger des crimes contre
l’humanité, c’est-à-dire contre “l’homme” si les mots ont un
sens. Les meurtres sortent du cadre national “victime-bourreau” proprement dit,
ils passent à un autre niveau, leur procès concernent l’humanité entière, qui est
prise à témoin. L’assassin répond d’un crime contre ses semblables, contre
l’homme dans sa globalité, non plus contre telle ou telle personne en particulier.
La grandeur d’une telle justice est d’oser humaniser l’enjeu. Les victimes
au nom desquelles le procès à lieu et dont l’identité se dérobe, prennent de la
distance et en même temps de la hauteur. Elles se confondent avec l’ensemble des
êtres anonymes qui ont, dans tant d’autres lieux, à tant d’autres époques,
subit un sort identiques, perpétrer par les mêmes bourreaux, avec les mêmes tortures,
souvent pour des mobiles communs. L’homme tue depuis toujours pour faire vivre des
rêves.
Les “crimes contre l’humanité” concernent l’humanité, leurs victimes
deviennent des hommes sur la Terre, les bourreaux deviennent des hommes sur la Terre. Cela
change tout, pour peut qu’on soit lucide et qu’on en ait le courage. Dans cette
optique, l’assassin n’a plus a être déshumanisé. Sans rien minimiser de sa
culpabilité ni de sa responsabilité, on peut le voir dans son empleur, réhabiliter
l’humanité en lui de plein droit, et en montrer toute l’abomination. Il
n’est plus le monstre derrière lequel chacun s’abrite depuis toujours, mais un
homme semblable aux autres dont, cette fois, nous avons tout à craindre. C’est
celui-là qu’il faut juger.
L’arrestation de Nuon Chea pour crime contre l'humanité, après celle de
Douch début août, est-elle le signe que le tribunal est déterminé à faire accélérer
les jugements ?
- Il reste trois ex-dirigeants que le tribunal de l'ONU a inculpé : Khieu Samphan, Ieng
Sary et son épouse Khieu Thirith. Ieng Sary avait été "amnistié" (Pardon
royal) par Norodom Sihanouk en 1996. Douch est en prison depuis 1999. C’est la
moindre des choses, semble-t-il, que les hiérarques du Kampuchea démocratique qui lui
donnaient des ordres le soient aussi. La liste n’est pas close.
Propos recueillis par Justine Charlet
(le vendredi 20 septembre 2007)
Entretien avec François Ponchaud, auteur de « Cambodge
année zéro ».
Tribunal Khmer rouge : « tous les acteurs du drame devraient passer en
justice »
jeudi 15 mars 2007 par Emmanuel Deslouis
Prêtre français installé au Cambodge depuis les années 1960, François Ponchaud est
le premier à avoir alerté le monde des massacres perpétrés par les khmers rouges.
Aujourd’hui qu’un tribunal mi-cambodgien mi-international a été mis en place
pour juger les ex-dirigeants du pays entre 1975 et 1979, il nous livre son analyse très
critique de la situation.

Eurasie : Que vous inspire la création
d’un tribunal pour juger les anciens chefs khmers rouges ?
François Ponchaud : C’est un fait éminemment politique, et utilisé comme tel
par les différentes parties en présence, selon leurs intérêts politiques ou
stratégiques du moment.
Eurasie : Pour comprendre ce tribunal, il faut
revenir en 1979, après la défaite des khmers rouges.
François Ponchaud : Effectivement. Les Khmers rouges ont été jugés, les 15-19
juillet 1979, par les Vietnamiens et leurs alliés du monde soviétique, pour justifier
leur "libération", puis l’« occupation » du pays. A cette
époque, dans le cadre de la guerre froide, la Communauté internationale a préféré
globalement soutenir les Khmers rouges contre l’hégémonisme soviétique, présent
au Cambodge par Vietnamiens interposés, et refusé de reconnaître ce jugement des
vainqueurs.
Eurasie : Quand l’idée d’un tribunal
est parvenue jusqu’à vos oreilles ?
François Ponchaud : En août 1983. J’ai été abordé, à Washington, par David
Hawk, ancien responsable d’Amnesty International aux Etats-Unis, qui me demandait, si
éventuellement, j’accepterai de participer à un tribunal devant juger les
ex-responsables Khmers rouges. Je lui ai répondu : "Pourquoi pas ? Je ne
pose qu’une condition : que l’on juge en premier, Nixon (par contumace) et
Kissinger. Depuis, aucune demande de la part des Etats-Unis…
Eurasie : Quelle était la position des
Etats-Unis ?
François Ponchaud : Ils voulaient prendre leur revanche sur leur humiliante défaite
en Asie du Sud-est. Animés du prurit des procès, ils ont, pendant plusieurs années,
poussé le gouvernement cambodgien à établir un tribunal pour juger ces ex-responsables
khmers rouges.
Eurasie : Et aujourd’hui ?
François Ponchaud : Depuis 2005, ils refusent toute participation financière au
procès, estimant son organisation comme peu crédible…
Eurasie : Pour quelle raison ?
François Ponchaud : Ils ont actuellement d’autres intérêts commerciaux et
stratégiques au Cambodge (construction d’une énorme ambassade à Phnom Penh, et,
dit-on, projet d’une base navale en eaux profondes à Réam ). Ces champions des
droits de l’Homme refusent l’installation de la CPI (Cour Pénale
Internationale) et n’hésitent pas à soudoyer les petits pays, dont le Cambodge en
2003, lors de la visite de Collin Powell à Phnom Penh, pour qu’ils refusent leurs
voix à l’établissement de cet organisme.
Eurasie : Pourtant le tribunal se tient
aujourd’hui…
François Ponchaud : En 1996, les deux co-Premiers ministres cambodgiens,
n’arrivant pas à vaincre militairement les Khmers rouges, les déclarèrent
"hors la loi", puis demandèrent à l’ONU l’établissement d’un
tribunal pour juger leurs chefs. Dans un réflexe traditionnel chez les Khmers, on demande
aux Etrangers de faire le sale travail… Depuis que le 9 août 1996, Ieng Sary
s’est rallié avec la moitié des troupes khmères rouges, les deux co-Premiers
ministres de l’époque cessèrent de demander ce tribunal qui risquerait de les
impliquer, eux aussi.
Eurasie : Comment Ieng Sary s’est rallié
à Phnom Penh ?
François Ponchaud : En août 1996, le co-Premier ministre Hun Sen accorde
l’amnistie à Ieng Sary et la promet aux chefs khmers rouges qui se rendraient aux
forces gouvernementales. Il obtient que le roi Sihanouk, à son corps défendant, accorde
également l’amnistie royale à Ieng Sary, responsable reconnu des massacres de son
peuple.
Eurasie : Et les autres chefs khmers
rouges ?
François Ponchaud : De la même façon, lorsque Nuon Chéa (responsable en haut lieu
de la sinistre prison de Tuol Sleng) et Khieu Samphan, Président du Praesidium du KD
(Kampuchéa Démocratique), puis ministre des Affaires Etrangères du GCKD (Gouvernement
de Coalition du Kampuchéa Démocratique), sont livrés par la Thaïlande à l’armée
cambodgienne, le 25 décembre 1998, il leur accorde l’amnistie : "Le moment
n’est pas aux procès, mais à la réconciliation", dit-il, et accorde la
province de Païlin aux Khmers rouges, comme Sihanouk avait donné celle de Siemréap au
chef issarak Dap Chhouon, en 1956. C’est le mode traditionnel khmer de résolution
des conflits armés. Beaucoup de gradés khmers rouges sont promus dans l’armée
royale (Kaè Pauk, Kukhim, entre autres)…

Eurasie : De cette manière, le premier ministre
Hun Sen a voulu étouffer l’affaire…
François Ponchaud : Il a agi en homme politique responsable : il a choisi la
paix à la justice. Qui lui en ferait grief ?
Eurasie : Mais le tribunal est revenu sur le
devant de la scène…
François Ponchaud : Sous la pression des Etats-Unis. Hun Sen a dû négocier la
tenue d’un tribunal "international", puis à "caractère
international" avec l’ONU, mais il est clair que le gouvernement cambodgien
traîne les pieds dans les négociations et ne veut pas d’un tel tribunal.
Eurasie : pourquoi ?
François Ponchaud : Trop de ses membres sont d’anciens khmers rouges : des
gens pourraient demander : qu’a fait Hun Sen en 1973 à Kompong Cham ?
Comment agissait Chéa Sim, chef de district de Krek ? Est-ce que Heng Samrin
n’a jamais tué de civils vietnamiens innocents avant 1978 ? Kéat Chhon, qui a
adhéré au parti en 1974, est-il aussi net qu’il le dit ? Le rôle de Hor Nam
Hong au camp de Boeung Trabek n’est pas clair… Le refus du gouvernement de payer
sa quote-part à l’établissement du tribunal est significatif. On a
l’impression qu’il attend la mort des intéressés : Pol Pot, Kaè Pok et
Ta Mok sont morts, Nuon Chéa et Ieng Sary sont âgés pour des Cambodgiens, et en
mauvaise santé
Eurasie : Les Cambodgiens n’obtiendront
jamais justice ?
François Ponchaud : Que cela soit bien clair, tout ce qu’ont fait les Khmers
rouges mérite une condamnation ferme et sans réserve, ils sont impardonnables, quels que
soient les argument avancés pour les défendre : déportation de la population des
villes, abandon des citadins à la mort certaine dans les forêts, travaux forcés
généralisés, nombreux assassinats (200.000 durant la seule année 1978, certainement
plus nombreux encore si l’armée vietnamienne n’était pas intervenue,
assassinat d’une grande partie de la population de Phnom Penh en 1978… Un
innocent tué est un crime, que dire de la mort de près du quart de la
population !… Ce qui est le plus révoltant est leur tentative démentielle et
cynique de transformer l’âme khmère et sa culture. Il a fallu un cerveau pour
planifier cette refonte méthodique des cerveaux. Elle n’a pas été laissée à
l’empirisme, à la brutalité et à l’idiotie des petits chefs locaux.
Eurasie : Qui était derrière cela : Pol
Pot ?
François Ponchaud : Pol Pot n’était pas assez intelligent pour planifier un
tel lavage de cerveaux et la dépersonnalisation des victimes. Qui est l’idéologue
khmer rouge ? Chhum Mum ? L’assassinat a été érigé en loi :
"Il vaut mieux tuer un innocent que de maintenir en vie un coupable", "A
(le ou les) garder en vie, nul profit, à (le ou les) tuer, nulle perte", sont des
slogans diffusés officiellement à la radio. Les gens habitant hors des zones tenues par
les khmers rouges avant le 17 avril 1975 n’avaient aucun droit.
Eurasie : Donc le tribunal est
nécessaire ?
François Ponchaud : Oui, mais pas sous sa forme actuelle, qui me semble ne devoir
procéder qu’à une parodie de justice. Le gouvernement garde la haute main sur ce
tribunal, qui ne fera qu’édicter sa position politique. Le choix des juges
cambodgiens s’est fait en toute opacité, en faveur de seuls membres du PPC. Le
gouvernement a eu le dernier mot sur le choix des juges internationaux et a eu le souci de
tout verrouiller pour rester le maître de la situation. Si la Communauté internationale
désire un jugement équitable, tous les acteurs du drame devraient passer en
justice : il est trop facile aux vainqueurs de s’attaquer à des ennemis
vaincus, qui n’ont plus la possibilité de réagir.
Eurasie : A quels acteurs pensez-vous ?
François Ponchaud : D’abord aux Etats-Unis qui ont plongé le pays dans la
guerre en 1970. S’ils n’ont pas directement participé à la destitution de
Sihanouk, le 18 mars 1970, ils ont favorisé le climat anti-Sihanouk, puis soutenu le
régime corrompu de Lon Nol d’une manière éhontée. John Gunther Dean, dernier
ambassadeur des Etats-Unis auprès de la République khmère jusqu’en 1975, le
déplorait amèrement, les larmes dans les yeux, lors d’une émission
télévisée : "Plus les régimes sont corrompus, mieux nous pouvons les
manœuvrer", était un principe de la politique officielle américaine.
Eurasie : Ils sont intervenus mai-juin 1970, aux
côtés des soldats sud-vietnamiens…
François Ponchaud : Oui, dans le but de s’emparer du quartier général
vietcông. Cela a été une catastrophe politique et humaine : ils (au moins les
Sud-Vietnamiens) ont volé, violé, tout détruit sur 40 km de profondeur au Cambodge, ne
laissant au paysans que le choix d’aller gonfler les rangs des Khmers rouges,
honnêtes et respectant le peuple, à cette époque du moins.
La conduite de la guerre par Lon Nol, soutenu par l’aviation et les experts
américains a été une autre catastrophe pour le Cambodge. Kissinger, instigateur de la
politique de bombardements au Cambodge et piètre prix Nobel de la paix, a fait déverser
539.000 tonnes de bombes sur ce petit pays qui n’avait rien fait aux Etats-Unis, dont
plus de 257.000 du 6 février au 15 août 1973 à minuit, à la suite à une erreur
d’analyse politique : il craignait que le Cambodge ne devienne une base arrière
pour les Vietcôngs qui auraient ainsi menacé le retrait du corps expéditionnaire
américain du Sud-Vietnam.
Eurasie : Y-a-t-il eu des critiques du côté
américain ?
François Ponchaud : Le 18 avril 1978, le pasteur baptiste Jimmy Carter envoyait un
télégramme de félicitations aux organisateurs d’un hearing à Oslo, traitant les
Khmers rouges de "plus grands violateurs des droits de l’homme de
l’humanité". Mais ce même Carter, en janvier 1979, ré-armait les Khmers
rouges contre l’hégémonisme soviétique présent par Vietnamiens interposés au
Cambodge… Suivis en cela par les SAS de Grande Bretagne.
Eurasie : A part les Etats-Unis, qui a eu un
rôle dans le drame cambodgien ?
François Ponchaud : Les pays Occidentaux, spécialement la France, en obligeant les
trois composantes de la résistance khmère à s’unir dans un Gouvernement de
Coalition du Kampuchéa Démocratique (GCKD), à Kuala Lumpur, en juillet 1982.
"Union contre nature", dira Sihanouk. Les bourreaux représenteront le peuple
khmer jusqu’en 1989, au nom du principe juridique stipulant qu’on ne doit pas
reconnaître un régime installé par l’étranger. On laissera ainsi mourir les
Khmers de l’intérieur du Cambodge, en les laissant sous le pouvoir exclusif de
l’armée vietnamienne d’occupation et en leur refusant toute aide humanitaire,
pour ne soutenir que les 350.000 réfugiés en Thaïlande, représentant le véritable
peuple khmer…

Eurasie : Avez-vous tenté d’intervenir
pour mettre fin à cette situation ?
François Ponchaud : En 1980, à Bangkok, j’ai demandé à Michel Barnier,
député de Savoie, d’intervenir auprès du gouvernement français pour qu’il
reconnaisse le régime de Phnom Penh… La plupart des ONG internationales (même dans
un premier temps l’Unicef et le CICR), le Vatican, beaucoup d’"âmes
pieuses" sont tombées dans le panneau tendu par la Chine et les USA et ont aidé les
Khmers rouges réfugiés en Thaïlande au camp de Sakéo, en 1979, "pauvres khmers
victimes des Vietnamiens", alors qu’ils étaient en premier lieu victimes de
l’Angkar !
Eurasie : Quels acteurs régionaux sont aussi
impliqués ?
François Ponchaud : La Chine et la Thaïlande qui ont puissamment aidé les Khmers
rouges, jusqu’en 1993, et même 1998. La Chine, d’abord pour des raisons
idéologiques, puis, depuis la mort de Mao, pour des raisons géo-stratégiques, dans sa
lutte contre l’hégémonisme soviétique. La Thaïlande, pour des raisons de
sécurité, par peur du Vietnam, mais surtout par appât du profit le plus éhonté de la
part des militaires, prêts à tous les trafics…
Eurasie : La mission APRONUC des Casques bleus
n’a rien arrangé ?
François Ponchaud : L’APRONUC, qui avec un "per diem" de 150 $ pour
le simple soldat, ce qui représentait, par jour, le salaire annuel d’un
fonctionnaire khmer, a corrompu le Cambodge… sur tous les plans, économique, moral,
social, et contribué à répandre le sida... Il convient de mener une réflexion
sérieuse sur le fonctionnement et les dépenses du "machin". Les membres de
l’APRONUC, chargés d’établir la démocratie au Cambodge, n’étaient pas
recrutés parmi les pays les plus démocratiques… Le manque de volonté politique des
responsables de l’ONU était effarant ! On pourrait interroger sur ce point le
général Lorridon, limogé par ces autorités !
Eurasie : L’ONU ne rattrape même pas le
lot ?
François Ponchaud : Les organismes internationaux de l’ONU dont les
représentants jouissent de salaires mirobolants dépensent environ la moitié des aides
internationales, ce qui donne des appétits, somme toute légitimes, à leurs homologues
khmers. Que dire des juges internationaux qui logent au Royal (hôtel à 5
étoiles) ? Ose-t-on encore parler de justice ? Le roi-père Sihanouk répète
à loisir qu’il serait préférable d’utiliser les millions de dollars que
coûtera le procès pour des projets de développement au service des pauvres.
Eurasie : Quel discours tiennent les partisans
du tribunal khmer rouge ?
François Ponchaud : Selon eux,limiter la durée d’examen à la période
1975-1979 est la seule façon de permettre la tenue de ce procès. Si l’on étendait
cette durée, on le rendrait impossible… C’est vrai, mais de quelle justice
parle-t-on ? Un principe élémentaire de justice veut que les causes sont
importantes à connaître pour juger sérieusement les actes.
Eurasie : Juger les ex-dirigeants est-il
suffisant ?
François Ponchaud : Comme le font remarquer souvent les victimes du drame
cambodgien, il faudrait juger les petits chefs qui ont appliqué à leur façon les
directives orales de l’Angkar. Ce sont souvent eux qui se sont montrés les plus
cruels, souvent par bêtise ou par esprit de revanche. Or si l’on se met à juger ces
petits chefs, on risque fort de relancer l’insécurité si chèrement acquise !
Actuellement, les bourreaux et les victimes cohabitent tant bieen que mal dans les
villages. Un tel jugement risque de faire rouvrir des cicatrices mal fermées…
Eurasie : Venons-en au silence de la communauté
internationale à propos des massacres par les khmers rouges. Qui est à blâmer ?
François Ponchaud : La gauche française qui, si elle a eu raison de manifester
contre la guerre au Vietnam, s’est aveuglée totalement à partir de 1975, à cause
d’à priori politiques. Plus largement, les gouvernements européens et spécialement
la France (qu’on ne dise pas que les autorités ne savaient pas ! Ou alors il
faut supprimer tous les services de renseignements ! Le 8 octobre 1975, J’ai
fait remettre, en mains propres, un état de la situation au Cambodge à Giscard
d’Estaing, président de la République française, qui allait recevoir Sihanouk le
lendemain, en route pour l’ONU... J’attends toujours un accusé de réception).
Il fallait se ménager le grand marché chinois ! Un bon point, par contre, pour le
Parti socialiste qui, s’il s’est trompé initialement, a enquêté sur la
situation au Cambodge, avant et après 1981.
Eurasie : Et à part les politiques ?
François Ponchaud : Amnesty International (à qui j’ai fourni des dossiers, et
dont les dirigeants sont venus me rencontrer à Paris en 1976), la Ligue des Droits de
l’Homme (j’ai envoyé des dossiers à Mr Noguères, alors président), qui
n’ont pas pris les choses au sérieux ! On peut essayer de comprendre les raison
de ce silence en le replaçant dans le climat politique de fin de guerre froide !
Mais un peu de modestie pour juger les assassins dont on s’est rendu complices par le
silence ! Steve Heder, actuellement le responsable de l’information auprès du
tribunal, et excellent connaisseur du problème khmer rouge, les soutenait jusqu’en
1979, et était chargé de mission à Amnesty !
Eurasie : Le jugement des ex-responsables Khmers
rouges aidera t-il les Cambodgiens à effectuer leur devoir de mémoire ?
François Ponchaud : C’est une perception très occidentale. En 2005, la
municipalité de Phnom Penh a loué l’ossuaire de Choeung Aek, où sont rassemblé
les ossements des cadres khmers rouges assassiné à Tuol Sleng, pour 30 ans à une
société japonaise ! A en perdre son khmer ! Le musée du génocide de Tuol
Sleng devait subir un sort semblable, mais, à la suite de pressions internationales, les
autorités gouvernementales ont fait marche arrière. On parle de Tuol Sleng, la prison
où ont été torturés près de 17.000 cadres khmers rouges, mais on ne parle presque
jamais des quelques 250 centres de tortures où sont morts les paysans.
Eurasie : Ne faut-il pas juger, ne serait-ce que
pour le principe ?
François Ponchaud : Plus de 60 % des Cambodgiens sont nés après le régime
des Khmers rouges et ne s’en soucient que comme de l’histoire
antédiluvienne !
Eurasie : Qui s’en soucie alors ?
François Ponchaud : Ce sont les Occidentaux qui, une fois de plus,
s’intéressent à l’histoire du Cambodge et l’interprètent selon leurs
critères propres. Laissons les Khmers responsables de leur histoire et de leur tribunal,
y compris financièrement. Jusqu’où aller dans le "devoir
d’ingérence", quand on est coupable de n’avoir rien fait pendant
"trois ans huit mois et vingt jours". Devoir de bonne conscience ?
Eurasie : Que faire ?
François Ponchaud : Il convient de replacer le jugement, si jugement doit-y avoir,
dans son contexte culturel. Si l’on ne peut que condamner les actions des Khmers
rouges, il faut cependant tenter de comprendre, sans plaquer nos concepts occidentaux sur
les réalités cambodgiennes.
Eurasie : Pouvez-vous nous donner des
exemples ?
François Ponchaud : Oui, ils vous permettront de mesurer l’écart entre les
mentalités européennes et cambodgiennes. Un chef de la police (du plus haut niveau), qui
a passé 18 ans en France avant de prendre ses fonctions dans le deuxième Royaume du
Cambodge, interprétait ainsi le passé récent : "Indra était en colère, à
cause des péchés des Khmers. Il a envoyé les Khmers rouges pour faire le ménage, puis
il a envoyé une divinité sévère pour les chasser, c’est Hun Sen. Maintenant
qu’ils sont chassés, le génie Saravaoan qui le protège, et qui habite au Phnom
Chiso, a cessé son rôle de protecteur". Hun Sen a modifié sa date de naissance
pour être né un jour de pleine lune, car le mot "pleine lune" est très proche
phonétiquement de "pleine puissance".
Eurasie : C’est déroutant…
François Ponchaud : Ecoutez cet autre exemple. Un moine moderniste, formé en France
depuis 1973, disait, à un groupe de Français, en 1996, qu’il était inutile de
vouloir juger les Khmers rouges, car c’étaient des ignorants, qui n’avaient pas
compris la loi de l’enchaînement des causes et les effets, qu’ils étaient
déjà jugés par la loi du Karma. "En voulant les juger, vos pensées sont
mauvaises, car vous avez un esprit de vengeance dans le cœur". Même réflexion
du moine Tep Vong, patriarche suprême de l’ordre Mohanikay. Un bouddhiste qui a
perdu toute sa famille, dont l’avenir pourtant prometteur a été compromis par le le
régime khmer rouge, affirme dans Cambodge Soir, en juillet 2006, qu’en tant que
bouddhiste, il n’a pas d’esprit de vengeance. Une femme, catholique de
surcroît, qui a perdu 8 enfants sur douze et dont le mari a été tué parce douanier,
affirme le plus naturellement du monde , en 1980 : "Si je rencontre celui qui a
tué mon mari et mes enfants, je ne lui en voudrai pas, c’était son karma,
c’était mon karma".
Eurasie : D’où vient cette absence de
désir de vengeance ?
François Ponchaud : La société khmère est une société où la notion de personne
est absente : l’être humain n’est qu’un agrégat d’énergies,
contingent, temporaire, sans sujet, la vie n’est qu’une période de
purification. Les énergies vitales se chargent de positif ou de négatif, en fonction des
actes posés, jusqu’à l’épuisement total du karma, au terme de plusieurs vies
purificatrices. Partant de là, il n’y a pas de pardon : "C’est celui
qui mange qui est rassasié", "Celui qui fait le bien, obtient le bien, Celui
qui fait le mal, reçoit le mal". Il n’y pas de rééducation possible, car les
mérites ou les démérites, suivent l’être humain comme son ombre. Il y a eu
indiscutablement, une certaine connivence entre les bourreaux et les victimes.

Eurasie : Les khmers rouges y croyaient
vraiment ?
François Ponchaud : Quelque temps avant sa mort, Kaè Pauk, adjoint de Ta Mok,
boucher du Cambodge, était persuadé d’avoir bien agi, en permettant à ses victimes
de vivre mieux dans une vie future… Jusqu’en 1977, on tuait dans les forêts,
lieu de la régénération ; les cavernes et grottes, symbole de l’appareil
féminin et origine de la vie, étaient souvent remplies de cadavres.
Eurasie : En définitive, comment
s’organise traditionnellement le pouvoir au Cambodge ?
François Ponchaud : La société khmère est une société de type clanique :
c’est un groupe de membres, alliés par les liens matrimoniaux ou des liens
d’intérêts qui détiennent le pouvoir. Cela était vrai durant la période
sihanoukiste, du temps des Khmers rouges, et encore beaucoup plus évident de nos
jours : les gens de pouvoir, ministres, militaires, hommes d’affaires, marient
leurs enfants entre eux. Celui qui a l’autorité, détient le pouvoir de vie et de
mort sur ses subordonnés. Quand on demande pardon, on demande que le grand "ne soit
pas en colère", ou que "je n’aie pas à craindre sa colère". Le
grand a toujours raison, le petit a toujours tort. C’est une société basée sur la
"clientèle". D’une façon générale, le Cambodgien a peur de celui qui
détient l’autorité. Ce ne sont ni les idées politiques, ni les idées religieuses
qui dirigent le peuple, mais avant tout les avantages matériels à rejoindre un
clan : "On entre dans le fleuve par ses méandres, on entre dans la pays par ses
coutumes". De tout temps, la vie politique cambodgienne n’a pratiqué que
l’exclusion, souvent physique, rarement la concertation. Le chef n’accepte pas
la contradiction, sinon à quoi bon être chef !
Eurasie : Le tribunal permettra t-il
d’établir un état de droit ?
François Ponchaud : Il n’est pas évident qu’en jugeant les
ex-responsables khmers rouges, et à fortiori, eux seuls, on lutte contre
l’impunité, alors que les organismes financiers internationaux ont laissé, et
continuent de laisser déboiser le Cambodge (ainsi que la Thaïlande, l’Indonésie,
l’Amazonie…). Aux Philippines et en Indonésie, il n’y a pas eu les Khmers
rouges, mais le pays a été mis en coupe réglée par les dirigeants. C’est le
peuple qui a renversé les dirigeants corrompus, Marcos ou Suharto… "La
démocratie ne se décrète pas !", elle jaillit du peuple, au terme d’un
long processus.
Eurasie : Comment aider le peuple khmer à se
battre pour la démocratie et la justice ?
François Ponchaud : Actuellement, il y a "le peuple", c’est-à-dire
les membres du Parti du Peuple, au pouvoir, à qui appartient le pays, dans une logique
féodale, et la population, qui n’a aucun droit. Le pays est sous la coupe d’une
maffia qui détient tous les pouvoirs. Jugeons les Khmers rouges, sans oublier les
ex-Khmers rouges au pouvoir à Phnom Penh, qui sont en train de créer les conditions
objectives d’une nouvelle explosion de violence, comme le craint le roi-père
Sihanouk, ainsi que les représentants successifs du secrétaire général de l’ONU
pour l’observation des Droits de l’homme au Cambodge ! On peut dénoncer
les massacres et exactions en tous genres des Khmers rouges, mais à part Ieng Sary, aucun
d’entre eux ne s’est enrichi, ni n’a placé un magot à l’étranger.
C’étaient des nationalistes intransigeants et utopiques. On ne peut en dire autant
des dirigeants actuels qui dépècent le pays à leur propre profit.
Eurasie : Les dirigeants khmers ne sont pas les
seuls à être corrompus…
François Ponchaud : C’est vrai. L’avantage, ou le désavantage, du
Cambodge est d’être un petit pays dans lequel la presse (internationale) est libre,
et tout se sait, ou finit par se savoir… Le jugement des ex-responsables khmers
rouges ne suffira pas à établir un état de droit, tant que la communauté
internationale ne respectera pas, elle aussi, le droit et la justice.
Propos tenus le 3 novembre 2006 et remaniés sous la
forme d’un entretien par Emmanuel Deslouis.
Bibliographie
Cambodge, année zéro, Julliard, 1977 (Kailash, 1998).
La cathédrale de la rizière, Fayard, 1990 (CLD éditions,
2006).
Prêtre au Cambodge. François Ponchaud, l’homme qui révéla au
monde le génocide de Benoît Fidelin, Albin Michel, 1999.
|