|
| |
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-641295,1-0,0.html
 Vue du camp de
concentration d'Auschwitz en Pologne prise par la Vue du camp de
concentration d'Auschwitz en Pologne prise par la
Royal Air Force britannique le 23 août 1944.
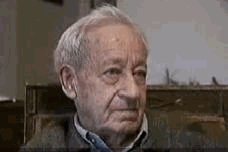
Souvenirs d'un historien
LE MONDE DES LIVRES | 26.09.05 | 13h44
Vous avez consacré toute votre vie à l'étude de l'antisémitisme en vous
préoccupant de tous ses aspects : ses origines, son évolution, ses manifestations
diverses, ses causes. Le lecteur de vos livres peut constater que toutes sortes de
délires, à la fois variés et monstrueux, se sont développés à propos des juifs tout
au long de l'histoire occidentale, bien avant le génocide nazi. Après plusieurs
décennies passées à ces recherches, avez-vous l'impression que la forme prise par
l'antisémitisme à chaque époque doit s'expliquer seulement par les conditions
spécifiques, ou bien pensez-vous que l'on peut discerner une cause principale à cette
série de phénomènes historiques différents ?
J'en suis venu à penser qu'il n'y a qu'une seule cause. Cette haine s'exprime dans des
manifestations historiques qui, selon les époques et les milieux, peuvent être variées.
Mais elle possède à mes yeux une origine datable dans l'histoire humaine. Celle-ci n'est
pas forcément liée à l'existence de l'ancêtre Abraham, que certains archéologues
mettent en doute, comme d'ailleurs l'existence de Moïse. Que Moïse et Abraham aient
existé ou non, il est sûr, même si la date demeure incertaine, que quelqu'un, dans le
Proche-Orient, s'est opposé au sacrifice d'enfants qui était courant dans l'ensemble des
pourtours de la Méditerranée. C'est là, à mes yeux, que tout commence. C'est le
fondement même du judaïsme ; voyez les promesses divines faites à Abraham : "
Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et multiplierai ta
postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as
obéi..." (Gen. XXII, 17-18).
" Il existe aujourd'hui de vrais risques d'autodestruction de l'humanité dans son
ensemble "
" Et ce furent précisément les raisons des haines païennes. Là encore, je
pourrais citer la Bible ; mais laissons parler Tacite, le prince des historiens romains :
" Moïse, pour mieux s'attacher à l'avenir la nation, institua de nouveaux rites,
opposés à ceux de tous les autres mortels. Là tout ce que nous révérons est en
horreur ; en revanche, tout ce qui est impur chez nous est permis (...). On dit qu'ils
adoptèrent le repos du septième jour parce que c'est le jour qui mit fin à leurs
misères ; ensuite, flattés par la paresse, ils donnèrent aussi à l'oisiveté la
septième année. "
" Plus loin, Tacite s'en prend aux " sinistres " institutions juives,
ainsi qu'à leur misanthropie : " Jamais ils ne mangent, jamais ils ne couchent avec
des étrangers, et cette race, quoique très portée à la débauche, s'abstient de tout
commerce avec les femmes étrangères (...). Pourtant, ils ont grand soin de
l'accroissement de la population. Ils regardent comme un crime de tuer un seul des enfants
qui naissent ; ils croient immortelles les âmes de ceux qui meurent dans les combats ou
les supplices ; de là, leur amour d'engendrer et leur mépris de la mort."
" Finalement, il suggère une sorte de génocide, car il abomine également les
chrétiens. Voici le passage : " Ces religions, quoique hostiles entre elles,
provenaient des mêmes auteurs ; les chrétiens étaient sortis des juifs ; la racine une
fois arrachée, la tige périrait plus facilement. "
" Je pourrais vous citer d'autres auteurs, par exemple Sénèque qui
prophétisait, plus de deux siècles à l'avance et sans encore distinguer entre juifs et
chrétiens, que le monothéisme s'imposerait partout ; ou bien, vers l'an 300, le sophiste
grec Philostrate, selon lequel les juifs étaient haïs dans tous les pays. Mais bien plus
remarquable est le fait qu'actuellement ces questions sont de nouveau à l'ordre du jour
car, en France mais surtout en Allemagne, des discussions se poursuivent autour de
l'infanticide.
" En effet, selon certains historiens ou sociologues, les crimes staliniens sont
comparables aux crimes hitlériens (ce contre quoi s'élevait Raymond Aron). Or, dans le
III Reich, les enfants juifs prenaient le chemin des chambres à gaz, tandis que dans feue
l'Union soviétique ceux des déportés politiques ou des koulaks étaient"
rééduqués " et pouvaient faire d'excellentes carrières ; je me souviens d'un film
russe datant de la fin des années 80 dans lequel le cinéaste (dont j'ai oublié le nom)
dépeignait son existence passée.
" Il va de soi que certains Allemands sont particulièrement exaltés, tel le
professeur berlinois Ernst Nolte, qui, sur la quatrième de couverture de son dernier
ouvrage, écrit qu'il faut " se consacrer aux thèses qui ont été tabouisées,
notamment aux écrits des révisionnistes radicaux ".
Faut-il en conclure que l'antisémitisme est sans fin ?
Cette agitation qui dure depuis trois millénaires, qui fut par exemple "
antimosaïque " dans l'Antiquité et devint "antisioniste " au vingtième
siècle, connaîtra probablement au vingt et unième siècle de nouveaux prolongements,
sous de nouvelles formes ou avec de nouveaux arguments, mais je ne crois pas qu'elle
puisse disparaître. Il est en effet relativement facile de constater, bien qu'il soit
très difficile de parvenir à le comprendre, que le monothéisme et l'antisémitisme sont
des frères jumeaux, puisque, j'y reviens, l'innovation dite abrahamique ne pouvait que
susciter une levée de boucliers parmi les partisans des moeurs traditionnelles.
" Jirinovski est un clown, rien de plus "
" A mes yeux, la question n'est pas de savoir si l'antisémitisme aura disparu au
siècle prochain, mais de savoir si l'humanité existera toujours dans cent ans. Car la
prolifération incontrôlée des armes nucléaires ou la multiplication des armes
biologiques donnent l'impression que tout devient possible. Il existe aujourd'hui, me
semble-t-il, de vrais risques d'autodestruction de l'humanité dans son ensemble. Et ce
danger réel s'accompagne d'une sorte de désarroi universel qui a quelque chose de
lamentable.
Ce désarroi vous paraît-il de nature à favoriser un retour massif de
l'antisémitisme dans certaines sociétés déstabilisées, comme par exemple l'actuelle
Russie ?
Le cas russe est très particulier. Il faut remonter au Grand Schisme du onzième
siècle : tandis que l'Eglise romaine s'en tint à la doctrine de saint Augustin selon
laquelle les juifs devaient être tolérés, l'Eglise grecque orthodoxe la rejeta.
" Les conséquences se manifestèrent au seizième siècle, après la fin du joug
mongol ; Ivan le Terrible interdit alors aux juifs l'accès de la Moscovie, et ce ne fut
que lors des annexions de Pierre le Grand et de Catherine II (pays baltes, Pologne) que
des centaines de milliers de ceux-ci furent assujettis à l'empire russe. Ils furent alors
assignés à résidence, et seuls les plus riches (notamment les marchands de première
guilde) furent autorisés à s'installer en Russie proprement dite. Aussi bien l'antique
méfiance allait subsister : deux exemples suffiront. D'abord Dostoïevski, qu'on peut
ranger parmi les antisémites les pires, sinon que son génie lui faisait introduire dans
ses tirades un certain doute, voire un point d'ironie. Ensuite Léon Tolstoï, qui dans
Anna Karénine avait fort malmené le banquier juif Poliakov (sous le nom de Boulganirov),
mais s'en repentit sur ses vieux jours, et voulut camper dans son dernier roman,
Résurrection, un déporté juif exemplaire.
Le retour des déportés
LEMONDE.FR | 18.07.05 | 11h13 • Mis à jour le 29.07.05 | 12h16
Au printemps 1945, deux millions de Français à rapatrier
Après le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942 et la victoire
soviétique à Stalingrad en février 1943, commence de s'esquisser la possibilité d'une
victoire sur l'Allemagne. Les Alliés doivent envisager dès l'été 1943 le futur
rapatriement des personnes déplacées en Allemagne ou dans les territoires occupés par
le Reich.
La situation des Français est particulièrement complexe : outre les quelque 2 500 juifs
et 40 000 déportés politiques qui survivront à la déportation, ce sont 940 000
prisonniers de guerre, 737 000 travailleurs civils, volontaires ou appelés du STO
(service du travail obligatoire), qu'il convient de prendre en charge. Enfin, environ 350
000 Alsaciens, devenus Allemands après l'annexion de l'Alsace par le Reich, avaient été
déplacés.
LES PRISONNIERS DE GUERRE
En 1940, lors de la débâcle française, plus de 1,8 million de soldats français avaient
été capturés par les Allemands. Submergées par ce nombre, les autorités allemandes en
avaient retenu 1,6 million hors du territoire français. Entre 1940 et la fin de 1944,
environ 475 000 d'entre eux furent rapatriés pour des motifs divers, 62 000 se virent
libérés, tandis que l'on compta 71 000 évasions et une vingtaine de milliers de
disparus.
Les prisonniers de guerre ont conservé, tout au long du conflit, la possibilité
d'échanger du courrier avec leurs proches, mais aussi de recevoir des colis. Le
gouvernement de Vichy était informé, pour l'ensemble d'entre eux, des oflags et stalags
dans lesquels ils étaient retenus, ce qui facilita grandement leur accueil au moment de
leur libération.
TRAVAILLEURS VOLONTAIRES ET STO
Les travailleurs civils relevaient de trois catégories. La première, la moins nombreuse,
comprenait les volontaires partis en Allemagne à partir de l'automne 1940. Ils furent
environ 80 000. En juin 1942, alors que l'Allemagne est engagée sur un front russe qui
mobilise une grande partie des hommes en âge de travailler, Berlin exige l'envoi de
nouveaux volontaires. Pétain croit pouvoir convaincre un plus grand nombre de candidats
en négociant le principe de l'échange de trois volontaires envoyés pour un prisonnier
de guerre libéré, mais seuls 80 000 Français répondront à l'appel. En février 1943
est instauré par Vichy le service du travail obligatoire, dans le cadre duquel environ
700 000 jeunes Français partiront en Allemagne.
Dès novembre 1943, le Comité français de la libération nationale (CFNL) confie à
Henri Frenay, fondateur de l'organisation de résistance Combat, la responsabilité du
commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés. Le commissariat sera mué en
ministère en juin 1944, lorsque le CFNL se proclamera gouvernement provisoire de la
République française (GPRF).
UN RAPATRIEMENT CHAOTIQUE
Les autorités héritent en la matière des documents du régime de Vichy, qui, comme le
rappelle Marie-Anne Matard Bonucci (La Libération des camps et le retour des déportés,
Complexe, Bruxelles, 1995), "se préoccupait exclusivement du sort des prisonniers de
guerre". Elles ne sont en revanche pas informées de la situation des déportés dits
"raciaux" et de la majorité des déportés politiques.
L'état-major allié fait de la victoire militaire sa priorité. Le rapatriement ne devait
avoir lieu, pour l'essentiel, qu'après la période des combats. De nombreux déportés
ont dû attendre plusieurs semaines entre la libération et leur retour. En outre, lors du
rapatriement, la priorité est fréquemment donnée aux prisonniers de guerre.
Guillaume Pélissier-Combescure
Paroles revenues de l'extrémité de l'enfer
LE MONDE DES LIVRES | 05.09.05 | 09h34 • Mis à jour le
05.09.05 | 09h34
Entre 1945 et 1980, la terre de Birkenau dévoila de surprenants vestiges. Des carnets
presque illisibles retrouvés près des chambres à gaz. Ils avaient été rédigés par
des membres du Sonderkommando, l'expression qui, dans la langue nazie riche en
euphémismes sinistres, désignait l'" unité spéciale " constituée des
déportés chargés d'évacuer et d'incinérer les cadavres. Des centaines de juifs furent
ainsi employés à effacer les traces de leurs coreligionnaires, avant d'être
assassinés, parce qu'ils étaient juifs et en savaient trop.
Bibliographie
Des voix sous la cendre, Manuscrits des Sonderkommandos d'Auschwitz-Birkenau
Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 448 p., 22 .
jo wajsblat, l'enfant de la chambre à gaz,Dessins d'Alec Borenstein, textes de Gilles
Lambert, préface de Serge Klarsfeld, TR éd. (2 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris), 34 .
[-] fermer
Trois de ces manuscrits sont aujourd'hui réédités dans un recueil qui réunit d'autres
témoignages, inédits en français, de rescapés du Sonderkommando, ainsi que d'utiles
mises au point factuelles. Il est inutile d'insister sur l'intérêt capital des
documents, écrits sur les lieux du pire des crimes au moment où celui-ci était
perpétré et par ceux-là mêmes qui étaient contraints de l'accomplir. D'une précision
insupportable, ils décrivent l'extermination industrielle qui permit de brûler jusqu'à
8 000 corps par jour, nous plongeant au coeur de cette " zone grise " que Levi
définissait comme le point où se brouille la frontière entre la victime et le bourreau.
Que faire lorsqu'on risque d'être jeté vif dans le crématoire en tentant d'alerter ceux
q u'on mène aux chambres à gaz ? N'a-t-on pas inconsciemment intérêt à ce que
l'affreux travail continue quand on sait que les périodes de relâche sont celles où les
nazis liquident le Sonderkommando et le renouvellent ? Certains semblent s'être
habitués, d'autres se suicidèrent, d'autres enfin tentèrent, le 7 octobre 1944, un
soulèvement, noyé dans le sang par les SS.
Jo Wajsblat croise le regard de l'un de ces hommes en septembre 1944. Déporté à 15 ans
à Birkenau, il échappe à la mort jusqu'au jour où il est conduit à la chambre à gaz.
Un miracle se produit : au bout de quelques secondes, les portes se rouvrent, sur
décision du docteur Mengele d'utiliser quelques-uns de ces hommes pour ses terribles
expérimentations. Le sort exceptionnel de Wajsblat, déjà connu ( Le Témoin imprévu,
éd. Florent Massot et François Millet, 2001), est raconté dans un album illustré d'une
cinquantaine de planches en noir et blanc, exécutées par le peintre Alec Borenstein, à
qui Wajsblat a demandé de fixer les images qu'il gardait en mémoire.
A la lecture de ces textes, on pense à David Rousset, rescapé de Buchenwald, qui, dans
L'Univers concentrationnaire, écrivait : " Les hommes normaux ne savent pas que tout
est possible. "
Thomas Wieder
L'absence d'une histoire des Justes mutile
l'histoire de la Shoah"
LE MONDE DES LIVRES | 29.08.05 | 10h29 • Mis à jour le 29.08.05 | 13h19
Né en 1924, Lucien Lazare a fait ses études secondaires à Lyon où, venant d'Alsace, il
était replié pendant l'Occupation. Membre des Eclaireurs israélites de France, il
participa au sauvetage d'enfants juifs dans le cadre d'un réseau organisé, rejoignit le
maquis dans le Tarn avant de s'engager dans la Première Armée.
Enseignant en France et en Belgique après-guerre, il s'établit en Israël en 1968 où il
assura quinze années durant la direction du lycée René-Cassin de Jérusalem. L'âge de
la retraite venu, il entreprit un travail d'historien, signant en 1987 chez Stock La
Résistance juive en France, dont le regretté Claude Lévy estimait qu'il s'agissait du
" premier travail d'ensemble sur la résistance juive en France ", écrivant
ensuite la biographie de l'abbé Glasberg, publiant enfin, il y a dix ans, un Livre des
Justes chez J.-C. Lattès.
Devenu parallèlement expert auprès de Yad Vashem, Lucien Lazare a progressivement été
amené à mieux prendre la mesure de l'importance du sauvetage des juifs effectué en
France pendant les années noires. Il a été étroitement associé au grand projet d'une
Encyclopédie européenne des Justes relatant les actes de sauvetage de personnes
isolées, de familles et de groupements ayant entrepris de sauver des juifs voués à la
mort. Le premier volume est ce Dictionnaire des Justes de France édité sous la direction
d'Israël Gutman, avec une préface de Jacques Chirac (Fayard/Yad Vashem, 600 p., 40 ).
Peu après sa création, l'Etat d'Israël décida d'honorer la mémoire des martyrs de la
Shoah. Une loi votée par la Knesset en 1953 instituait le Mémorial Yad Vashem sur la
colline du Souvenir à Jérusalem. Le texte affirmait la volonté de distinguer les
non-juifs ayant risqué leur vie et celle de leurs proches pour sauver des juifs. Une
commission de trente-cinq membres a pour tâche de désigner ces Justes au terme d'une
procédure visant à établir la réalité des faits.
Jusqu'à la fin de 1999, le titre de Juste des Nations a été décerné à plus de 17 000
personnes. S'il est vrai que plus de 2 000 sauveurs en France sont connus grâce aux
témoignages de ceux qui leur doivent d'avoir survécu, des sauveurs en nombre sans doute
plus grand n'ont pas encore été identifiés et ne le seront probablement jamais. La
clandestinité stricte qui prévalut dans quantité de sauvetages a du même coup
condamné leurs acteurs et leurs auteurs à un anonymat total. De passage à Paris, Lucien
Lazare, qui a établi l'édition du Dictionnaire, a bien voulu répondre à nos questions.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire des Justes ?
Quand j'ai commencé ma recherche sur les organisations juives de résistance, je les
envisageais comme s'insérant dans l'histoire militaire de la Résistance. J'ai découvert
que le gros de toute cette affaire, c'était une histoire de sauvetage. Les organisations
juives de résistance ont été créées par un tout petit nombre de leaders, la plupart
jeunes, dirigeants de mouvements de jeunesse, qui étaient conscients du fait que personne
en France ne prenait en charge ce que nous appelons aujourd'hui le sauvetage des juifs.
Sans pour autant éliminer toute participation à la lutte armée, ces organisations ont
eu pour vocation primordiale et prioritaire le sauvetage. C'est ce que j'ai graduellement
découvert au cours de mes recherches. En y réfléchissant, j'ai pris conscience que ma
propre histoire, qui, à partir d'août 1942, avait fait de moi un convoyeur d'enfants
pour les camoufler, était significative de ce que furent essentiellement ces
organisations juives de résistance.
Quelle en est la fonction de la médaille des Justes ?
Il s'agit de manifester symboliquement de la gratitude à celles et à ceux qui, en
prenant des risques, et de façon désintéressée, ont sauvé des juifs sous
l'Occupation. Il s'agit aussi de faire oeuvre de pédagogie en écrivant un chapitre de
l'histoire de la Shoah qui fait défaut. Nous avons la conviction, à Yad Vashem, que
l'absence de ce chapitre mutile cette histoire.
Comment déterminez-vous la qualité de Juste de quelqu'un dont on vous signale l'action
passée ?
C'est la tâche des rapporteurs de la commission des Justes. Je suis moi-même rapporteur
pour la France. La situation classique, c'est une requête adressée à Yad Vashem par un
juif qui a été sauvé. Dans les années 1960, 1970 et même 1980, la majorité des
sauveurs étaient encore en vie. Aujourd'hui, c'est devenu l'exception. La médaille est
donc remise aux descendants.
Comment penser et évaluer l'action menée par les Justes en France ?
Nous préparons dès maintenant un additif à ce dictionnaire puisque, pour l'année 2003,
nous avions déjà reçu cinquante requêtes nouvelles au 31 mai. Nous souhaiterions
susciter un travail de recherche sur la protection informelle dont ont bénéficié les
juifs, un type de protection qui ne légitime pas l'ouverture d'un dossier pour délivrer
la médaille des Justes mais qui néanmoins est incontestable. Il y a des localités
entières où les juifs ont été protégés. Je souhaiterais que le CNRS constitue une
espèce de banque de données concernant les juifs rescapés de l'Occupation. En France,
ils sont plus de 250 000. Combien d'entre eux ont été sauvés par des Justes ? On ne le
saura jamais, mais ce doit être de l'ordre de 30 000 personnes peut-être. Mais les
autres ?
Il y a eu bien sûr des stratégies de survie individuelle, mais sur un fond favorable à
la protection des juifs. Prenons la notice consacrée à Zoé David. Elle vivait à
Saint-Léger, une commune des Alpes-Maritimes de 80 habitants. Eh bien, tout le village a
protégé les juifs mais celle qui a pris des risques, c'est Zoé David. Les villageois,
il faut les distinguer d'une manière ou d'une autre. À mon avis, cette histoire-là n'a
pas encore été écrite. Il y a là un immense travail à mener, celui de l'inventaire
des juifs rescapés de l'Occupation.
Laurent D
Déportation juive de France
La communauté juive vivant en France se composait, en juin 1940,
d'environ 350 000 personnes, dont la moitié étaient étrangères ou apatrides : la
France avait accueilli, entre les deux guerres, beaucoup de réfugiés fuyant les mesures
antijuives ou les pogroms, de Pologne et d'Allemagne notamment.
Le camp de Drancy en banlieue parisienne est ouvert en août 1941 pour y interner d'abord
les juifs étrangers, afin de les remettre aux autorités allemandes. Le 27 mars 1942, le
premier convoi de déportation, organisé par les Allemands, quitte Drancy et la gare de
Bobigny, avec 1 100 personnes. Direction : Auschwitz. Les rafles du Vél d'Hiv des 16 et
17 juillet 1942 et celles de la zone Sud en août (effectuées exclusivement par la police
française dans cette zone non occupée alors) visent d'abord les juifs étrangers. Plus
de 13 000 d'entre eux, dont 4 115 enfants sont alors déportés en quelques jours.
En 1944, "deux tiers des juifs [de France] vivent dans la clandestinité, aidés par
la population ou l'Eglise, par les réseaux d'assistance, juifs ou non, intégrés à la
Résistance, juive ou non, bénéficiant parfois de lieux d'asile exemplaires, telle la
zone d'occupation italienne, entre novembre 1942 et septembre 1943", écrit Georges
Bensoussan dans son Histoire de la Shoah ("Que sais-je ?", PUF, 1997). Le
dernier convoi de déportation de France est parti le 17 août 1944.
Au total, 76 000 juifs, dont 11 000 enfants presque tous gazés, ont été déportés de
France et 3 % d'entre eux seulement sont revenus des camps.
Les trois quarts de la communauté juive vivant en France ont survécu, dans la
clandestinité ou dans l'exil. "L'impossibilité de créer en France des ghettos, un
siècle et demi d'intégration et d'émancipation, la dispersion des juifs et l'aide
fréquente du milieu environnant, le rôle de la géographie enfin expliquent que le bilan
n'ait pas été plus lourd", estime Georges Bensoussan.
Déportation dite "politique"
Après plus de cinq années de recherches menées, à partir de 1996, avec l'université
de Caen et le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, la Fondation pour la mémoire
de la déportation a recensé 85 000 déportés de France (dont 10 % de femmes), en raison
de mesures de répression prises par l'occupant allemand ou le régime de Vichy durant la
guerre. Les chiffres publiés antérieurement étaient plus aléatoires.
Ces déportés l'ont été, dans leur grande majorité, pour faits de résistance ou pour
appartenance à des mouvements politiques (le Parti communiste avait été interdit dès
1939). Il y eut aussi parmi eux des otages et des Tziganes. Bien que victimes de mesures
restrictives prises dès avant l'occupation allemande, les Tziganes vivant en France ne
furent pas déportés, sauf ceux vivant dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais, rattachés au gouvernement militaire allemand de Bruxelles dès 1939.
Sur ces 85 000 déportés dits "politiques", 60 % sont revenus des camps, après
leur libération par les Alliés.
Aux Noirs victimes de l'horreur nazie
LE MONDE DES LIVRES | 17.02.05 |
L'histoire des persécutions nazies recèle encore des zones méconnues. En marge des
travaux sur le génocide des juifs, les recherches ont porté sur d'autres cibles de
l'idéologie du IIIe Reich - Tziganes, malades mentaux, homosexuels. Mais les épreuves
subies par les Noirs, considérés eux aussi comme des "sous-hommes", restent
peu étudiées.
Bibliographie
"Noirs dans les camps nazis" de Serge Bilé. Le Serpent à plumes,
"Essais/Documents", 160 p., 15,90 €.
[-] fermer
Le livre de Serge Bilé, qui entreprend d'éclairer cette histoire occultée, se fonde sur
plusieurs sources : témoignages de survivants qu'il a lui-même recueillis, recherches
menées par des historiens allemands, récits d'anciens combattants noirs célèbres,
comme l'ancien président du Sénégal Léopold Sedar Senghor ou le poète antillais Aimé
Césaire.
A l'avènement de Hitler, les Noirs d'Allemagne sont soumis au même traitement que les
juifs. Les lois de Nuremberg de 1935, qui répriment les "non-Aryens",
s'appliquent aux juifs et aux Noirs. Plus tard, dans les pays occupés, les Noirs, qu'ils
soient civils, combattants ou résistants, originaires d'Europe, d'Afrique, des Antilles
ou des Etats-Unis, subiront des persécutions spécifiquement liées à leur couleur de
peau.
Les premiers Noirs visés par le nazisme sont les immigrés issus des anciennes colonies
allemandes. L'Allemagne du IIe Reich a annexé la Namibie, le Cameroun, le Togo et le
Tanganyika (l'actuelle Tanzanie). C'est là que les premiers camps de concentration ont
été expérimentés, notamment à l'encontre du peuple herero, en lutte contre le
colonisateur : le terme de Konzentrationslager apparaît officiellement pour la première
fois en Namibie en 1905.
Le gouverneur nommé en Namibie est Heinrich Goering, le père du futur dignitaire nazi
Hermann Goering. Ses méthodes expéditives ne viennent pas à bout de la résistance, et
le général en chef donne, en 1904, un ordre d'extermination (Vernichtungsbefehl) des
Hereros. 80 % de la population sont éliminées en quelques mois. Les survivants sont
regroupés dans des camps de concentration, où des expérimentations anthropologiques et
médicales sont conduites par le docteur Eugen Fischer. C'est lui qui, dans une Allemagne
gagnée au nazisme, dirigera l'institut d'anthropologie et d'eugénisme de Berlin,
épaulé par son assistant, Josef Mengele, le futur bourreau d'Auschwitz.
L'essor du Parti nazi s'appuie sur le sentiment d'humiliation nationale qui suit la
défaite de 1918. Or l'armée française victorieuse était largement composée de
bataillons coloniaux, comme les soldats africains étaient bien présents au sein des
troupes d'occupation stationnées en Rhénanie en vertu du traité de Versailles. Au
Reichstag, des députés dénoncent la "honte" que constitue l'utilisation de
"troupes noires (...) dans un pays de civilisation germanique". "Ces
sauvages représentent un effroyable danger pour les hommes et les femmes de ce pays. Leur
honneur, (...) leur pureté sont anéantis". Et Hitler, dans Mein Kampf, d'enfoncer
le clou : "Les Juifs ont emmené les Nègres en Rhénanie dans le but de souiller et
de bâtardiser la race aryenne."
Devenu chancelier, il prive tous les Allemands d'origine africaine de leur citoyenneté.
Les mariages mixtes sont interdits, les enfants noirs sont exclus des écoles.
"Aujourd'hui, les Noirs et les juifs sont victimes d'un terrorisme fasciste",
proteste en 1933 l'éditorialiste togolais du journal de Hambourg, The Negro Worker. En
1936, quand Hitler reprend la Rhénanie, la moitié des enfants issus de liaisons entre
femmes allemandes et soldats africains sont envoyés en camps de concentration, l'autre
stérilisée de force, sous l'autorité d'Eugen Fischer - un programme qui s'étend
bientôt à tous les Noirs d'Allemagne.
En France occupée, les soldats de la Wehrmacht prennent leur revanche sur les soldats et
les gradés noirs. Jean Moulin a raconté comment, en 1940, après le bombardement par des
Allemands d'un petit village proche de Chartres, deux officiers nazis lui avaient demandé
de signer un document prétendant que les victimes avaient été tuées par des
tirailleurs sénégalais. A la suite de son refus, il avait été torturé et jeté dans
un cachot auprès d'un soldat noir.
Massacres, déportations, exécutions sommaires : toute la violence hitlérienne se
déploie aussi contre les soldats et les résistants noirs. Aux Antilles françaises, de
nombreux jeunes gens - comme le psychiatre Frantz Fanon - s'enfuient vers les îles
voisines britanniques pour rejoindre la France libre.
"TOUTE LA DOULEUR DU MONDE"
Le nombre des déportés noirs dans les camps de concentration reste inconnu : les
populations originaires des colonies sont comptabilisées comme françaises. A Dachau,
Buchenwald, Neuengamme, Mauthausen, ils subissent le sort commun, mais ils sont en outre
humiliés en tant que Noirs (forcés à danser en rentrant du travail ou
"blanchis", entendez : torturés à l'eau pour ôter la couleur noire).
Parmi les soldats américains qui libèrent les camps en 1945 se trouvent des GI noirs.
Elie Wiesel a raconté leur entrée à Buchenwald : "Je me rappellerai toujours avec
tendresse ce grand soldat noir. Il pleurait comme un enfant. Il pleurait de douleur, toute
la douleur du monde, mais aussi de fureur."
L'auteur de Noirs dans les camps nazis s'est efforcé de retracer des parcours
individuels, simples anonymes ou jazzmen réputés. En restituant les histoires de vie et
les noms - ou au moins les surnoms, comme cette prisonnière de Ravensbrück cruellement
surnommée Blanchette -, Serge Bilé dépose une stèle à ces dizaines de milliers de
morts, civils ou combattants inconnus.
Catherine Bédarida
Article paru dans l'édition du 18.02.05
Imre Kertész : "Briser de l'intérieur les
limites de la langue"
LE MONDE | 11.07.05 | 11h44 • Mis à jour le 11.07.05 | 11h44
C'est la première fois que vous acceptez de recevoir un journaliste chez vous, à Berlin.
Il y a quelques années, vous avez quitté Budapest pour vous installer dans cette ville
qui fut la capitale du IIIe Reich. Et aujourd'hui, vous vous exprimez en allemand. N'y
a-t-il pas là un paradoxe pour quelqu'un qui a été déporté à Auschwitz à 15 ans et
dont l'oeuvre est entièrement marquée par l'expérience concentrationnaire ?
Berlin, il est vrai, est devenue ma patrie d'adoption. Cela peut paraître étrange, mais
je n'ai jamais considéré la Shoah comme la conséquence d'une haine irrémédiable des
Allemands envers les juifs. Sinon, comment expliquer l'intérêt des lecteurs allemands
pour mes livres ? C'est en Allemagne que je suis réellement devenu écrivain. Pas au sens
de la renommée, mais c'est en Allemagne que mes livres ont produit leur véritable
impression. Quant à la langue allemande, elle était obligatoire à l'école, en Hongrie.
Les auteurs étrangers n'étant pas traduits, je les ai découverts en allemand. Je suis
devenu traducteur - de Nietzsche, Hoffmanstahl, Schnitzler... - et je n'arrive pas à me
dire que la langue d'Arthur Schnitzler et de Joseph Roth est la langue des nazis.
L'allemand reste pour moi la langue des penseurs, pas des bourreaux.
En quoi a consisté cet accueil du public allemand ?
En Hongrie, je n'avais qu'un petit cercle de fidèles. En Allemagne, pour la première
fois, j'ai eu l'impression qu'un écrivain pouvait avoir de l'influence. Moi qui
appartiens à la dernière génération des survivants - ceux qui n'avaient même pas 15
ans à Auschwitz -, j'aireçu un très grand nombre de lettres de jeunes Allemands me
remerciant de leur avoir « expliqué » les camps de façon aussi nette et directe.
L'Allemagne, alors, avait déjà fait un gros travail sur elle-même, tandis qu'en Hongrie
le sujet restait tabou. Quand j'ai commencé mes recherches sur la Shoah, en 1961, je n'ai
quasiment rien trouvé. C'était pourtant l'année où débutait le procès Eichmann, mais
il ne faisait l'objet que d'entrefilets dans la presse hongroise. C'est par l'un d'eux que
j'ai appris l'existence d'un livre sur ce procès. Il était signé d'une femme dont
j'ignorais le nom, Hannah Arendt. Je l'ai cherché partout, mais il était introuvable à
Budapest. J'ai dû attendre la chute du Mur pour lire Eichmann à Jérusalem.
Vous venez de participer à l'adaptation au cinéma de votre livre Etre sans destin, par
le Hongrois Lajos Koltai. Le film doit sortir en France à l'automne. Comment peut-on
adapter un roman aussi analytique et distancié ?
J'ai mis quinze ans pour écrire Etre sans destin. Le roman et le scénario ne se
comparent donc pas. Mais il y a une strate romanesque qui peut être transposée au
cinéma : celle qui raconte comment un adolescent est méthodiquement spolié de sa
personnalité naissante.
Le titre du livre est d'ailleurs une conséquence éthique de la Shoah. C'est l'état dans
lequel vous vous trouvez lorsqu'on vous a confisqué jusqu'à l'idée même de votre
propre histoire. Un état où il est interdit de se confronter à soi-même. Tout le défi
du roman consistait à inventer une langue qui lie ces notions et indique une existence
verrouillée.
Comment avez-vous inventé cette langue ? Il vous est arrivé de dire que vous écriviez
pour « blesser » le lecteur ?
S'agissant de la Shoah, il est impossible d'écrire sans blesser, parce qu'on en transmet
le poids sur les épaules du lecteur. Il faut que les mots aient un effet, au sens de «
Wirkung », qu'ils entrent dans la chair. En même temps il y a là un paradoxe. Le roman
qu'on est en train d'écrire doit « plaire » au sens où le lecteur doit vouloir tourner
la page. C'est un piège dans lequel on l'attire pour qu'il soit réceptif. Si je suis
trop cruel ou odieux, je ne peux pas obtenir ce que je veux.
Mais c'est une réflexion que je me fais a posteriori. Il est évident que je n'avais pas
ça en tête quand j'ai écrit Etre sans destin. Pas du tout. Ce qui m'obsédait, c'était
d'éviter la pose littéraire. Je pensais à la toile de tente qui couvrait les tables des
librairies hongroises - une toile grossière où étaient posés les livres que l'on
pouvait acheter par cinq ou par dix pour quelques forints seulement. Je voulais retrouver
le grain brut de cette étoffe, quelque chose de fruste comme dans certains romans
populaires ou policiers. Pour cela, il fallait faire passer les détails au premier plan :
devant un gradé en uniforme, mon narrateur ne pense qu'au pou qui le démange. C'était
aussi une manière de montrer l'impossibilité d'écrire avec des moyens rationnels sur ce
monde-là.
Votre appréhension de la musique n'exerce-t-elle pas aussi une influence sur la manière
dont vous avez reconstruit la langue ?
C'est exact. J'en écoute toujours avant d'écrire. En ce moment, je suis avec Haydn et
Mozart. A l'époque d'Etre sans destin, j'étais hanté par la musique atonale : Berg,
Schoenberg... De la même façon, j'ai voulu créer une langue atonale. L'atonalité,
c'est l'annulation du consensus. Plus de ré majeur ou de mi bémol mineur. La tonalité
est abolie, comme les valeurs de la société. La basse continue elle aussi est détruite,
ce qui signifie que le sol (pas la note, mais le sol sur lequel vous marchez) n'est plus
fixe et que disparaît ce socle de références qui donnaient un fondement à l'action.
Des notions comme honneur ou bonheur deviennent risibles. Tout est en mouvement, rien
n'est certain. Du point de vue de la langue, voilà ce que je pense avoir créé dans Etre
sans destin. Après, j'ai continué à jouer avec ces trouvailles. Dans Kaddish pour
l'enfant qui ne naîtra pas, la perspective n'est pas aussi aliénée : c'est un homme qui
parle, quelqu'un qui est au clair avec les lois de la vie et qui n'a commis qu'une erreur,
tomber amoureux.
Comment vous situez-vous par rapport aux auteurs qui ont décrit l'univers
concentrationnaire ?
Je hais la peinture des horreurs. Ce qui m'intéresse, c'est la distance. La langue est
limitée et ses limites sont infranchissables. Il faut donc les briser de l'intérieur.
J'admire les auteurs qui réussissent à travailler avec les moyens de la littérature
pour dépasser les frontières du dicible. Récemment, j'ai relu La Douleur, de Marguerite
Duras : rien de spectaculaire et pourtant tout est exprimé de ce que Duras appelle le «
désordre phénoménal de la pensée et du sentiment ». On voit cette femme qui retrouve
son mari rescapé du camp. On le voit lui : « Dans ses pantalons, ses jambes flottent
comme des béquilles. » « Lorsqu'il fait du soleil, on voit à travers ses mains. »
1 | 2 | suivant
Propos recueillis par Florence Noiville
Imre Kertész le survivant
LE MONDE | 11.07.05 | 11h50 • Mis à jour le 11.07.05 | 11h50
A l'Hôtel Kempinski, à Berlin, Imre Kertész a ses habitudes. Ce fauteuil profond dans
l'angle de la cheminée, c'est bien là, confirment les serveurs, que le Prix Nobel
hongrois accorde ses interviews. De rares entretiens en vérité, tant l'éloge du silence
revient dans sa bouche comme un leitmotiv. "Vivre la honte de la vie et se taire,
voilà le plus grand exploit", note celui qui, dans les années 1950, en Hongrie,
n'avait qu'un but : "rester anonyme". Mais, depuis qu'un jour d'octobre 2002
Kertész a appris - en écoutant la radio - que les jurés du Nobel l'avaient couronné,
il est bien obligé de répondre à quelques sollicitations. "J'ai appelé ça la
"catastrophe du bonheur", die Glückskatastrophe !", dit-il en riant.
"J'ai cru que je n'arriverais jamais à terminer le texte sur lequel je m'échinais
depuis des années."
Ce texte, son sixième disponible en français, s'intitule Liquidation. Publié l'an
dernier en Hongrie et en Allemagne, il nous arrive aujourd'hui, traduit du hongrois par
Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba (Actes Sud, 128 p., 13,90 €). Il est le
fruit de huit ans de labeur, huit ans au cours desquels l'auteur l'a tourné en tous sens,
étiré, raccourci, lui donnant tour à tour des "formes très diverses",
jusqu'à ce qu'il trouve enfin "la solution". C'est alors que "la
nouvelle" est tombée et que Kertész a été "saisi par la peur". "Je
m'étais battu des années, et il fallait que je me batte encore pour ne rien perdre de la
tension qui me portait".
Après Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, après Etre sans destin (Actes
Sud, 1995 et 1998), Liquidation est certainement l'un des chefs-d'oeuvre les plus
poignants d'Imre Kertész, un texte placé sous le signe de Beckett, nourri de cette
glaciale ironie qui "rend la littérature supportable", mais procédant en
réalité d'un sens de l'absurde abyssal et d'un désespoir sans fond. "Que
voulez-vous, s'excuse Kertész, comme il est dit dans Molloy : "Je suis né sérieux
comme d'autres naissent avec la syphilis.""
On ne se risquera pas à résumer ici la structure complexe de Liquidation. Car le titre,
évidemment polysémique, renvoie à la fois à celui d'une pièce de théâtre
enchâssée dans le roman (celle de l'écrivain B., qui ressemble fort à Kertész et dont
le mystère est au coeur du livre) ; à la faillite de la maison d'édition qui publiait
B. ; à la chute du mur de Berlin, et finalement au suicide de B. Liquidés, les opposants
au régime ; démolies, les tentatives artistiques ; atomisées, les dernières structures
économiques : tout doit disparaître, et tout s'efface, en effet, dans cette Budapest des
années 1980-1990. Y compris cette "variété de démence" que l'on appelle
l'amour ("C'est si étrange un amour qui meurt. Le monde devient soudain gris autour
de toi, froid, compréhensible, sobre et lointain").
Avec une impressionnante virtuosité, Kertész multiplie les allers-retours entre passé
et présent, roman et théâtre, clins d'oeil au lecteur et apartés paradoxaux, jusqu'à
la "machinerie romanesque" de la fin qui fait qu'"en deux phrases tout est
contredit, démenti, balayé". Du grand art.
L'homme a ôté le légendaire chapeau mou et la longue écharpe qui lui donnent de faux
airs d'espion de la guerre froide. Il a méticuleusement posé son parapluie près du
fauteuil. Et il vous fixe avec ce regard troublant où perce la détermination douce d'un
homme qui a survécu à tout et n'est dupe de rien. Il admet qu'il y a dans ce texte de
nombreux échos de son expérience propre. Né en 1929 dans une famille juive de Budapest
(mère employée, père marchand de bois), Kertész est déporté à l'âge de 15 ans à
Auschwitz puis à Buchenwald. Libéré en 1945 - il a 16 ans -, il rentre dans un pays
qu'il ne reconnaît pas. Budapest est une ville étrangère, et tous les siens ont été
liquidés, précisément. Après la barbarie nazie, le communisme totalitaire.
"LE MAL, PRINCIPE DE LA VIE"
Kertész décide de vivre de sa plume et se cache pour écrire dans les
"espressos" enfumés de Budapest. Dans les années 1960, il commence Etre sans
destin, qui ne trouve d'abord aucun éditeur. Il lui faudra attendre vingt ans pour que,
en 1982, une critique de l'écrivain magyar Gyorgy Spiro éveille de l'intérêt pour ce
singulier "roman de formation à l'envers" où un enfant, à Auschwitz,
découvre sans jugement moral ce qui sous-tend la philosophie de Kertész - et aussi celle
de B. : que "le Mal est le principe de la vie" et que "ce qui est
véritablement irrationnel, qui n'a pas d'explication, ce n'est pas le Mal, mais le
Bien". Le livre fait actuellement l'objet d'une adaptation au cinéma par Layos
Koltaï.
Kertész dit tout cela en allemand. La moitié du temps, il vit à Berlin et note que
cette ville va finir par "devenir sa patrie d'adoption". Un paradoxe lorsqu'on
songe à son passé dans les camps ? Pas à ses yeux. "Je n'ai jamais considéré la
Shoah comme la conséquence d'une hostilité irrémédiable entre les juifs et les
Allemands, dit-il. Car alors comment expliquer l'intérêt des lecteurs allemands pour mes
livres ? Au fond, c'est en Allemagne que je suis devenu écrivain, non au sens de la
"renommée", mais parce que c'est d'abord là que mes livres ont produit leur
véritable impression."
Et puis l'allemand est pour lui la langue des penseurs, non des bourreaux. Il évoque
Nietzsche, Hofmannsthal ou Schnitzler, qu'il a traduits en hongrois, avant de confesser sa
tendresse pour Thomas Mann et Camus : "J'avais 25 ans. Je suis tombé sur un tout
petit livre. Je me suis dit qu'il ne devait pas être trop cher. De l'auteur, je n'avais
jamais entendu parler. Mais j'ai tout de suite compris." Ce livre, c'était
L'Etranger - en hongrois L'Indifférent. Indifférent, ou plutôt détaché - mais au
meilleur sens du terme, au sens d'affranchi : c'est l'impression que donne ce jour-là
Imre Kertész, ramenant à lui sa main droite qui tremble d'une maladie de Parkinson.
Comme s'il disait : ce corps qui souffre n'est pas le mien. Comme s'il était lui et un
autre, traînant derrière lui, non sans humour, sa dépression est-européenne (
"mon capital littéraire" ) et n'en finissant pas de se chercher pour interroger
l'humanité tout entière.
Florence Noiville
Simone Veil
LE MONDE | 21.08.02 | 10h36 • Mis à jour le 27.06.05
| 10h27
C'est une histoire d'amour que conte Simone Veil. L'histoire d'un amour pur, tendre,
intact, qui continue de l'emplir, la nourrir, l'inspirer. L'histoire d'un amour fou entre
une petite fille rebelle, devenue magistrate, ministre, présidente du Parlement
européen... et grand-mère, et sa maman, perdue beaucoup trop tôt, dans la barbarie d'un
camp nazi. Un amour-passion, depuis le premier jour. Amour définitif. "C'est le
personnage le plus important de ma vie."
Elle paraît heureuse d'en parler. De la faire connaître. Reconnaître. Aimer. De dire
son nom, Yvonne. De montrer ses photos, qui témoignent d'une beauté, d'une grâce hors
du commun - "Elle ressemblait à Greta Garbo." D'affirmer qu'elle était en tout
point exceptionnelle. "Je sais que tout le monde prétend avoir eu la mère la plus
belle, la plus douce, la plus généreuse... Mais même en réalisant cela, je me dis :
elle, elle l'était vraiment !" Ses souvenirs convergent. Ses photos l'attestent. Et
tous ces témoignages qu'elle a recueillis plus tard, après la mort d'Yvonne, de voisins,
d'amies, de compagnes de camp... Oui, tous se souviennent d'Yvonne comme de quelqu'un...
"d'exceptionnel".
Elle avait un père aussi. André. André Jacob, architecte, Prix de Rome, lui aussi
disparu, avec le jeune frère de Simone, dans un convoi de déportés juifs ayant quitté
Drancy le 15 mai 1944 en direction des pays baltes. Et elle a peur, parfois, d'être un
peu injuste envers lui, tant sa tendresse à elle était focalisée sur Yvonne. Mais
André reconnaissait, mieux que quiconque, le charisme de sa femme, pour laquelle il
nourrissait une passion exclusive. "Il y avait comme une compétition entre les
enfants et le mari !, sourit Simone, une paillette de malice dans ses yeux verts si
clairs. Le soir, alors que maman restait bavarder avec ses trois filles, qui partageaient
la même chambre, on entendait toutes les cinq à dix minutes vibrer la voix de papa :
"Yvonne ! Tu viens te coucher ?". Et à chaque fois, on retenait maman :
"Non, non, reste !" Mon père aurait voulu avoir sa femme pour lui tout
seul."
Parlons d'Yvonne, donc. D'Yvonne à qui Simone croit ne ressembler que très légèrement
sur le plan physique, et pas du tout sur le plan du caractère. Sa sœur Denise,
pense-t-elle, avec qui elle conserve des liens très forts, lui ressemble bien davantage.
"Je suis beaucoup moins douce, beaucoup moins conciliante, beaucoup moins facile que
maman ! Beaucoup moins généreuse aussi. Car sa vie à elle n'a été dirigée que vers
les autres. Peut-être suis-je... Non, pas plus gaie, car je ne suis pas très gaie. Mais
peut-être suis-je plus combative, moins résignée à renoncer à certains plaisirs de la
vie, comme à la liberté de travailler. Maman l'a fait, sous la pression de mon père et
malgré des études de chimie qui la passionnaient, abandonnant l'idée d'une vie
personnelle pour tout donner à ses enfants, à son mari, à ses amis. D'ailleurs, elle ne
pensait jamais à elle. Jamais. Elle pouvait se priver de tout pour les autres, sans même
en avoir le sentiment, encore moins le leur donner. Elle était d'une telle bonté... Un
mot étrange, hein ? Un peu désuet aujourd'hui. C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit.
Et d'amour."
Quand son mari lui avait annoncé, en 1924, sa décision de quitter Paris pour installer
sa famille à Nice, convaincu que l'explosion du marché immobilier sur la Côte d'Azur
lui offrait de grandes perspectives, Yvonne, la Parisienne, avait été navrée. Elle
aimait le théâtre, le cinéma, les concerts, les longs moments partagés avec sa
sœur Suzanne, médecin. Son départ fut donc un déracinement et Nice une sorte
d'exil, d'où elle écrivait chaque jour à sa sœur de longues lettres, et où,
malgré une certaine mélancolie, elle s'efforçait de profiter des richesses de
l'environnement. Simone, qui a toujours raffolé du soleil, garde un souvenir délicieux
du cadre de sa petite enfance. "Je me rappelle un petit bois d'oliviers avec des
violettes et du mimosa, tout près de notre appartement niçois, dit-elle. Des champs de
narcisses, de coquelicots et de jasmin sauvage. Un trajet longeant la mer pour rentrer de
l'école..."
Yvonne eut quatre enfants en l'espace de cinq ans, qui lui prenaient tout son temps.
Simone, notamment. La plus jeune, la plus insoumise, la plus demandeuse de tendresse.
"Au fond, moi aussi j'aurais voulu être seule à bénéficier de son amour. Je
voulais toujours être près d'elle. Quand on se promenait dans la rue, c'était
évidemment à moi de lui donner la main. Les matins où il n'y avait pas école, je me
souviens de me glisser dans son lit, de me lover contre elle, la caressant, la pelotant
presque, jamais rassasiée d'elle. Et à table, comme j'étais indisciplinée, ma place
était à côté de mon père, qui voulait veiller lui-même à ce que je me tienne bien.
Mais quand il n'était pas là, je fonçais près de maman. C'était ma place. La plus
grosse colère que j'aie jamais faite fut d'ailleurs provoquée par le fait qu'on ne
m'avait pas assise près d'elle, lors d'un déjeuner de famille à Paris. Ce furent des
sanglots et un drame épouvantables. On m'avait volé quelque chose. On me volait toujours
maman."
Madeleine, surnommée Milou, qui avait quatre ans de plus que la benjamine, avait mission
de remplacer sa mère auprès de Simone quand elle n'était pas là. C'était comme une
délégation officielle de tendresse. Milou devenait une mère de substitution. A la
maison, ou chez les scouts, où les enfants Jacob étaient très actifs. "Dans les
semaines qui ont suivi la mort de maman, au camp, Milou, pourtant très malade, a rejoué
spontanément ce rôle maternel. Elle m'a permis, à ce moment si critique, une sorte de
transition. Quand elle est morte à son tour, en 1952, c'est comme si j'avais perdu maman
deux fois. Heureusement, Denise était là."
Le camp, déjà. Il vient spontanément dans la conversation de Simone Veil. Drancy,
Auschwitz, Bobreck, Bergen-Belsen... Indissociablement lié à son enfance dont il sonne
la fin (elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle a été arrêtée avec sa mère et Milou, sa
sœur Denise étant déportée à Ravensbrück comme résistante). Irrémédiablement
lié à ses parents, qui n'en reviendront jamais. Qu'importe, donc, la chronologie.
Suivons Simone, les mots et les images qui lui viennent pour remonter la source, et
raconter Yvonne.
Petite Niçoise, elle était toujours subjuguée par l'effet que provoquait dans un groupe
la présence de sa mère. Il y avait sa beauté naturelle, jamais apprêtée, ses traits
parfaits, adoucis par un chignon posé sur la nuque. Il y avait surtout son regard, si
bienveillant. "Les professeurs du lycée, nos amies en difficulté, les
éclaireuses... Tous savaient qu'ils trouveraient chez elle l'écoute ou le réconfort
dont ils avaient besoin.. Même au camp..." Une pause. "Oui, même à Auschwitz,
reprend Simone, même vêtue de haillons et atrocement malade, elle impressionnait tout le
monde - y compris des SS - par son allure, sa dignité, sa force morale. Pourtant
l'ambiance était sauvage. Les détenues, notamment des Ukrainiennes, se battaient pour
tout. Elles n'avaient de cesse que de dérober même ce qu'on portait sur soi ! La
cuillère qu'on avait payée d'une précieuse ration de pain disparaissait violemment de
votre main. Les chaussures cachées sous le matelas s'envolaient dans la nuit, vous
laissant démunie dans un froid infernal. La soupe - immonde mais vitale - faisait l'objet
des pires veuleries. Mais maman laissait faire, incapable du moindre geste d'agressivité.
Si quelqu'un s'avisait de voler sa soupe, elle expliquait qu'il avait probablement plus
faim qu'elle. Ce qui me rendait malade ! Je ne supportais pas qu'on la vole ou qu'on la
maltraite ! Alors je la défendais ! C'était instinctif ! Je veillais !"
Simone était solide. Simone était débrouillarde. Simone avait une
pulsion de vie qui lui donnait toutes les audaces, lui faisait prendre tous les risques, y
compris de se faire prendre en chapardant à la cuisine du camp. Elle s'inquiétait
tellement pour Yvonne et Milou. "Sans Simone, témoignera cette dernière, nous
n'aurions pas tenu." Sans doute. Car Yvonne et Milou étaient de la même pâte,
dépourvues de colère ou de haine. Pourtant, Simone insiste : "Je les aidais
matériellement autant que je pouvais. Mais c'est maman, à toutes les étapes, qui nous a
insufflé de l'espoir. C'est maman qui nous a soutenues moralement, que ce soit dans le
train, à l'arrivée au camp, ou quand on a dû évacuer Auschwitz dans la précipitation,
persuadées que les SS allaient tous nous gazer. Je ne sais toujours pas où elle a
trouvé la force d'accomplir cette ultime marche de 70 kilomètres dans la neige,
dévastée, malade du typhus, éventrée à la suite d'une opération récente non
cicatrisée, ne rejetant même pas le corps des malheureux qui s'agrippaient à son dos
pour éviter d'être immédiatement fusillés..."
Elle s'interroge encore. Et son regard s'évade. Est-elle repartie un instant dans ce
convoi dantesque, cette file de détenues décharnées et chancelantes, tentant d'avancer
dans la neige, par - 30 degrés, menées à coups de triques et de fusils par des SS en
déroute ? Est-elle dans ce camp de Bergen où Yvonne, rongée par le typhus, s'est
éteinte, quelques jours avant la libération par les Anglais, laissant ses deux filles
hagardes, mais conscientes qu'elle était allée au bout du supportable ? Ou bien est-elle
à Nice, où le couple Jacob, malgré les menaces naissantes, prenait tellement à
cœur l'éducation des enfants ? "Le sens moral, dit Simone ; je crois que c'est
ce qui importait le plus à mes parents. La morale comme une éthique, un comportement, un
ensemble de valeurs dans lequel ils plaçaient la vérité, la générosité, la
solidarité, le respect des autres. Cela impliquait une série de réflexes dans la vie
quotidienne. L'idée de mentir aux parents, par exemple, était incroyablement
culpabilisatrice. L'idée de signer un carnet à leur place me semblait monstrueuse.
Resquiller dans une queue était un manque de respect. Mais ne pas prêter assistance aux
réfugiés ou aux gens dans le besoin carrément inconcevable."
La religion n'existait pas. Les Jacob, élevés tous deux dans des familles juives
installées en France depuis des générations, s'étaient mariés civilement. Et André,
républicain et patriote, ancien prisonnier de la guerre de 1914-1918, défendait avec
force la laïcité. Furieux d'apprendre un jour qu'une petite cousine de passage avait
amené Simone dans une synagogue, il l'avait menacée de ne plus jamais remettre les pieds
dans sa maison si l'idée lui prenait de recommencer. Et les enfants, qui ignoraient
Kippour, adoraient qu'Yvonne prépare un grand sapin de Noël. Malgré la grimace de son
mari. Le judaïsme ? "L'appartenance à une culture, dit Simone. Beaucoup de nos
proches étaient des familles juives, non pratiquantes, mais je n'y pensais pas. Un jour,
j'avais 15 ans, j'ai pourtant demandé à mon père : "Est-ce ça t'ennuierait que
j'épouse quelqu'un qui ne soit pas juif ?" Il m'a répondu : "Tu épouseras qui
tu veux ! C'est un acte individuel dont je n'ai pas à m'occuper." Mais il a ajouté
: "Moi, je n'aurais pas épousé une femme qui ne soit pas juive ou
aristocrate." Cela m'a sidérée. Sidérée !... Peut-être exprimait-il en fait
l'idée de tradition, de fidélité à des valeurs et une morale. L'idée aussi de
transmission et d'éducation."
Education par l'exemple, par l'école, par les livres. André les choisissait lui-même
dans sa bibliothèque, lisant à haute voix les Contes de Perraultou les Fables de La
Fontaine. Pas question de perdre son temps avec des petits auteurs, de faibles traductions
ou des romances à l'eau de rose ! "Il était intraitable, sourit Simone, se
rappelant sa propre stupéfaction lorsqu'il lui a donné à lire très jeune Montherlant
et Tolstoï, alors même que dans ma classe des camarades croyaient encore que les bébés
naissaient dans les choux !"Il aimait marcher avec ses enfants et les aidait à tenir
des herbiers. Il leur apprenait le nom des étoiles. Il les voulait ouverts, indépendants
d'esprit, curieux de tout : l'art, la danse, le graphisme. Mais de musique, point.
"Il n'aimait pas. Elle était donc interdite à la maison." Tout comme la
politique. "Je savais que maman était plutôt de gauche et sympathisante du Front
populaire, papa de la droite modérée."
Oui, André avait un côté un peu dictatorial. "Autoritaire", corrige Simone,
qui n'acceptait jamais sans discuter ses oukases, et jugeait sévèrement, depuis son
très jeune âge, l'emprise que son père maintenait sur Yvonne. "Je n'aimais pas
l'idée qu'il lui impose ses goûts, restreigne sa liberté, encore moins qu'il lui
demande des comptes sur les dépenses de la famille ! Le budget était certes très
serré, mais ces séances où maman devait, à un sou près, rendre des comptes devant son
mari ! Ce sentiment de dépendance ! Cela m'exaspérait ! Ça, jamais, me disais-je ! Du
coup, je n'ai jamais fait de comptes !"
Ni surtout de compromis sur le principe d'exercer un métier. Car Simone a fait des
études en rentrant du camp. Epousé Antoine Veil, un jeune homme juif brillant,
passionné de politique. Mis au monde trois fils. Et mené avec passion des combats - pour
les femmes, les prisonniers, l'Europe - et une carrière étonnante, de la magistrature au
Conseil constitutionnel.
La présence d'Yvonne ne l'a pas quittée : "C'est elle qui a guidé ma vie dans tous
les domaines, affirme-t-elle. J'ai l'impression qu'elle m'enrichit toujours."
Annick Cojean
Article paru dans l'édition du 22.08.02
La parole tardive 
LEMONDE.FR | 10.06.05 | 11h34 • Mis à jour le 16.06.05 | 14h52
Le dernier quart du XXe siècle a été marqué par une inflation notable de témoignages
des survivants de la Shoah, audiovisuels notamment. Le témoignage est même devenu
"la forme privilégiée pour dire une expérience qualifiée d'intransmissible par
ceux-là mêmes qui tentent de la transmettre", constate Régine Waintrater dans son
livre Sortir du génocide. Témoigner pour réapprendre à vivre (Payot & Rivages,
2003).
Il a fallu cependant plusieurs décennies pour que le témoignage audiovisuel devienne
cette forme privilégiée que nous connaissons aujourd'hui. Annette Wieviorka, dans L'Ere
du témoin (Hachette, 2002), découpe les soixante dernières années en trois phases bien
distinctes : "Témoigner d'un monde englouti", "L'avènement du
témoin", et enfin "L'ère du témoin".
Durant les premières années de l'après-guerre, les survivants des camps de
concentration veulent rappeler ce qui s'est passé, mais ne sont guère entendus. Pour de
multiples raisons : difficulté de rendre compte de l'inimaginable, volonté de passer à
autre chose de la part de la société, ré-apprentissage de la vie par les survivants,
comme l'explique, entre autres, Henri Borlant. Ensuite, à partir du procès Eichmann qui
se déroule à Jérusalem en 1961, les témoignages sont au contraire sollicités dans une
perspective judiciaire. Enfin, à l'ère du témoin, le témoignage relève d'un
véritable impératif social et non plus d'une nécessité intérieure. La parole se
libère.
LA PAGE BLANCHE POUR CONFIDENT
Dans le premier temps, celui des témoignages immédiats de l'après-guerre, la question
s'est posée pour les survivants de trouver une forme qui rende compte de ce qu'ils
avaient vécu. Contrairement à l'idée qui veut que les survivants n'aient pas parlé, on
dénombre, rien qu'en France, une production écrite considérable de récits
autobiographiques de rescapés, immédiatement après le retour. Cependant, peu de
survivants ont pu parler à leurs proches de ce qu'ils avaient vécu, ils se sont donc
repliés sur eux-mêmes. Le résistant Pierre Francès-Rousseau relate dans son livre
Intact aux yeux du monde (Hachette, 1987) l'épisode où, de retour de déportation, il
est accueilli par sa mère à l'Hôtel Lutetia. Elle l'inspecte, l'interroge, vérifie
qu'il est intact et dit : "Je suis contente que tu sois revenu, je vais enfin pouvoir
parler à quelqu'un de mes malheurs." L'auteur décide alors de se taire et, comme
lui, de nombreux survivants choisissent – exclusivement – la feuille blanche
comme seul confident.
Le deuxième temps, plus littéraire, est celui des récits parus environ dix ans après
le retour. A ces œuvres littéraires se superposent des témoignages destinés à
documenter le travail d'historiens ou de juristes. Cette période culmine avec le procès
Eichmann, en 1961, qui en Israël fait figure d'un "Nuremberg du peuple juif",
selon l'expression de David Ben Gourion. Les témoins parlent devant des commissions
d'enquête à caractère juridique ou historique. La personne privée du témoin tend à
disparaître derrière les faits, dont il s'agit de restituer la vérité. Le témoignage
est ici codifié, orienté tout entier vers l'administration de la preuve : l'irruption de
l'émotion est considérée comme une gêne. Il s'agit, pour le témoin, d'une épreuve
supplémentaire qu'il s'inflige à lui-même au nom d'une exigence morale et dans une
optique militante.
LE FEUILLETION "HOLOCAUSTE" : UN TOURNANT
Le troisième temps correspond au dernier quart du XXe siècle et se caractérise par une
floraison de formes diverses, recueils ou films. A la fin des années 1970, à la suite de
l'émotion et des controverses qui suivent aux Etats-Unis, en France et en Allemagne la
diffusion du feuilleton télévisé Holocauste (réalisé par Marvin Chomsky en 1978),
apparaît pour la première fois l'idée qu'il faut recueillir, sous forme de films
vidéo, le témoignage des survivors (dénomination donnée par les Américains),
c'est-à-dire de tous les juifs, déportés ou pas, qui vécurent sous la domination nazie
dans le IIIe Reich ou dans les pays occupés, et qui échappèrent à la "solution
finale". Malgré des critiques virulentes de la part des survivants eux-mêmes sur la
médiocrité de l'exercice – la première d'entre elle fut celle d'Elie Wiesel dans
le magazine Time (reproduite dans le deuxième tome de ses Mémoires : Et la mer n'est pas
remplie, Seuil, 1996) –, le feuilleton télévisé fut un prodigieux succès
populaire. Il inaugure "l'ère du témoin".
Le temps de la collecte systématique des témoignages audiovisuels est alors amorcé. Le
film Shoah de Claude Lanzmann (1985), qui se veut l'antithèse du feuilleton américain en
proclamant l'irreprésentabilité de la Shoah, est centré sur le témoignage, considéré
comme le seul médium apte à rendre compte du phénomène génocidaire. L'utilisation que
Claude Lanzmann y fait du témoin a beaucoup contribué à la réhabilitation d'une parole
personnelle : il campe le témoin et son histoire au centre de l'œuvre, en tressant,
à partir de témoignages individuels, un récit collectif. En ce sens, il contribue à
inverser le processus de massification qui enveloppait jusqu'ici la parole des témoins de
la Shoah.
Cette nouvelle ère, inaugurée par Holocauste et Shoah, culmine avec La Liste de
Schindler, de Steven Spielberg, en 1993. Le réalisateur américain contribue lui aussi à
la recontextualisation du survivant. En terminant son film par un défilé des personnages
réels, devenus vieux, accompagnés des acteurs qui les représentent, Spielberg veut
recréer une continuité entre le temps des persécutions et celui de la mémoire.
L'UNIVERSITÉ YALE, PRÉCURSEUR
La Liste de Schindler va permettre d'intensifier la collecte systématique des
témoignages de survivants. Celle-ci fut amorcée, dans les années 1980, par le projet
Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies mis en place par l'université
américaine Yale. En 1995, cette collection de témoignages comptait 3 600 références,
près de 10 000 heures recueillies aux Etats-Unis et aux quatre coins de l'Europe. Les
enregistrements concernant la France ont été supervisés par l'historienne Annette
Wieviorka et le rescapé Henri Borlant, au sein de l'association Témoignages pour
mémoire : le documentaire 14 Récits d'Auschwitz (MK2 Doc, 2005) est une sélection
commentée.
L'apparition de la Fondation des archives de l'histoire audiovisuelle de la Shoah créée
par Steven Spielberg en 1994 à Los Angeles, à la suite du tournage de La Liste de
Schindler, change l'échelle de la collecte. A ce jour, cette fondation a enregistré
près de 52 000 témoignages, catalogués pour la plupart, et visualisables dans les
différents grands musées et mémoriaux consacrés à la Shoah. Les quelques 1 850
témoignages francophones enregistrés par cette Fondation sont accessibles au Centre
multimédia du Mémorial de la Shoah, à Paris.
La dernière campagne de collecte de témoignages en France a eu lieu en 2004, dans le
cadre de la 60e commémoration de la libération des camps. Ce projet, lancé par la
Mairie de Paris et le Mémorial de la Shoah, et intitulé Entre l'écoute et la parole :
derniers témoins, Auschwitz 1945-2005, a été réalisé par Esther Shalev-Gerz. Les
témoignages de ces soixante rescapés du camp d'Auschwitz ont fait l'objet d'une
exposition à l'Hôtel de Ville de Paris (du 27 janvier au 12 mars 2005), qui a connu un
large succès. Ils sont, depuis, accessibles au Mémorial de la Shoah. Cette ultime
campagne de témoignages a permis aux survivants concernés de témoigner, encore une
fois, de leur déportation et d'aller encore plus avant dans leur"travail" de
témoins. A l'occasion de cette campagne, chacun a pu constater que la parole des
survivants s'était enfin – et définitivement ? – libérée. Pourquoi
continue-t-on de témoigner ? Pour ne pas oublier, certes. Mais peut-être, et surtout,
comme le dit Imre Kertesz, auteur de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas (Actes Sud,
1995), lui aussi survivant, "pour que quelqu'un – n'importe qui – ait honte
à cause de nous et (éventuellement) pour nous". Est-il nécessaire de réveiller
chez les survivants les souffrances endurées ? La réponse est à chercher auprès des
témoins eux-mêmes, mais aussi auprès de ceux qui recueillent leur récits, ces
"témoins des témoins", selon l'expression de Régine Waintrater.
Sébastien Lucas
L'étoile blanche de la liberté, par Samuel
Pisar
Les plages de Normandie sont des lieux inspirés pour réfléchir sur un monde mis à feu
et à sang par l'attaque du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis, un monde dans lequel
les massacres terroristes, les assassinats politiques, les décapitations religieuses et
autres horreurs semblent se multiplier. Les alliés historiques et les ennemis
réconciliés se réunissent sur ces rivages de France ensanglantés pour commémorer la
libération de l'Europe, conduite par les Américains, contre de semblables horreurs,
perpétrées par une idéologie meurtrière dans le but de détruire la démocratie et la
civilisation.
Pour moi, c'est le moment de revisiter ma propre libération des enfers du totalitarisme
nazi, et de bénir les héros qui sont morts pour que nous puissions vivre en paix, dans
la sécurité et la dignité.
Le 6 juin 1944, jour du débarquement allié, fut pour nous, à Auschwitz, un jour comme
les autres. Les trains à bestiaux qui convergeaient depuis tous les coins du continent
martyrisé - de Budapest ou d'Amsterdam, d'Athènes ou de Paris - déchargaient leurs
cargaisons humaines pour destruction de masse, au même rythme infernal. Ce jour-là, le
nombre de morts dans les chambres à gaz fut plus élevé encore que les énormes pertes
subies par les armées réunies sous le commandement du général Eisenhower - leur jour
le plus long.
Nous avions toutes les raisons de croire que la guerre était irrévocablement perdue,
l'Armée rouge écrasée, l'Angleterre luttant seule contre les forces apparemment
invincibles des ténèbres. Et l'Amérique ? L'Amérique était si loin, si divisée, si
mal préparée. Comment pouvait-elle renverser le cours du destin à ce stade ultime ?
Il fallut des semaines pour que la nouvelle du Débarquement transmise de Londres par la
BBC s'infiltre dans le camp par le biais de la résistance polonaise. Une rumeur disait
aussi que les Russes avaient lancé une offensive sur le front Est. Oh, tenir encore un
peu ! J'avais 15 ans et je voulais vivre.
A la nervosité grandissante de nos gardiens, on voyait bien que le sort de la bataille
était en train de changer. Alors que la terre se réduisait sous leurs pieds, ils
commencèrent à mener notre troupeau plus loin, en Allemagne. J'ai été transféré
successivement dans des camps près de Berlin, de Stuttgart et de Munich. C'est dans une
enclave de Dachau que j'ai entendu pour la première fois le silence de la nuit déchiré
par des explosions d'un genre différent. Des anciens militaires, parmi nous, pensaient
que c'était l'artillerie.
Quelques heures plus tard, nous avons été à nouveau évacués devant « l'avance de
l'ennemi ». Maintenant, on murmurait ouvertement ces mots magiques et enivrants, et même
les noms des commandants alliés - Patton, Montgomery, Joukov.
Le salut semblait si proche et cependant si lointain. Alors que l'espoir de s'en sortir
devenait plus réel, le danger augmenta. Au dernier moment, nos bourreaux nous
détruiraient à coup sûr. La solution finale devait aller à son terme, les derniers
témoins devaient être liquidés.
Ma dernière marche de la mort se poursuivit nuit et jour, avec de rares haltes pour de
maigres rations de pain et d'eau. A l'aube du troisième jour, une escadrille d'avions
alliés, prenant notre colonne pour des soldats de la Wehrmacht, descendit en piqué pour
nous mitrailler. Tandis que les SS plongeaient à terre, leurs mitrailleuses crachant,
leurs chiens grognant, un camarade tout près de moi a crié : « Vas-y, cours ! »
Tout un groupe a jeté ses sabots et a foncé maladroitement vers les arbres. Cinq sont
arrivés vivants dans la forêt. Nous avons couru, à bout de souffle, jusqu'à nous
écrouler. Il n'y avait aucun bruit de poursuite ; rien que le battement sourd de nos
coeurs et la musique depuis si longtemps oubliée des oiseaux qui gazouillaient.
La nuit, nous nous sommes dirigés vers le front Ouest. Lors d'un après-midi bucolique,
alors que nous étions terrés dans une grange abandonnée, j'ai entendu un bourdonnement,
comme un essaim d'abeilles, mais plus fort, métallique, surnaturel. J'ai regardé entre
deux planches. Dans un champ, un énorme tank avançait lourdement vers moi, à la tête
d'un long convoi militaire. Quelque part sur le côté, j'entendais des tirs de mortier.
Le canon du tank a tourné et tiré une salve assourdissante. Les mortiers se sont tus. Le
tank a repris son avancée prudente.
J'ai cherché l'odieuse croix gammée. A la place, j'ai vu un emblème que je ne
connaissais pas - une étoile à cinq branches. Immédiatement, l'impensable m'a envahi
l'esprit et l'âme. Après tant d'années de tortures et d'humiliations au plus profond de
l'abysse, moi, sous-homme squelettique à la tête rasée et aux yeux caves, l'unique
survivant de ma famille, je contemplais le glorieux insigne de l'armée américaine.
Avec un hurlement sauvage, je me suis précipité vers la merveilleuse vision en agitant
les bras. Brusquement, la trappe d'un véhicule blindé s'est ouverte et un visage noir
protégé par un casque et de grosses lunettes est apparu en me lançant des injures
incompréhensibles. J'avais échappé à la mort tant de fois, mais à ce moment décisif,
je me sentais immortel, même si le GI stupéfait a dû penser que, dans ma situation
désespérée au milieu du champ de bataille, j'étais bien fragile. Il a sauté à terre,
le pistolet à la main, pour m'examiner de plus près, comme pour s'assurer que ce gamin
n'était pas un piège porteur d'explosifs.
Pour le convaincre que j'étais un ami et que j'avais besoin d'aide, je suis tombé à
genoux, j'ai jeté les bras autour de ses jambes et, me souvenant de quelques mots
d'anglais que ma mère soupirait quand elle rêvait à notre délivrance, j'ai hurlé : «
God bless America ! » D'un geste simple, le grand Américain m'a soulevé et m'a fait
passer par la trappe de son tank dans les entrailles de la liberté.
Aujourd'hui, alors qu'une vague d'antiaméricanisme déferle sur le monde, que les GI sont
accusés d'amoralité et de sadisme, le survivant que je suis s'écrie : « N'oublie
jamais le courageux soldat et l'armée salvatrice qui autrefois t'a rendu la vie et la
liberté. » Mais le juriste que je suis avertit : « Les responsables de ces sévices
scandaleux infligés à des prisonniers de guerre doivent être traduits en justice. »
Mon expérience amère de la vie m'a appris que la guerre est répugnante et sale. En
Irak, sa conduite a été ébranlée par de graves erreurs stratégiques et des
manquements impardonnables à la discipline. Pas étonnant que la vigoureuse démocratie
américaine soit dans les affres d'un examen de conscience à propos de son ingrate
mission de libératrice des opprimés. Au Moyen-Orient, où les enjeux sont colossaux pour
tout le monde, les responsabilités des Etats-Unis sont aussi vitales que difficiles, et
il n'existe personne d'autre pour porter le fardeau. Que Washington succombe aux sirènes
de l'isolationnisme et ceux qui luttent pour la sécurité, la tolérance et le progrès
s'en trouveraient affaiblis de façon désastreuse, alors même qu'Al-Qaida sème la peur,
la violence et le chaos sur tout le continent.
A ce moment crucial où on restitue leur souveraineté aux Irakiens, tous les pays
démocrates, même ceux qui se sont opposés à la guerre, doivent impérativement adopter
une stratégie internationale et transatlantique commune pour stabiliser l'Irak et
combattre le terrorisme global, dans le même esprit de solidarité entre alliés et
adversaires qui a gagné la paix après la seconde guerre mondiale et, ensuite, la guerre
froide.
Pour ma part, j'ai toujours confiance en l'humanité et en la moralité des GI américains
qui sont actuellement au coeur de cette entreprise de pacification. J'ai la conviction que
l'étoile blanche à cinq branches qui n'a cessé de secourir les victimes des
persécutions religieuses, des pogroms racistes et de la tyrannie idéologique, restera un
symbole puissant d'espoir.
Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau
Samuel Pisar
Article paru dans l'édition du 06.06.04
La mémoire du génocide, par Annette Wieviorka
LE MONDE | 14.04.03 | 12h42
Le procès de Paul Touvier est probablement un des derniers procès de l'après-guerre. On
peut voir un symbole dans sa date d'ouverture : cinquante ans pratiquement jour pour jour
après la condamnation à mort de Pierre Pucheu, secrétaire d'Etat à la production
industrielle puis ministre de l'intérieur du gouvernement de Vichy, le 11 mars 1944, et
son exécution, le 20 mars 1944 à Alger, après que le général de Gaulle eut refusé sa
grâce. Ce fut le premier accusé de l'épuration.
Dans l'intervalle, bien d'autres procès eurent lieu : ceux de Pétain, Laval ou Darnand,
le chef de la milice, tous trois condamnés à mort et, pour les deux derniers,
exécutés. Mais aussi le procès de Nuremberg, qui mit en accusation les "grands
criminels de guerre", ceux, à Jérusalem, d'Adolf Eichmann et, à Lyon, de Klaus
Barbie.
Dans quelle généalogie inscrire l'actuelle mise en accusation de Paul Touvier pour
"complicité de crimes contre l'humanité" ? Dans le droit fil du procès Pucheu
ou dans celui de Nuremberg ?
Il faut rappeler ici sommairement ce que fut le procès de Nuremberg : la mise en
accusation des "grands" (major en anglais) criminels. La taille du criminel
n'était pas définie par l'ampleur ou la nature des crimes, mais par le fait que
l'accusé avait accompli ses actes dans plusieurs pays. Ainsi, Hans Fritzsche, directeur
du service radio de la propagande, d'ailleurs acquitté, était-il assis au banc des
"grands criminels", alors que Rudolf Hess, le commandant d'Auschwitz, ne
relevant pas de cette juridiction, fut condamné à mort par un tribunal polonais. Si le
crime de guerre et le crime contre l'humanité faisaient bien partie des chefs
d'inculpation, ils n'étaient pas au coeur de l'accusation.
Pour les Américains, les véritables ordonnateurs de l'événement, l'essentiel était
les deux premiers chefs d'accusation : le crime contre la paix et le complot contre la
paix. Il s'agissait, pour ces derniers, d'éviter d'avoir à intervenir militairement en
Europe, de risquer à nouveau la vie de leurs boys, comme ils l'avaient fait deux fois en
l'espace de trente ans. Leur premier objectif n'était pas d'éviter les crimes de guerre
ou ceux de génocide, mais d'éviter la guerre qui les avait engendrés. Cet aspect du
procès, sur lequel il conviendrait peut-être de réfléchir à nouveau aujourd'hui, est
tombé dans l'oubli : Nuremberg est resté dans les mémoires comme le temps de
l'émergence de la notion de crime contre l'humanité.
LA GUERRE HORS LA LOI
Quant au procès Eichmann, ce "Nuremberg du peuple juif ", selon l'expression du
premier ministre de l'Etat hébreu, Ben Gourion, il fut un des moments-clés, un des
événements fondateurs de l'émergence d'une véritable mémoire du génocide, en Israël
et dans les autres pays du monde. Mais, fondateur, ce procès l'est sur bien d'autres
points. A partir du cas Eichmann, il s'agissait, pour le procureur israélien Gideon
Hausner, de faire le procès de toute la politique d'extermination nazie, même dans les
aspects qui échappaient aux services d'Eichmann. Ce fut aussi un procès où les témoins
furent au premier plan, et non les documents, comme à Nuremberg. L'objectif était de
susciter l'identification aux victimes.
Enfin, pour la première fois, un procès était utilisé consciemment comme un outil
pédagogique. A Nuremberg, il s'agissait à la fois de juger, de faire l'histoire du
nazisme et de mettre la guerre définitivement hors la loi. A Jérusalem, on souhaitait
juger, certes, mais surtout éduquer les adolescents qui n'avaient pas connu la Shoah.
Pourtant, à Nuremberg comme à Jérusalem, les accusés étaient des hommes qui avaient
exercé des responsabilités majeures dans le système nazi.
Dans les nombreux procès qui suivirent en France la fin de la guerre, les
responsabilités dans la déportation des juifs de France, sans être totalement absentes,
notamment lors des instructions, n'occupèrent qu'une place marginale. Peu nombreux furent
ceux qui, à l'instar d'Henri Hertz (1), s'en indignèrent, y compris chez les juifs de
France. L'heure était pour ces derniers à la réintégration dans la communauté
nationale, dont la contre-révolution vichyssoise les avait exclus et que le
rétablissement des lois de la République par le gouvernement provisoire du général de
Gaulle rendait pleine et entière.
L'heure n'était pas encore, comme elle l'est aujourd'hui, aux vertus de la "
mémoire ". En 1964, la loi décrétait imprescriptible le crime contre l'humanité.
Dès lors, pour pouvoir ouvrir ou rouvrir un procès, il fallait que ce fût pour ce chef
d'accusation, et celui-là seul.
ENSEIGNER LA SHOAH
La lignée des procès d'épuration ouverte par celui de Pucheu croise ainsi celle ouverte
par Nuremberg, au risque de la confusion : réduire la Shoah à une guerre
franco-française, oublier son centre, l'Allemagne nazie, pour ne voir que sa périphérie
: la France. Elle fait du génocide des juifs une conséquence des guerres
franco-françaises, autrement dit un objet de règlement de comptes interne au pays. Elle
risque aussi d'isoler les seules victimes juives, ce qui, dans le cas des crimes
perpétrés par la milice, manque de pertinence historique : dans la seule région
lyonnaise, des dizaines de charniers où les corps de résistants, otages, juifs ont été
mêlés témoignent de la violence sanguinaire qu'elle partagea avec l'occupant et qui
régna dans les semaines précédant la Libération.
Le procès de Paul Touvier soulève bien d'autres questions sur lesquelles il serait
souhaitable de mener une réflexion. La justice est-elle chargée de dire l'histoire ? La
mémoire doit-elle se nourrir essentiellement d'épisodes judiciaires fortement
médiatisés, et dans ce cas est-elle vouée à s'éteindre avec la mort du dernier des
accusés potentiels ? Ne faut-il pas plutôt réfléchir, comme le font d'ailleurs les
enseignants d'histoire depuis bientôt quinze ans, à la façon d'enseigner la Shoah, dans
les lycées certes, mais aussi dans les universités, qui ont pour mission de former les
enseignants ?
Toutefois, le risque majeur à nos yeux serait d'instrumentaliser le cas Touvier en
tentant d'user de la Shoah pour une anamnèse du passé français. Les mains de la milice
sont entachées du sang de Victor Basch, de Jean Zay, de Georges Mandel et de bien
d'autres plus obscurs. Nous ne devons pas l'ignorer. Sa fonction ne fut pas pourtant
spécifique de la solution finale.
Annette Wieviorka
La tragédie juive de 1942 en France : ombres et
lumière
LE MONDE | 03.10.05 | 10h18 • Mis à jour le 03.10.05 | 10h18
Un nombre important de Justes (environ 1 700) de France ont été individuellement
honorés, et un dictionnaire (Dictionnaire des Justes de France, Fayard) vient d'exposer
quel fut l'engagement de chacun d'entre eux pour sauver des vies juives. Il y eut
certainement en France beaucoup plus de Justes que ceux que l'on reconnaîtra comme tels.
J'ai toujours affirmé que la quasi-totalité des juifs qui ont survécu dans notre pays
ont bénéficié à un moment ou à un autre d'un acte de solidarité de la part de la
population non juive. Individuellement toutefois, il faut insister là-dessus, les Justes
n'auraient pu obtenir ce qui a été obtenu : c'est-à-dire la survie de trois quarts des
juifs de France : 80 000 victimes (76 000 déportés, 3 000 morts dans les camps en
France, un millier d'exécutés ou d'abattus sommairement) et 240 000 survivants ;
statistiquement le moins terrible bilan de toutes les grandes communautés juives
d'Europe.
Dès 1983, dans Vichy-Auschwitz, j'ai mis en lumière l'agent principal de cette survie :
la réaction collective et spontanée de la majorité de ces Français qui ont exprimé
leurs points de vue quand ils ont été confrontés en zone libre à l'arrestation de
familles juives par la police française et à leur livraison aux Allemands en zone
occupée pour être déportés.
Très peu ont approuvé ; beaucoup ont critiqué ou condamné ces mesures prises dans un
territoire où il n'y avait ni Gestapo ni troupes allemandes d'occupation. Leur influence
sur le gouvernement de Vichy, maître tout- puissant de la vie de 300 000 juifs
parfaitement recensés et facilement arrêtables, a été déterminante dans le bon sens.
Pour le constater, il est important de revenir sur l'enchaînement des événements qui
ont conduit le régime de Vichy à s'associer à la criminelle "solution finale"
et à se déshonorer à jamais. Il le faut afin de montrer comment la réaction de
l'opinion publique en zone libre, là où elle pouvait s'exprimer avec moins de risques
qu'en zone occupée, a entraîné d'exceptionnelles conséquences.
Le 6 mai 1942, à Paris, Reinhardt Heydrich, chef de la police du IIIe Reich, rencontre
René Bousquet, chef de la police de Vichy. Il l'informe qu'il disposera de trains pour
déporter, en 1942, 5 000 juifs internés en zone occupée. En réponse, Bousquet lui
propose, pour la déportation, les juifs étrangers internés en zone libre.
Cette ouverture inattendue est retenue par les Allemands, qui, à la demande de Bousquet,
éliminent Louis Darquier de Pellepoix et sa police aux questions juives du rôle de
rafleurs des juifs pour confier cette mission à la police nationale de Bousquet, jugée
plus digne de leur confiance.
Le 11 juillet 1942, à Berlin, la mise en oeuvre de la "solution finale" dans
les pays de l'Ouest européen est programmée : rapidement est fixé pour la France un
contingent de 40 000 juifs à déporter dans un premier temps.
Le 16 juin, les chefs SS Karl Oberg et Helmut Knochen (ce dernier vient de mourir en
Allemagne) obtiennent l'accord de Bousquet pour la livraison de 10 000 juifs étrangers en
zone libre.
Cet accord va sceller le destin de ceux qui feront partie des 80 000 victimes : en effet,
si la police française se prépare à arrêter les juifs en zone libre, comment le
gouvernement français pourrait-il s'opposer aux mêmes persécutions en zone occupée ?
Pierre Laval n'a certainement pas été informé par Bousquet de ce scabreux accord
policier du 16 juin puisque, au cours du conseil des ministres du 27 juin, il est noté :
"Ce matin, visite de M. Bousquet qui a apporté un télégramme. M. Leguay
[délégué de Bousquet en zone occupée] a été prié par le capitaine Dannecker [chef
du service des affaires juives de la Gestapo] de venir le voir. Aux termes de l'accord on
devrait interner 10 000 juifs en zone libre. M. Pierre Laval déclare qu'il n'a jamais
donné aucun accord. Erreur fondamentale."
Mis au courant de cet accord sur lequel il ne revient pas, Laval proposera aux Allemands
que les enfants des parents qui leur seront livrés de zone libre soient également
déportés avec eux. Probablement ne veut-il pas qu'en ce pays où la famille est plus que
jamais à l'honneur on l'accuse de séparer les uns des autres. Pour les enfants des juifs
arrêtés en zone occupée, Laval déclarera à la Gestapo que c'est aux Allemands de
décider de leur sort.
Entre-temps, Bousquet l'a poussé à accepter que les arrestations de juifs à Paris et en
province soient opérées par la police française, qui arrêtera le nombre voulu de juifs
à condition que ces juifs soient exclusivement des étrangers.
Le nombre voulu n'ayant pas été atteint, les autorités françaises insisteront pour le
compléter en y joignant les enfants arrêtés, pourtant français pour la plupart, et en
usant du même prétexte "humanitaire" que celui invoqué par Laval.
Rafle du Vélodrome d'Hiver à Paris, rafles en province de zone occupée, livraisons de
milliers de juifs jusque-là internés dans les camps de Vichy en zone libre, la
coopération policière est massive : entre le 17 juillet et le 26 août, jour de la
grande rafle en zone libre ; soit en quarante jours, 19 000 juifs seront déportés de
France, dont plus de 3 900 enfants.
Rendue optimiste par l'importance de ces livraisons, la Gestapo de Paris obtient de
Berlin, le 28 août, la mise à disposition d'un train quotidien de déportation de 1 000
juifs pour la période allant du 15 septembre au 15 octobre.
La Gestapo sait, en effet, que Vichy est en mesure d'arrêter et de livrer des dizaines de
milliers de juifs : partout les juifs sont recensés et sous le contrôle de
l'administration préfectorale et des forces de police, qui feront ce que leur
gouvernement leur ordonnera.
Le 26 août 1942, dans les 40 départements de la zone libre, s'effectue l'arrestation de
milliers de juifs prévue pour atteindre le contingent promis aux Allemands de 10 000
têtes.
C'est en fonction de ce nombre de 10 000 à ne pas dépasser que des critères ont été
établis par la police nationale, qui suit attentivement à Vichy les résultats de la
rafle, laquelle se révèle décevante : de nombreux juifs visés par la rafle ont été
prévenus et ont trouvé refuge chez des non-juifs compatissants.
L'opinion publique en zone libre admet difficilement que son gouvernement, son
administration préfectorale et sa police remplissent à la demande des Allemands une
mission aussi discutable, alors que le gouvernement Pétain-Laval dispose encore de
l'Empire, de la flotte et de l'appui économique que la France apporte au IIIe Reich dans
une collaboration où l'ordre règne sur tout le territoire à la satisfaction des
Allemands, qui n'ont besoin que d'une faible couverture militaire et policière,
concentrant leurs forces à leurs offensives à l'Est et en Libye.
Les Français ne sont pas seulement critiques du lâche comportement de leur
gouvernement, ils sont sensibles aussi aux souffrances des victimes et ne se font pas
d'illusions sur leur sort. Les victimes ne sont pas des adultes jeunes ou dans la force de
l'âge, dont on peut croire qu'ils partent pour le travail forcé ; ce sont des parents,
des vieillards, des enfants, des malades, des impotents transportés dans des conditions
inhumaines, entassés dans des wagons à bestiaux et dirigés vers Drancy, camp de transit
en vue de la déportation.
Les préfets répercutent immédiatement sur Laval les réactions défavorables de la
population et des Eglises. Certains des prélats les plus influents, parce que
pétainistes, ont pris parti contre ces mesures et, parmi eux, le plus en vue, le cardinal
Gerlier, primat des Gaules, qui couvre le sauvetage à Lyon d'une centaine d'enfants juifs
par les Amitiés chrétiennes.
L'effet sur Vichy de cette oppo- sition soudaine et inattendue est immédiat : le 2
septembre, à Paris, Laval prévient les chefs SS qu'en raison de "la résistance
sans pareille de la part de l'Eglise" il ne pourra remplir le programme qui vient de
lui être communiqué par la Gestapo de 50 000 juifs pour 50 trains. Il remplira,
déclare-t-il, le programme initialement demandé. Et, effectivement, le 11 novembre 1942,
l'ultime convoi de l'année sera mis en route pour Auschwitz ; 41 000 juifs auront été
déportés, dont 33 000 en onze semaines entre le 17 juillet et le 30 septembre.
Conscients des difficultés que rencontre Laval, les chefs SS (Knochen, Oberg, Herbert
Martin Hagen) refuseront au service des affaires juives de la Gestapo d'exiger de la
préfecture de police de très grandes rafles qui nécessitent l'accord du gouvernement de
Vichy (à l'exception des rafles visant les juifs roumains et les juifs grecs).
Le 25 septembre, Knochen télexera à Adolf Eichmann un message extrêmement important où
il lui fait savoir que Heinrich Himmler lui-même a admis qu'en raison de la situation
politique et de la position de Pétain et de Laval la déportation des juifs français ne
peut être envisagée pour l'instant et qu'en conséquence "il ne sera pas possible
de faire évacuer des contingents élevés de juifs".
Certains historiens qui ne veulent pas prendre en considéra- tion le rôle collectif
bienfaisant et efficace exercé par les Français auprès de leur gouvernement ont
prétendu que les trains nécessaires à ces transports quotidiens n'étaient pas
disponibles à l'automne 1942.
Aucun document ne confirme leur point de vue. Par contre, il suffit de lire une note du 16
septembre 1942 du diplomate chargé des questions juives à l'ambassade d'Allemagne à
Paris, Carltheo Zeitschel, pour se rendre compte du désappointement allemand : "Il
aurait été possible qu'un train par jour soit mis à disposition pour octobre, soit 31
trains ; malheureusement, le SD de Paris n'a pas pu profiter de cette complaisance, parce
que les mesures françaises en zone non occupée - en particulier depuis les lettres
pastorales bien connues et les sermons dits en différentes chaires, ainsi que
l'ingérence de la représentation américaine à Paris et de la radio anglaise à Londres
- n'ont plus été exécutées que de façon lamentable, de sorte que le nombre de juifs
sur lequel on comptait primitivement n'est pas disponible."
Par ailleurs, il est évident que les trains ne manquent pas à l'Ouest en octobre 1942,
puisque de Belgique furent déportés 4 365 juifs entre le 10 octobre et le 1er novembre
et des Pays-Bas 12 919 juifs entre le 1er octobre et le 2 novembre.
Les réticences de Vichy, sermonné et surveillé par les Eglises et par la population, ne
vont pas cesser d'agacer les autorités allemandes pendant le reste de l'Occupation.
Après l'invasion, en novembre 1942, de la zone libre, devenue zone sud pour les Français
et zone nouvellement occupée pour les Allemands, Vichy n'y a plus donné de directives à
ses forces de police pour arrêter les juifs en vue de leur déportation, à l'exception
de deux opérations spéciales : la rafle de 800 juifs à Marseille en janvier 1943 et
celle de 2 000 hommes juifs en février 1943 en représailles à un attentat antiallemand.
Désormais, les juifs ont été essentiellement arrêtés dans cette zone par les
Allemands eux-mêmes et par leurs séides fran-çais dépendant directement de la Gestapo.
Quant aux opérations massives qui auraient pu être menées par la police française,
telles l'arrestation des juifs dans la zone d'occupation italienne ou la dénaturalisation
généralisée des juifs naturalisés après le 10 août 1927, elles ont été
empêchées, l'une en raison de la protection accordée par les militaires et les
diploma-tes italiens à ces juifs placés sous leur autorité, l'autre en raison de
l'opposition de l'Eglise catholique officiellement communiquée à Pétain.
En outre, Vichy, constatant l'évolution de la situation militaire en défaveur des
Allemands, a poursuivi sa ligne d'action antisémite xénophobe : les importantes rafles
de février 1943 et de février 1944 à Paris ont visé, comme en juillet 1942, des cibles
juives étrangères et "apatrides". Laval n'a lâché les juifs français qu'en
janvier 1944, quand leur arrestation à Bordeaux fut opérée par la police française.
En conclusion, la tragédie juive en France, avec ses ombres et sa lumière, repose sur
les données suivantes :
1. - Le gouvernement antisémite et xénophobe de Vichy ne voulait pas la déportation et
la mise à mort des juifs. Il s'agissait d'un antisémitisme d'exclusion.
2. - Confronté aux demandes allemandes, dont le but final était clair, Vichy s'est rendu
complice du IIIe Reich en arrêtant pendant l'été 1942 plus de 30 000 juifs étrangers
et leurs enfants français et en les livrant à la Gestapo pour qu'ils soient déportés.
3. - Vichy aurait poursuivi sa coopération policière massive si la population française
en zone libre et ses élites spirituelles ne l'avaient puissamment incité à freiner
cette collaboration criminelle.
Par la suite, le sort des armes défavorable au IIIe Reich et la sympathie agissante de la
majorité des Français en faveur des juifs persécutés ont maintenu Vichy dans le cadre
d'une collaboration policière antijuive correspondant à la nature de son antisémitisme
et non à celui fanatisé de la Gestapo.
Comptable de toutes les vies des citoyens français et des étrangers dont il avait la
charge, le gouvernement de l'Etat français, en persécutant et en livrant aux nazis une
partie des juifs vivant dans notre pays, s'est rendu coupable d'un crime dont il ne se
relèvera jamais et qui à jamais restera gravé dans la mémoire collective des
Français.
par Serge Klarsfeld
Article paru dans l'édition du 26.08.03

http://www.liberation.fr/page.php?Article=269553#
http://www.liberation.fr/page.php?Rubrique=AUSCHWITZ
Pour «que le “plus jamais ça“ devienne réalité»
Au nom des survivants, c'est ce qu'a demandé Simone Veil aux dizaines de chefs d'Etats et
de gouvernements participant à la cérémonie du soixantième anniversaire de la
libération du camp d'extermination.
par L. B.
LIBERATION.FR : jeudi 27 janvier 2005 - 18:44
* diminuer la taille de la police
* augmenter la taille de la police
* imprimer l'article
* envoyer l'article
* article les plus envoyeés
* écrire à l'auteur de l'article
Le froid, la neige et brusquement un sifflement suivi d'un bruit de train: les
cérémonies du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz ont débuté, jeudi, peu
avant 15h00 en présence de dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement, de survivants, de
soldats soviétiques qui avaient participé à la libération du camp de concentration en
1945 et de centaines de jeunes chargés de préserver la mémoire du drame pour qu'il ne
se répète plus jamais. Sous un temps glacial, les orateurs, rescapés et officiels, se
sont succédé.
Sur le même sujet
* Chirac: «Votre souvenir, celui de ce “monde qui fut“, est pour la France plus
qu'une douleur.»
* «Le crime commence avec des mots»
* La cérémonie en images
* «Nous devons nous souvenir»
«Souvenons-nous que nous sommes sur le lieu du plus immense cimetière du monde, un
cimetière où il n'y a pas de tombes, pas d'ossements, mais où reposent les cendres de
plus d'un million de gens», a lancé le ministre polonais de la Culture Waldemar
Dabrowski, dans son discours d'ouverture de la cérémonie, organisée en plein air, sur
le lieu du mémorial installé entre les ruines de deux chambres à gaz du camp de
Birkenau. Un millier de survivants du camp, beaucoup portant leurs brassards de
prisonniers, étaient blottis sous la neige aux côtés de 44 chefs d'Etat et de
gouvernement. Sur le site où brûlaient des milliers de bougies en hommage aux morts
d'Auschwitz - plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants, presque tous juifs - le
Polonais Wladyslaw Bartoszewski, ancien ministre des Affaires étrangères et grande
figure de la réconciliation polono-allemande, aujourd'hui âgé de 82 ans et qui fut le
prisonnier numéro 4427, a lui rappelé que la résistance polonaise avait alerté le
monde libre, notamment le Royaume-Uni et les Etats-Unis, de la situation à
Auschwitz-Birkenau. Mais, a-t-il ajouté, «aucun pays du monde n'avait réagi de manière
appropriée à la gravité de la situation. (...) Des moyens efficaces (pour arrêter
l'extermination des Juifs) n'ont pas été trouvés et pour dire la vérité, on ne les a
pas cherchés».
L'ancienne présidente du Parlement européen, Simone Veil, qui fut déportée à
Auschwitz, a été l'une des première à prendre la parole dans l'enceinte du camp de
Birkenau: «Aujourd'hui, 60 ans après, un nouvel engagement doit être pris pour que les
hommes s'unissent au moins pour lutter contre la haine de l'autre, contre
l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'intolérance», a-t-elle déclaré. Portant
témoignage au nom des anciens prisonniers juifs, elle a fait valoir que «les pays
européens qui, par deux fois, ont entraîné le monde entier dans des folies
meurtrières, ont réussi à surmonter leurs vieux démons». «C'est ici, où le mal
absolu a été perpétré, que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde
fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité, a-t-elle poursuivi. Nous, les derniers
survivants, nous avons le droit, et même le devoir, de vous mettre en garde et de vous
demander que le “plus jamais ça“ de nos camarades devienne réalité».
Plus tard, le président israélien Moshe Katzav a déploré que le monde, au courant de
l'extermination des juifs d'Europe, soit resté «muet». Parlant depuis «le plus grand
cimetière juif du monde», il a également souligné que l'Europe était maintenant
confrontée à une nouvelle vague d'antisémitisme. «Soixante ans après la Shoah, nous
sommes confrontés à une recrudescence de l'antisémitisme en Europe. Se peut-il que le
pouvoir de dissuasion de la Shoah se soit à présent atténué ? La réponse est entre
les mains des leaders européens, des éducateurs, des historiens et entre nos propres
mains». Et d'ajouter: «Auschwitz-Birkenau est le lieu du crime le plus terrible et le
plus grand qui ait été, dans toute l'histoire de l'espèce humaine (...) Au-delà de
toutes les divergences, nous sommes tous associés au souvenir des atrocités, à la
leçon humaine: il nous incombe, à nous, fils du peuple juif, le devoir historique de
perpétuer et d'alimenter la flamme éternelle comme nos frères et sœurs, victimes
de la Shoah, l'attendent de nous».
Le nonce du Vatican en Pologne, Mgr Jozef Kowalczyk, est venu lire un message du pape Jean
Paul II: «Il n'est permis à personne de passer avec indifférence devant la tragédie de
la Shoah. Cette tentative de destruction systématique de tout le peuple juif reste comme
une ombre sur l'Europe et sur le monde entier; c'est un crime qui marque pour toujours
l'histoire de l'humanité».
Pour clore la cérémonie, des prières œcuméniques ont été prononcées et des
milliers de bougies allumées au mémorial international de Birkenau.

Le phénomène "Les Bienveillantes
 
"
LE MONDE DES LIVRES | 21.09.06 | 18h04 •
Mis à jour le 21.09.06 | 18h04
La rentrée littéraire 2006 fera date. Sa production était riche et prometteuse.
Chacun avait sa chance. Mais un projectile littéraire hors catégorie est venu jouer les
trouble-fête. Un pavé de 1 kilo et 150 grammes, qui compte 912 pages et coûte 25 euros.
Les Bienveillantes, de Jonathan Littell (Gallimard), est le phénomène de la rentrée.
Jeudi 21 septembre, soit pile un mois après sa date de parution, ce premier roman écrit
en français par un auteur de nationalité américaine a atteint les 170 000 exemplaires.
Et ce n'est qu'un début : le livre figure sur les premières sélections du Goncourt, du
Renaudot, du Médicis et du Femina. Tous les espoirs lui sont donc permis. Surtout si l'on
se réfère à la lettre des deux frères Goncourt, qui recommandait que le prix soit
donné "à la jeunesse, à l'originalité du talent, aux tentatives nouvelles et
hardies de la pensée et de la forme".
"Il s'agit certes d'un succès hors norme", reconnaît Richard Millet, son
éditeur, mais qui "repose sur les deux outils traditionnels de promotion : les
libraires et la presse écrite." L'ouvrage a été en amont sélectionné par le
magazine Pages qui réunit les libraires indépendants, par les maisons de la presse ; il
figurait dans la liste des Virgin-Furet du Nord et dans celle des Espaces Leclerc. Fait
exceptionnel pour un roman, jeudi 24 août, un bandeau "Attention chef-d'oeuvre"
se rapportant aux Bienveillantes barrait la "une" du Nouvel Observateur.
Le livre a été initialement tiré à 12 000 exemplaires, avec une mise en place de 5
000, ce qui constitue déjà un dispositif plus important que la norme (3 000 exemplaires
pour un premier roman), mais conforme aux engagements pris avec l'agent anglais Andrew
Nurnberg, qui a apporté l'affaire à Gallimard. A 12 000 exemplaires, la maison de la rue
Sébastien-Bottin ne rentrait pas dans ses frais. Depuis, elle ne cesse de courir après
les ruptures de stock.
Les premières alertes se sont fait sentir dès le 1er septembre. Gallimard avait
anticipé un stock de papier pour 25 000 exemplaires, qui fut vite écoulé. Vu le volume
de l'ouvrage, Gallimard avait opté pour un papier spécial au grammage plus important,
"afin d'assurer une meilleure prise de main", précise Daniel Ingwiller, le
directeur de la fabrication. Un papetier isérois a pu in fine fournir à la demande.
Début septembre, les trois Cameron de l'imprimeur CPI (Bussière à Saint-Amand-Montrond,
Firmin Didot, près de Dreux et Brodard & Taupin, à La Flèche) ont tourné à plein
régime pour assurer les réassorts. Depuis, l'ensemble de la production a été
concentré sur le site de La Flèche. L'imprimeur a pour consigne de "tirer au
papier", d'aller à l'épuisement des bobines.
Depuis dix jours, Gallimard n'appose plus le bandeau rouge qui reprend les premiers
mots du roman, "Frères humains, laissez-moi vous raconter..." pour gagner
vingt-quatre heures. Philippe Le Tendre, le directeur des ventes, a "fermé l'article
à la vente", une procédure exceptionnelle qui lui permet tous les matins de faire
le point avec la Sodis, le diffuseur du groupe, afin de lister les commandes prioritaires
- les libraires avant les grossistes - et de faire la chasse aux invendus.
ASSÈCHEMENT DU MARCHÉ
Chez Gallimard, en littérature générale, pour trouver un phénomène du même type,
il faut remonter à Balzac et la petite tailleuse chinoise, de Dai Sijie, dont 100 000
exemplaires s'étaient vendus en janvier 2000. L'autre référence, c'est bien entendu
Harry Potter.
"Le phénomène nous échappe", constate Pascale Richard, l'attachée de
presse chargée du suivi du livre. En quinze ans de Gallimard, c'est la première fois
qu'elle vit une telle frénésie. Actuellement, elle passe la majeure partie de son temps
à protéger l'auteur de demandes d'interviews les plus saugrenues. L'ambiance est
d'autant plus électrique que plusieurs critiques négatives ont été publiées
(notamment dans Les Inrockuptibles et dans Libération). Sans parler d'un article de
Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qui, dans Le Journal du dimanche du 17
septembre, écrit : "Ces 900 pages torrentielles n'accèdent jamais à l'incarnation.
Le livre entier demeure un décor et la fascination de Littell pour l'ordure, pour le
cauchemar et le fantastique de la perversion sexuelle, irréalise son propos et son
personnage, suscitant malaise, révolte, on ne sait pas contre qui et quoi".
Jonathan Littell a prévenu. Il n'entend pas faire de télévision, un média où il ne
se sent pas à l'aise. Il sera présent aux Correspondances de Manosque, les 23 et 24
septembre, puis dans quatre librairies : le 3 octobre chez Sauramps, à Montpellier, le 4
chez Ombres blanches, à Toulouse, le 5 au magasin Virgin des Champs-Elysées, à Paris,
et le 6, chez Kléber, à Strasbourg. Pour Laurent Bonelli, qui a cru en ce livre très
tôt, "il y a beaucoup de vingt-trentenaires masculins parmi les acheteurs, un public
comparable à celui de Houellebecq, mais en plus nombreux". Autre point, "les
gens ne veulent que ce livre-là", dit-il.
De fait, plusieurs maisons d'édition constatent un certain assèchement du marché. Au
Seuil, L'Amant en culottes courtes, d'Alain Fleischer, présent aussi dans les quatre
listes, est encore loin des 10 000 exemplaires, malgré une presse très élogieuse.
"Si tous les acheteurs du Littell se transforment en lecteurs effectifs, le reste de
la rentrée littéraire sera comme aspirée par un trou noir", constate Olivier Nora,
PDG de Grasset. Car le livre demande un temps de lecture important.
Outre Gallimard, le succès foudroyant des Bienveillantes fait un deuxième heureux,
Andrew Nurnberg, l'agent de Jonathan Littell, qui détient les droits mondiaux de son
livre. Une partie d'entre eux se négocieront à la Foire de Francfort, début octobre.
Pour le manuscrit d'origine écrit en français, il avait été envoyé sous le pseudonyme
de Jean Petit, à quatre éditeurs, "en même temps", dit-il. C'est après coup
que fut dévoilé que derrière ce nom se cachait le fils d'un auteur de polars à
succès, américain, mais élevé en France et imprégné de culture européenne.
Le montant de la transaction avec l'agent anglais reste secret à ce jour. Mais
l'éditeur français assure toutefois que celle-ci était "raisonnable". Dans
cette négociation, Gallimard a aussi bénéficié d'un atout supplémentaire :
"Jonathan Littell voulait la Blanche, à cause de Jean Genet, de Maurice Blanchot et
de Louis-René des Forêts", assure Richard Millet.
Alain Beuve-Méry
Article paru dans l'édition du 22.09.06
Nouveauté - Événement
Les Bienveillantes: briser le silence du bourreau
In Radio-Canada.
Une critique de Florence Meney
Dans le foisonnement de la rentrée littéraire française, un titre revient sans
cesse. Il s'agit d'un premier roman noir et immense (900 pages), qualifié de
chef-d'oeuvre par des magazines prestigieux comme le Nouvel Observateur, comparé même au
Guerre et Paix de Tolstoï. Les Bienveillantes est déjà sur les listes préliminaires
des plus grands prix littéraires.
Les Bienveillantes, c'est ainsi que les Grecs anciens appelaient les Érinyes,
divinités vengeresses du crime. Les Bienveillantes, c'est le fruit d'années de
recherches, de lectures, de travail de documentation quasi obsessionnel pour Jonathan
Littell, 38 ans.
Comme point de départ, la photo d'une jeune fille russe torturée, puis pendue par les
Allemands en 1941. Ce cliché a profondément marqué le jeune auteur, un Américain juif,
travailleur humanitaire, qui dit avoir voulu briser le silence des bourreaux en donnant la
parole à l'un d'eux.
Un projet délirant en effet que celui de Littell: se mettre dans la peau d'un officier
SS pour raconter l'extermination systématique des Juifs, pour décortiquer aussi et
surtout la démarche psychologique et intellectuelle du bourreau, l'objectivation de
l'abject, de celui qui combat son humanité pour accomplir sa tâche infâme et qui trouve
des justifications idéologiques aux pires atrocités.
Des charniers à la dentelle
Son " héros " est-il un monstre? Difficile de se prononcer. Max Aue, qui
dirige une fabrique de dentelle dans le nord de la France et qui a échappé aux purges,
se penche sur sa jeunesse, et surtout sur son passé au coeur du troisième Reich,
quarante ans plus tôt.
Les bienveillants
Cet être cultivé, homosexuel clandestin, qui lit les philosophes antiques, s'est
retrouvé par le jeu du hasard parmi les officiers SS qui ont mené la campagne sur le
front est, dans le Caucase, l'Oural, à Stalingrad et dans des camps. Il a vu et
participé aux pires sévices, au " nettoyage " systématique, aux exécutions
en masse où l'on oblige les condamnés vivants à s'allonger sur les cadavres frais pour
y être abattus sans que cela fasse désordre. Le système de la boîte de sardines, comme
l'appellent les nazis.
Max Aue est un homme aux yeux grands ouverts, qui entre en pleine connaissance de cause
dans la spirale de la logique nazie.
Rasch a raison. Ça n'a aucune utilité économique ou politique (le massacre des
Juifs)... [...] Et donc ça ne peut avoir qu'un sens: celui d'un sacrifice définitif, qui
nous lie définitivement, nous empêche une fois pour toutes de revenir en arrière.
—
Froidement, analytiquement, avec minutie, ponctuant son récit de réflexions
politiques, sociales, philosophiques, Max Aue décrit les rafles, les assassinats, les
tortures, mais surtout les effets de ces actes cumulés sur les soldats et les officiers
qui trempent leurs mains dans le sang. Violence aveugle, suicides, alcoolisme, déviances
multiples.
Depuis mon enfance, j'étais hanté par cette passion de l'absolu et du dépassement
des limites; maintenant, cette passion m'avait mené au bord des fosses communes de
l'Ukraine. —
Une fresque effarante, insoutenable, un Guernica, d'une noirceur d'autant plus
insoutenable qu'elle a la teinte de la vérité. Magistral, mais au-delà de la limite du
supportable.
Critiquede Jonathan Littell
Lorsqu’en 1953 Robert Merle fit paraître La mort est mon métier, Mémoires
imaginaires de Rudolf Höss, commandant du camp d’Auschwitz, l’écrivain et
éditeur Jean Cayrol, ancien déporté à Mauthausen, réagit dans la revue Esprit de
façon virulente, dénonçant le roman comme une tentative indue de " donner un corps
romanesque à ce qui n’était qu’un monstre impossible à décrire ". Un
demi-siècle plus tard, c’est en prêtant voix à un officier supérieur nazi qui,
sur quelque neuf cents pages, relate les années 1941-1944 telles qu’il les a
vécues, à Berlin et sur le front de l’Est, que Jonathan Littell signe une entrée
stupéfiante sur la scène littéraire française. Le roman s’intitule Les
Bienveillantes ; à travers le destin inventé du SS Maximilien Aue, il suit notamment les
activités des sinistres Einsatzgruppen SS – ces groupes mobiles avançant dans le
sillage de l’armée allemande pour exterminer les communistes et les juifs des
territoires conquis –, et il se pourrait qu’il suscite semblables critiques à
celle prononcée par Cayrol. La fiction n’est-elle pas, en effet, au regard de la
spécificité du crime commis, de son intransmissibilité ontologique, le " crime
moral " que dénonçait Claude Lanzmann, l’auteur de Shoah ? Mais Jonathan
Littell n’a pas choisi l’intenable position qui aurait consisté à donner une
représentation romanesque du plus grand génocide de l’Histoire. C’est en
quelque sorte en marge de l’indicible qu’il se tient, tout en se tournant
pourtant, sans lyrisme ni complaisance, du côté des bourreaux. Cela pour
s’interroger, à son tour, sur la " banalité du mal ", naguère définie
par Hannah Arendt, et sur la façon dont l’appareil génocidaire nazi s’en est
nourri et servi.
Le résultat est saisissant. Fresque de grande ampleur où sont convoqués des
centaines de personnages réels ou fictifs, portée par une authentique puissance
narrative et un souci éthique omniprésent – on pense souvent, à la lecture, à Vie
et destin de Vassili Grossman –, Les Bienveillantes n’est certes pas de ces
romans qu’on peut envisager d’aimer, mais il se dégage de ses pages une force
de conviction hors du commun, une sensation inouïe de réalisme et de justesse. Que ce
récit soit né sous la plume d’un écrivain de 39 ans, qui signe là sa première
œuvre littéraire, n’est pas le moins surprenant. Si son nom est familier,
c’est que Jonathan Littell est le fils de l’écrivain américain Robert Littell.
Et si, bien que de nationalité américaine, il écrit, lui, en français, c’est
qu’il a en partie grandi en France. C’est d’ailleurs dans la littérature
française qu’il puise ses références, la généalogie d’écrivains qu’il
a faite sienne : Sade, Flaubert, Genet, Blanchot, Bataille – c’est dire si la
question des liens entre la littérature et le mal n’est pas, pour lui, chose
impensée.
Le mal, la souffrance que les hommes s’infligent les uns aux autres, ce garçon
laconique, à l’allure et au visage adolescents, installé aujourd’hui à
Barcelone avec femme et enfants, se souvient y avoir été très jeune confronté : "
Lorsque j’étais enfant, chaque soir la télévision rendait compte des opérations
de l’armée américaine au Vietnam. J’avais 8, 9 ans, mais l’idée
d’être un jour appelé à aller me battre là-bas était une véritable hantise.
" Les hantises de l’enfance sont tenaces, et c’est sans doute pourquoi,
quinze ans plus tard, après trois années passées à la fac, Jonathan Littell part dans
les Balkans alors en flammes. Lorsqu’il atterrit en Bosnie, il est sans projet
particulier : " Je voulais simplement voir de près ce qu’était la guerre.
" C’est sur place, à Sarajevo, qu’il entre en contact avec
l’association humanitaire Action contre la faim (ACF), qui le recrute. Il y
travaillera sept ans, multipliant les missions, en Bosnie donc, puis en Tchétchénie, en
Afghanistan, au Congo, à Moscou... Jusqu’à ce que la lassitude le pousse à
s’arrêter. C’était en 2001.
La même année, il commence à travailler sur Les Bienveillantes – une
référence empruntée à Eschyle, qui, dans Les Euménides, fait intervenir ces
divinités cruelles et vengeresses. " Tout est parti d’une photographie que
j’ai eue sous les yeux il y a longtemps, en 1989, me semble-t-il : une jeune femme,
pendue par les nazis, à Kharkov, en Ukraine, et dont le corps est demeuré ensuite
étendu, abîmé dans la neige... " De cette image – présente, et même
récurrente, dans Les Bienveillantes – est né peu à peu le projet d’un roman,
portant sur la guerre 39-45, le front de l’Est. Quelques années plus tard, Littell
voit Shoah, de Claude Lanzmann, et est impressionné particulièrement par une séquence
d’entretien avec Raul Hilberg, dans laquelle l’historien américain souligne le
rôle joué par la bureaucratie nazie dans l’extermination des juifs d’Europe.
" Auschwitz, les chambres à gaz, je savais cela – je suis né dans une famille
d’origine juive, et même si elle a émigré de Pologne aux Etats-Unis à la fin du
XIXe siècle et n’a pas vécu de façon directe ces événements, j’ai
néanmoins grandi avec cette histoire. Mais le fait que le génocide ait été
l’œuvre d’un appareil bureaucratique organisé, rationalisé, budgété, je
ne le mesurais pas. " C’est cette machine administrative effarante, cette
logistique sophistiquée que l’on voit à l’œuvre, de l’intérieur,
avec une précision sidérante, dans Les Bienveillantes, à travers les faits et gestes de
Maximilien Aue. Un individu qui n’a a priori rien d’un pervers, ni d’un
idéologue fanatique. Un homme hanté par une histoire personnelle douloureuse, par des
rêves et des symptômes physiques qui semblent les indices d’une dégradation morale
intense, mais aussi un fonctionnaire du crime sans passion ni compassion, sans doutes ni
hésitations, mû par un pur et simple et effrayant souci d’efficacité. " Ce
que j’ai fait, je l’ai fait en pleine connaissance de cause, pensant qu’il
y allait de mon devoir et qu’il était nécessaire que ce soit fait, aussi
désagréable et malheureux que ce fût ", se justifie Maximilien Aue, en préambule
à ces Mémoires imaginaires.
On connaît cette rhétorique du devoir, de l’obéissance : les bourreaux nazis
appelés après guerre à comparaître y ont amplement eu recours. Jonathan Littell
n’ignore rien de l’historiographie du nazisme et des interprétations qu’il
a suscitées depuis soixante ans. Avant de se lancer dans l’écriture des
Bienveillantes, il s’est plongé, près de deux années durant, dans les archives
écrites, sonores ou filmées de la guerre et du génocide, les actes des procès, les
organigrammes administratifs et militaires, les études historiques et interprétatives.
Il s’est aussi rendu à Kharkov, à Kiev, à Piatigorsk, à Stalingrad... sur les
traces de l’invasion sanglante de la Wehrmacht s’enfonçant en URSS, à partir
de juin 1941. Le résultat, tangible dans le roman, de ces travaux préalables : un
sentiment de réel d’une prégnance incroyable. " C’est ça, le
sujet de ce livre : le réel. Or il y a un grain dans le réel, comme on parle du grain
d’une photographie : le réel a un goût, une odeur, des sons, et c’est cela que
je voulais retrouver, rendre au plus juste. Quand on invente, on simplifie toujours. Je ne
voulais surtout pas écrire ce qu’on appelle un roman historique, faire de ces
événements un décor de théâtre devant lequel faire évoluer mes personnages. Tant
qu’on s’appuie ainsi fermement sur le réel, la part inventée, romanesque,
tient la route. "
Et le réel est bien là, atroce, et qui, à travers le regard lucide et indifférent
d’Aue – au-delà de son histoire intime –, prend souvent toute la place :
l’invasion, les tueries, la mise en œuvre organisée du génocide, le souci
maniaque de rationaliser le crime, la déshumanisation sans fin des victimes. Pourquoi, de
cela, décider de faire un roman ? " Le but, bien entendu, est de tenter de
comprendre. Donc d’interpréter. La Shoah, en tant qu’objet historique, a ceci
d’unique qu’elle est extrêmement documentée et étudiée, mais demeure rétive
à l’interprétation. Chaque fait nouvellement établi suscite une nouvelle
interprétation, mais cette interprétation se heurte toujours à un blocage, et
l’énigme ne cesse de s’épaissir. " Cette opacité inscrit la Shoah dans
l’Histoire comme un crime incomparable. Et Jonathan Littell ne se livre, de fait, à
aucune comparaison. La question du bourreau, pourtant, il estime qu’elle se pose avec
acuité aux hommes de toutes les générations, jusqu’en ce XXIe siècle commençant
: il y eut le Vietnam, les guerres de décolonisation, il y a désormais Guantánamo et
l’Irak. Alors, pose-t-il, " aujourd’hui, les bourreaux, c’est un peu
nous ". Au moment où l’individu se doit de choisir entre le bien et le mal,
qu’est-ce qui fait pencher la balance ? L’abîme est sans fond.
Nathalie Crom
Télérama n° 2954 - 26 Août 2006
     
Les images semblent être tout droit sorties d'un album de vacances : on y voit un
groupe de femmes assises sur une balustrade en bois en train de déguster des myrtilles,
des hommes et des femmes allongés sur des chaises longues, d'autres en train de chanter
et de rire accompagnés par un accordéon.
Ces photographies, qui témoignent pour la première fois du mode de vie des
responsables et des personnels du camp d'Auschwitz, ont été rendues publiques jeudi 20
septembre par le Mémorial de l'Holocauste à Washington. Les 116 clichés sont tirés de
l'album privé de Karl-Friedrich Höcker, adjudant du commandant du camp de concentration
d'Auschwitz de mai 1944 à janvier 1945. Ils ont été remis au Mémorial en début
d'année par un ancien membre des services de renseignement militaire américains mort au
cours de l'été. L'officier, dont l'identité n'a pas été révélée, les aurait
trouvés dans un appartement vide de Francfort en 1946.
Ces images, qui ont fait la "une" du quotidien populaire allemand Bild,
confirment les témoignages des survivants d'Auschwitz. Alors que des centaines de
milliers de juifs étaient envoyés dans les chambres à gaz, le personnel administratif
du camp menait en parallèle une paisible existence. Dans le lotissement SS, à côté, il
y avait une piscine, un stade de football et une bibliothèque. Les SS disposaient d'une
sorte de maison de vacances située à 30 kilomètres au sud.
De nombreuses photos de l'album y ont été prises. D'autres clichés se rapportent à
des activités plus officielles : l'inauguration d'un hôpital SS, des séances de tir ou
une marche militaire. Jamais un détenu n'apparaît sur ces photos. Lors de son procès en
1962, Karl-Friedrich Höcker, qui sera condamné à sept ans de prison, s'était
retranché derrière son devoir. Il est mort en 2000 à 88 ans.
Autre découverte d'importance, le funeste docteur Josef Mengele, dont il existe très
peu de photographies, apparaît sur huit clichés. Ce médecin nazi surnommé "l'ange
de la mort" qui pratiquait des expériences médicales sur les détenus, est mort en
Amérique latine en 1979.
Les photos de Karl-Friedrich Höcker contrastent avec les rares autres images
existantes du camp d'Auschwitz avant sa libération. Le mémorial Yad Vashem, en Israël,
possède plusieurs photos prises par un officier SS le 26 mai 1944 sur l'arrivée de juifs
en provenance de Hongrie, la sélection, la marche en direction des chambres à gaz et
l'activité des fours crématoires.
La découverte tardive de ces photos, peu commentée outre-Rhin en dehors de Bild,
y suscite quelques interrogations. "Les services secrets américains voulaient-ils
protéger certains criminels ? Ou bien le rapport avec l'album n'est qu'un exemple
supplémentaire pour le désintérêt croissant avec lequel les Alliés ont poursuivi les
criminels nazis", souligne l'hebdomadaire Der Spiegel dans son édition de
lundi 24 septembre.
Article paru dans l'édition du 25.09.07.
|
