revues et sites
Lectures N°26
références_06
| |

  
http://www.parisduvivreensemble.org/

Henri Delasalle
Adresse : Chez les sœurs- Cité des 100
logements
Bloc B - N°20
40300 CHECHAR
Algérie
Téléphone. 032 35 31 53.
email : henridelasalle1@yahoo.fr
Notez le changement d’adresse email pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
Je ne consulte plus tous les jours l’ancienne adresse.
Chéchar, ce 3 janvier 2006
Chers parents et amis,
Un grand merci à tous ceux qui m’ont écrit pour ces
fêtes, parfois avec de très belles images – ou me donnant des nouvelles, de façon
à garder le contact. A mon tour de vous souhaiter une année 2006 avec beaucoup de
bonheur dans votre vie. En particulier le bonheur de donner du bonheur, le bonheur de se
donner aux autres dans les choses les plus simples, le bonheur d’aimer un peu plus
encore que l’année écoulée.
Et voici quelques nouvelles de mon coté, en espérant vous faire partager quelque
chose de la vie des gens d’ici.
Cette longue lettre a été l’occasion de faire le point plus sérieusement sur
ces deux mois passés en Algérie. En fait, deux mois, c’est court. Et je me sens
encore un peu dans ce temps des tout premiers pas, ce temps des commencements dont vous
connaissez sûrement l’impression un peu spéciale qui colore chaque journée :
Quand toute personne aperçue est une nouvelle rencontre, quand tout déplacement est une
découverte, quand votre visite fait très plaisir à vos hôtes simplement par
qu’ils sont curieux de voir un étranger fraîchement débarqué et portant avec lui
encore le parfum du pays d’origine, qui plus est la France… quand vous butez
aussi sur tous les petits détails de la vie qui vous changent de " chez
vous ", avant que l’apprivoisement se fasse et que de nouveaux réflexes
viennent… Et quand l’avenir paraît encore bien flou… mélangeant au fond
des tripes l’enthousiasme de l’aventure qui commence et l’angoisse de
l’inconnu.
Me voilà au début d’un séjour " fidei donum " en Algérie.
Fidei donum veut dire en latin " don de la foi " (ou qqchose comme
ça) et c’est surtout le titre d’une encyclique du pape à la fin des années
1950, au moment des décolonisations, qui invitait à instaurer entre les Eglises
anciennes et les Eglises jeunes des relations plus égalitaires. Ces mots latins
désignent aujourd’hui les prêtres prêtés par leur diocèse à une autre Eglise
mais peut concerner aussi des laïcs. Dans mon cas, à la demande de l’Eglise
d’Algérie (site : www.ada.asso.dz) et
après m’être proposé, je suis prêté par l’Eglise du Val d’Oise
(www.catholique95.com).
Le cadre institutionnel qui me concerne étant rappelé, comment vous dire en peu de
mot ce à quoi ma vie ici ressemble ? Dans quelle case connue de la plupart
d’entre-vous pourrai-je ranger ma vie ici ? Peut-être que je pourrais la
comparer à celle d’un prêtre étudiant, un prêtre en année
d’approfondissement : Avec un objectif de séjour très simple – apprendre
la langue locale dans tous les sens du terme, c’est à dire s’immerger, se
laisser transformer par les gens où milieu des quels j’ai été envoyé en me
faisant peu à peu de plus en plus proche. Et comme tout prêtre étudiant, m’a été
confié en parallèle un service pastoral de trois communautés religieuses dans un
secteur du diocèse – précisément dans le Sud-Est de Constantine : Chéchar,
Tébessa et Bir el Ater.
Mais l’étiquette " presque prêtre étudiant " n’est pas
satisfaisante car ce que j’ai appelé " objectif de séjour "
n’est pas universitaire du tout et aucun diplôme n’est prévu à la fin.
Et puis cet objectif ne m’est pas personnel : c’est un peu l’objectif
de vie de toute l’Eglise d’Algérie, une vie de fidélité au long des années
à ce peuple profondément musulman, une vie tissée jour après jour par des amitiés
profondes, parfois sur plusieurs générations, avec des Algériens. Je balbutie encore
pour vous décrire cette attitude du disciple du Christ que je n’ai pas beaucoup
réfléchi durant mon séminaire et mon service pastoral en France; et pour cause,
car les Chrétiens de France ont d’autres responsabilités au milieu de leurs
concitoyens. Mais c’est vrai qu’ils ont toujours eu aussi cette tâche-là et
qu’ils l’ont de plus en plus : inventer une fraternité respectueuse avec
ceux qui ne partagent pas notre foi, une fraternité de plus en plus profonde, sincère,
juste… notamment aujourd’hui au sein des jeunes générations, quand
l’autre revendique son islamité ou une autre appartenance qui le fait entrer en
contradiction avec ce que je crois.
Comme vous le voyez, ce " don de la foi " marche dans les deux
sens, je suis venu pour apprendre à être donné un peu plus à tout homme, et je
souhaite que ma venue ici soit l’occasion d’un échange entre mes deux Eglises
– entre les catholiques du Val d’Oise et les Algériens d’ici qui nous font
bon accueil.
En attendant, l’Evêque de Constantine s’inquiète pour moi :
" Tes journées ne te semblent pas trop longues dans cette petite ville
perdue ? " Et bien, non ! Du moins pour l’instant !
J’aimerai pouvoir plutôt les prolonger sur mon sommeil pour pouvoir à la fois
écrire au jour le jour les petits bouts de vie partagée dans la journée, et aussi
répondre à tous ceux qui m’écrivent par mails, et prier, et méditer les textes de
la liturgie du jour, et préparer de façon approfondie mon homélie du dimanche – ce
n’est pas parce que je n’ai pas beaucoup de paroissiens qu’il faut moins
travailler, tout en faisant le voyage jusqu’aux 2 communautés de Tébessa et de Bir
plusieurs fois par mois, et encore faire les courses, la cuisine, le ménage, la lessive,
et aussi visiter régulièrement les quelques connaissances sur Chéchar, et surtout
rester très disponible pour faire d’autres connaissances, et tout autant que tout ce
qui précède, faire progresser plus vite mes possibilités d’expression en arabe
algérien.
Ayant été prêtre en paroisse, avec d’autres responsabilités en mouvement, je
m’étonne moi-même de ressentir une telle impression de manque de temps, mais il y a
quelques explications évidentes : - 1ère raison : – toutes les
tâches quotidiennes de la vie peuvent prendre beaucoup de temps, le temps que je
m’habitue à la façon locale ; et aussi parce que la façon locale demande plus
de temps. J’en dit plus dans la suite.
- 2ème raison : – apprendre une langue non occidentale comme
l’arabe demande l’énorme travail de se repérer dans des
" sons " nouveaux, inaudibles et imprononçables dans les débuts. Il
faut répéter, répéter des petits bouts de phrases pour que la mémoire auditive
accroche… – 3ème raison : Je n’ai pas d’équipes de
travail pour me booster.– 4ème raison : Si les gens savent marcher
vite dans la rue, il fait froid en ce moment, ici personne ne semble avoir d’agenda.
On ne prend pas de rendez-vous pour se voir… on passe et parfois on attend que la
personne revienne de course.. Or " se voir ", " la
rencontre " me paraît tellement ma raison d’être ici que pour
l’instant je ne compte pas mon temps. En particulier je ne pose pas de trop de
limites à un homme qui passe me rendre visite tous les jours, généralement dans la
matinée : Abd el Hafid.
Hafid (ou Hafiv – la dernière lettre arabe de son prénom est mystérieuse pour
nos oreilles françaises et ressemble tantôt à quelque chose du
" d " tantôt à quelque chose du " v " - les
puristes écrivent " Hafidh ") habite Taberdga, la petite ville
ancienne en bas au bord de l’Oued et fait parti des amis de la petite communauté
chrétienne de Chéchar. Non qu’il ait voulu un jour devenir chrétien parmi nous,
mais parce qu’il a trouvé auprès des sœurs et de Jean Marie, le prêtre qui a
vécu ici 23 ans, un soutien psychologique et fraternel. J’avoue qu’il m’a
été précieux dans les premiers jours. Il m’a guidé dans toute la ville, m’a
fait connaître 4 ou 5 personnes. Aujourd’hui, en plus de l’écouter dans ses
méditations, je lui ai proposé de faire de ses visites un temps d’échange de
savoirs : il accepte avec beaucoup de gentillesse de répondre à mes questions à
propos de l’arabe algérien (ou sur la langue berbère de la région et mille autres
détails de la vie locale au quotidien) et moi je l’initie à la langue de
Shakespeare. " Tous les jours ou presque ". Vous avez bien lu.
Cela veut dire qu’Abd el Hafid, célibataire, 30 ans environ, est sans travail. Il ne
me contredirait pas si je précisais qu’il porte en lui une souffrance
l’empêchant de s’engager avec quelqu’un d’autre pour travailler
– il l’avoue lui-même, ni à se lancer dans une initiative personnelle. Son
frère jumeau qui a moins bien réussi à l’école est sur le point de se marier et a
trouvé un travail dans une palmeraie au bord du désert à 50 km d’ici environ. La
difficulté psychologique d’Hafid peut se rencontrer partout dans le monde. Mais
coté découverte pour moi, je vois qu’il y a beaucoup de jeunes hommes de sa
génération qui sont dans son cas. Renforcés dans leur handicap par l’énorme
chômage qui sévit ici. Et par le nombre de copains qui, ne voulant pas rester à ne rien
faire, tentent leur chance dans des " petits boulots " sans grand
résultat. Le spectacle de la rue de Chéchar à toute heure de la journée me donne
l’impression, si je compare avec nos rues en France, qu’un tas de gens ne font
quasiment rien. Quand en France je me promène dans certains quartiers pendant la journée
en semaine, je suis l’un des seuls hommes au milieu de quelques femmes avec enfants
et de retraités. Ici, c’est l’inverse : il y a du monde dehors à toute
heure du jour, uniquement des hommes, jeunes et vieux, arrêtés pour discuter ou allant
et venant, comme moi. Ce sont les femmes qui sont absentent ou qui passent furtivement,
comme si c'étaient elles qui avaient un peu honte d’être là au milieu des hommes.
Ici, notez bien, les commerçants sont exclusivement des hommes ; j’attends
encore de trouver une " commerçante " ou une
" vendeuse " - A Alger, à Blida, je me souviens en avoir vu dans des
petits super marchés à l’occidental.
A propos de commerçant, Abd el Hafid m’a fait connaître un cousin éloigné,
Ismaël, qui tient un petit magasin de vente et réparation de téléphone portable,
dépannage en électronique – informatique, et réalisation de photos
d’identité ou de photos-souvenir avec une bonne imprimante numérique. Ismaël
m’a fait un très bon accueil et partageant moi-même son intérêt pour tous les
appareils électroniques, je passe régulièrement avec plaisir, le voir lui et son
associé Charaf. Ismaël avait animé il y a quelque temps un club d’électronique
dans la " maison des jeunes ", en association avec un de ses amis,
Abdalla. Ils m’ont proposé de relancer le club avec moi. Intéressé, je les ai
encouragés à pousser plus loin l’idée, et un matin, ils m’ont organisé une
visite avec le directeur, le " mudir ", de la fameuse maison des
jeunes. Belle, vaste, de bons équipements, construite par l’armée. C’est
l’effectif d’animation qui manque – pas de budget. Après cela, en
continuant d’en parler avec l’un ou l’autre, j’ai compris peu à peu
que ni Abdalla ni Ismaël ne se sentaient disponibles. Le directeur les a-t-il blessé
dans son échange avec eux sur un ton élevé, lors de la visite ? – Est-il
utile de préciser qu’à ce jour, je ne comprends de ce qui se dit entre les gens que
ce qu’on veut que je comprenne et quand on veut que je comprenne – c’est à
dire avec une bonne proportion de mots français et en découpant les phrases les unes
après les autres... Je pense plutôt qu’ils espéraient que j’allais prendre
leur relais. Pourquoi pas en effet ! Mais l’organisation aperçue lors de la
visite, et les liens de la maison avec la population m’ont paru très différents de
ce que j’ai pu connaître jusqu’ici en France, et j’attends vraiment
d’avoir plus d’expérience et en langue locale et en us et coutume d’ici
pour me lancer. Ismaël de son coté, célibataire, avec des soucis de trésorerie pour
son petit magasin-atelier, rêve de tout vendre et de rejoindre son frère à Marseille.
Il parle de partir en février. Il idéalise beaucoup la vie en France – dommage.
Mais c’est un véritable artiste, bon musicien sur clavier, et un certain talent pour
monter des petits automatismes, semble-t-il. Je serai heureux pour lui et pour le monde
entier s’il pouvait aller un temps ou une partie de sa vie à l’étranger
développer ses dons, et pourquoi pas en France.
Abdalla de son coté n’habite pas Chéchar mais une petite localité de la commune
plus loin sur la route au sud de Chéchar. Diplômé en électrotechnique et automatisme
(bac pro ou bac +2, je n’ai pas encore bien noté), il est connu à Chéchar pour
savoir dépanner les téléviseurs et autres appareils électroniques, la mairie lui ayant
fait appel pour les écoles. C’est ainsi qu’il m’a été présenté la
première fois, quand il est venu régler la télé de l’appartement à la demande
d’un ami des sœurs qui prend soin de moi. Finalement, depuis début décembre il
a été engagé comme aide gardien de la maison des jeunes et je l’ai vu infiniment
heureux d’avoir enfin un CDI. " Maintenant, je fonce. " dit-il.
Je suis passé le voir à son poste de travail déjà à deux reprises et j’ai bien
aimé nos conversations. L’autre soir, il disait :" Je veux
m’ouvrir à tous les milieux. ".
Il y a eu aussi un jeune de 20 ans environ, Nasser, qui a eu
très fort le souci que je me sente accueilli. Logeant avec sa mère et son beau-père
dans la même cité que moi, il était passé saluer Jean Marie son ancien professeur et
ancien voisin le soir de notre arrivée. Nasser ne parle pas le français seulement
quelques vagues souvenir de l’école, et je lui ai proposé de s’y remettre avec
moi, à raison d’une petite heure deux fois par semaine. Je l’ai vu faire des
progrès mais assez vite il a décroché. Manque de motivation de son coté !
Faiblesse des compétences pédagogiques du coté du professeur ! Ce qui est certain,
c’est que ce contact avec un jeune de la cité m’a aidé dans les premières
semaines à me sentir moins étranger à la vie du quartier. Je parle de cité, car tel
est son nom : " cité M’choucha Mohamed El Hadi " (le nom
d’un chaïd de la guerre d’indépendance), mais je devrais dire
" résidence " pour traduire en français de France car ici il
n’y a principalement que des propriétaires – même si tout ce qui est espace
commun a été plutôt dégradé en 20 ans – façon de vivre ici oblige, et je
ressens une ambiance très familiale et loin de la délinquance des cités de relogement
des bidonvilles à Constantine tel que je l’aperçois en lisant le journal
francophone el watan (www.elwatan.com) mais plutôt
avec le chant quotidien des enfants jouant paisiblement entre eux en bas des blocs. (ils
reprennent l’école demain). La résidence comporte 10 blocs, On en aperçoit 6 ou 7
sur la photo ci-contre prise d’une des places du centre ville. Mon bloc est caché ou
bien c’est le plus loin dans le centre de la photo. Chaque bloc a 10 appartements sur
5 niveaux. Je suis au 3°étage, c’est à dire l’avant dernier (il faut compter
le rez-de-chaussé.)
" Avec les voisins d’escalier, n’espère pas trop – m’a
dit Jean Marie - moi, je n’ai pas réussi à aller plus loin que le bonjour
– bonsoir. " Au bout de 2 mois, c’est un peu ça mais… il y a eu
mi-novembre une panne dans l’adduction d’eau de la ville et notre cité a été
privée d’eau pendant 10 jours (peut-être moins mais je n’étais pas forcément
là le dernier jour où l’eau a été distribuée). Normalement, nous avons
l’eau tous les 3 –4 jours dans la matinée, l’heure est variable autant que
le jour de la semaine et chacun fait des réserves. Les gens mieux équipés ont une
grosse citerne sur la terrasse (ou sur le toit)qui se rempli automatiquement. Jean Marie
Jehl a des " grosses bonbonnes " dans la salle de bain et les remplit
avec le tuyau souple de la douche quand l’eau arrive " Tu verras, ton
oreille va te le dire, elle va repérer le bruit des citernes des voisins qui se
remplissent " m’avait dit Jean Marie. Et c’est vrai…
aujourd’hui, j’entends… mais il y a eu cette panne vers la mi-novembre. Les
passaient et je commençais à voir le bout de mes réserves, ayant fait une petite
lessive juste après la dernière distribution. Un jour où je pensais ne plus pouvoir
tenir encore très longtemps même si j’arrêtais de faire la vaisselle etc…
voilà que j’entends des pas devant moi dans l’escalier : j’accélère
le pas pour tenter un contact au sujet de l’eau – A ce moment-là, n’ayant
encore vu personne autour de moi dans la cité aller et venir avec des bonbonnes
d’eau, je n’étais pas très sûr si ce n’était pas une panne chez moi
seul. J’arrive à la voisine de palier au moment où elle entrait chez elle. Ici,
pour une femme, j’ai cru comprendre que ce n’est pas honnête de prendre le
temps de parler avec un homme étranger à la famille. Toujours est-il que sans me
regarder, tout en me fuyant, elle a bien voulu répondre à ma question simple :
" Il n’y a pas d’eau ? " par un " Oui, il
n’y a pas d’eau " Sa porte s’est refermée avant que je
n’aie pu en savoir plus mais je suis entré chez moi content : heureux de
n’être pas seul dans le pétrin – et content d’avoir pu me faire
comprendre, même si ma phrase était archi simple …. 10mn plus tard, on frappe à ma
porte : c’est son mari qui m’apporte 1litre et demi d’eau et qui tente
de m’expliquer avec quelques mots de français qu’il s’agissait d’une
panne sur les tuyaux. Ce geste m’a profondément touché. Ils avaient souci de leur
voisin étranger et partageaient avec lui leur eau. Et si cette panne d’eau leur
avait permis de passer par-dessus leur timidité et leur mauvais français ? Comme
moi-même osant dépasser dans l’escalier tout à l’heure la gêne des femmes
ici vis à vis de moi.
Depuis j’ai senti chez eux d’autres signes fraternels : le jeune fils
adolescent a un geste de salutation très respectueux à mon égard quand on se croise. Un
jour Hafid passe me voir en apportant un pain pour me l’offrir. Ne me trouvant pas,
il le confie aux voisins. A peine étais-je entré chez moi, c’était le jeune qui
frappait à la porte pour me donner le pain. En tentant de m’expliquer d’où ce
pain venait. Je n’ai pas tout compris – les ados parlent toujours très vite -
mais il a accepté de prendre le temps très simplement pour que je comprenne
l’essentiel.
D’autres voisins s’approchent de moi quand l’occasion leur en est
donnée. L’autre matin, en achetant quelques kg de pommes de terre à une camionnette
venue vendre dans la cité, j’ai pu échanger avec un autre acheteur. Il s’est
présenté comme un ancien élève de Jean Marie, et sa curiosité à mon égard a été
sur un ton très sympathique. Je ne cite que ces quelques contacts rapides dans la cité
mais je suis vraiment heureux de la taille modeste de Chéchar – 10 000 hab. pour
l’agglomération, 25 000 pour la commune entière – qui diminue l’anonymat
et m’offre plus de contacts par simple voisinage.
Mais il faut aussi que je vous parle de ma
" communauté chrétienne ", celle avec qui je prie tous les soirs
entre 6 et 7 heures. Communauté où je prends des cours d’arabe. Où je mange le
dimanche soir. Qui me conseille dans mes premiers pas d’étranger tout neuf et veille
sur moi. Et m’invite lorsqu’elle fait une petite sortie détente, comme celle
faite le 23 décembre pour profiter du beau soleil qui était revenu après des jours plus
gris sur les crêtes au-dessus de Chéchar. Trois sœurs franciscaines missionnaires
de Marie. Moïra, Anna et Jocelyne. Respectivement maltaise, coréenne et française. [Sur
la photo ci-contre dans l’ordre Moïra, Jocelyne, moi et Anna. mais vous nous verrez
mieux sur la 3° photo de la lettre. Derrières nous, les sommets enneigés des Aurès. En
dessous, la vallée de l’Oued El Arab qui se jette dans le désert (quand il coule,
mais en ce moment il y a un peu d’eau.) L’Oued est à 1000 m au dessus du niveau
de la mer – altitude habituelle de la région des hauts plateaux. Et sur le col, nous
devons être à plus de 1700 m. Le plus haut point de la crête est noté à 1850 m.]
Jocelyne, infirmière, est depuis très longtemps en Algérie, précisément dans cette
région. D’abord à Tébessa ou dans les années 70 elle a participé à la formation
d’agents de prévention sanitaire en tant que directrice de
l’ " école paramédicale ". Puis en 83 elle est venue ici,
dans cette région plus reculée et moins riche en service de santé, à la demande des
responsables algériens : pour qu’elle puisse former des agents de prévention
comme elle l’avait fait à Tébessa. Et c’est comme cela que j’habite
Chéchar aujourd’hui. Cette proposition d’être nommée à Chechar pour Jocelyne
correspondait bien à la vocation de son institut religieux: aller à la rencontre
des moins gâtés. Le pays se couvrait d’un réseau de santé pour tous –
d’autres personnes nouvellement formées pouvaient prendre en charge les centres
déjà bien rôdés, et il fallait être aux cotés de ceux qui partaient dans les
régions plus isolées, C’était aussi le chemin choisi par toute l’Eglise
d’Algérie : en compagnon fraternel du peuple algérien se prenant en main,
vivant au milieu de ce peuple notre relation à Jésus qui nous entraîne toujours vers
les plus petits. C’est ainsi que les FMM ont décidé de fonder une communauté à
Chéchar, à peine sortie de terre. A M’sala comme les gens de la vieille ville de
Taberdga, en bas, près de l’Oued, nomme la ville nouvelle (un nom qui voudrait dire
" le plateau "), ne comportait pas encore beaucoup de maisons.
Jocelyne a commencé son travail avec l’équipe de prévention sanitaire dans un
bungalow (" on avait froid l’hiver et chaud l’été ")
tandis que Rosanna, une sœur italienne revenant de deux années d’apprentissage
de l’arabe algérien à Alger, la rejointe avec une autre sœur (restée moins
longtemps et que je ne l’ai encore jamais rencontrée) et a commencé une activité
de présence auprès des femmes et des jeunes filles de Taberdga et de Chéchar. Ces
dernières ont alors fondé ensemble une association pour se former aux travaux de couture
et se faire un peu d’argent avec leur production vendue en partie en Italie par le
réseau des sœurs. Rosanna qui vient juste de partir après 22 ans de présence
continue, a marqué énormément les habitants de la commune, grâce aussi à son
caractère très généreux et fort – ajouté au style italien. Aujourd’hui, les
sœurs habitent " chez Rosanna ". Jocelyne de son coté était repartie
plusieurs année sur Tébessa quand elle a pris sa retraite et vient juste de revenir à
Chéchar dans l’année écoulée. Aujourd’hui, Jocelyne dépanne à la demande
des familles pour des soins infirmiers et continue les amitiés nombreuses qui se sont
tissées à travers les soins, à travers l’ " association
féminine ", à travers le voisinage….
Moira, même âge que Jocelyne, est arrivée il y a quelques années à Chéchar. Son
parcours l’a fait passer par l’Italie, la Libye puis Tiaret dans l’Ouest de
l’Algérie. Elle apporte son savoir faire en couture, et son pragmatisme attentif
pour chacun, forte de sa co-naturalité avec le Maghreb. Malte est très proche du monde
arabe, et la langue parlée à Malte contient de nombreux mots arabes.
Anna, juste un an de moins que moi, vient d’arriver de Tunis où elle a fait un
peu d’arabe classique (ou arabe littéraire) à la " Bourguiba
school " après avoir vécu à Paris plusieurs année pour posséder
parfaitement le français. Nous étudions ensemble l’arabe algérien mais
j’admire cette longue préparation. L’esprit coréen aime-t-il particulièrement
que les choses soient bien organisés et précisés ? Anna s’énerve un peu
devant le caractère oral de l’arabe algérien, pas d’orthographe, beaucoup
de cas irréguliers en comparaison de l’arabe littéraire. Anna est infirmière et
espère obtenir son permis de travail, soutenue par Jocelyne qui a de longue relation dans
le secteur, sachant qu’il n’y a aucun accord entre la Corée et l’Algérie
pour les emplois dans la santé comme il en existe avec la France, mais sachant aussi
qu’à Chéchar et dans la wilaya de Khenchela, il n’y a pas d’infirmière
au chômage, il en manquerait plutôt. A suivre !
Je rejoins tous les jours ces 3 soeurs pour la prière du soir dans leur petite
chapelle. Nous célébrons l’Eucharistie, en prenant le temps assez souvent de
partager la journée, parfois l’Evangile. Et en ce moment, je suis encore 4 fois par
semaine chez elles, les samedi-dimanche et mardi-mercredi (en Algérie, on se repose le
jeudi et le vendredi) dans l’après-midi en cours d’arabe dialectal, en
compagnie d’Anna sous l’instruction de Nadia, 27 ans et fiancée, la fille
d’une famille qui est devenue très amie avec les sœurs au fil du temps.
Si je vous disais que l’horaire du cours a été calculé pour permettre à Nadia
de partir avant la tombé de la nuit : car il n’est pas honnête ici pour une
femme de marcher seule dans la rue quand la nuit est tombée. Mais cette société a
connu, si j’ai bien compris, un enfermement des femmes en ville bien plus grand.
Une autre portion de ma communauté chrétienne est à Tébessa : Egalement des
Franciscaines missionnaires de Marie, la communauté des sœurs de Tébessa est en
pleine reconstruction – deux sœurs infirmières sont parties, après un refus de
renouvellement de leur permis de travail (*), ce qui a fait perdre à la communauté sa
dernière implication professionnelle. Avec avoir vécu il y a 2 ans la mort du prêtre
qui résidaient dans la ville depuis très longtemps aussi, Claude,, c’est une page
qui se tourne pour l’église locale de cette grande ville de plus de 120 000
habitants. La voilà devenue petite, petite, avec 3 sœurs actuellement :
Térésa, coréenne, Thavar, sri lankaise et Carmela, italienne. Habitant le vieux
presbytère dans la vieille ville, derrière les fortifications datant de l’empire
byzantin, elles ont beaucoup de contacts, soutenant d’un coté des familles pauvres
ou rejoignant une association d’enfants handicapés, et de l’autre offrant des
activités de soutien scolaire (français et anglais) et d’enseignement musical à
des enfants, certains de familles plus aisées. A Noël, nous étions tous rassemblés là
et pour la messe du jour, 3 " franco-algériens " nous ont rejoint.
(*) Il existe en Algérie – mais aussi en Tunisie un règlement instituant la
préférence nationale qui limite ainsi le travail des étrangers et qui s’applique
à moi entre autre. L’objectif a été d’Algérianiser les cadres – et
également de lutter contre le chômage. A noter que pour les professionnels français de
la santé, il y a des accords qui leur permettent de travailler en Algérie – sans
doute en lien avec les facilités des Algériens médecins pour travailler en France dans
les hôpitaux sans trop coûter à la Sécu.
Le 3° morceau de ma communauté est à Bir el Ater, à 90 km environ au sud de
Tébessa – Roseline qui vient de fêter ses 50 ans de vie religieuse cette année,
habite là avec Geneviève-Noëlle jeune retraitée et Odile-Claude, 3 " petites
sœurs de Jésus ", des religieuses de la famille spirituelle de Charles de
Foucauld. Nous avons en Val d’Oise une petite communauté à Villiers-le-Bel qui va
vers les gens du voyage. A Bir, certaines ont vécu en plein désert avec les nomades et
aujourd’hui, les voilà en ville, dans une agglomération de 60 000 habitants, qui a
poussé plus vite que Chéchar grâce à la mine toute proche. Et qui s’est enrichi
beaucoup, dit-on, pendant les années noires en profitant des difficultés pour
l’administration algérienne menacée par le terrorisme de surveiller la frontière
tunisienne toute proche. Les sœurs donnent quelques soins infirmiers et visitent plus
gratuitement des femmes, en particulier des épouses de fonctionnaires déplacés. Ces
dernières se trouvent très isolées loin de leur propre famille dans une société où
on ne sort pas de la famille. Les soeurs reconnaissent qu’ici en ville, elles
n’ont plus la complicité qu’elles pouvaient partager avec les familles nomades,
se faisant nomades avec elles. " Les gens vivent tellement en famille entre eux,
ils donnent vraiment l’impression de se suffirent à eux-même et de n’avoir pas
besoin de quelqu’un extérieur à leur famille - me confiait l’une
d’elles- et en même temps, le jour où je suis tombé malade, j’ai été
entourée de beaucoup de signes d’attentions par mes voisines, faisant tout pour
m’aider à me rétablir. " Charité musulmane ? Grande attention au
" voisin " chez les gens du sud ? Importance de ce que
représentent les sœurs pour ses femmes qui ne sont elles-mêmes jamais sorties de
leur famille ? Les trois sans doute ! Mais ces différents moteurs
d’entraide mutuelle – avoir souci du voisin malade - être porteur de la
promesse d’une vie plus choisie – ont à mes yeux une dimension
" sacramentelle ".
J’ai rejoins les communautés de Tébessa et Bir par les
transports en commun par deux fois déjà. Pour partager, prier, célébrer
l’Eucharistie. En théorie, je suis supposé le faire plusieurs fois par mois. Ce qui
n’est pas trop difficile en soi: ce pays a de très belle route et les
transports tels que bus et taxis collectifs sont nombreux et peu onéreux. Dans les faits,
Novembre et Décembre nous ont offert plusieurs occasions de nous retrouver les 3
communautés ensemble, rendant inutile une visite supplémentaire de ma part : –
la rencontre trimestrielle de secteur à Tébessa à la mi-novembre, la fête du
Bienheureux frère Charles de Foucauld le 1er décembre et nous étions alors
tous à Bir sauf 2 absentes– (cf. la photo). Et Noël de nouveau à Tébessa. Enfin
une 4°occasion a été la récollection à Constantine les 8 et 9 décembre pour tous
ceux du diocèse qui le pouvaient. J’y suis allé avec Moira, Jocelyne étant en
" conseil " à Tunis, et Anna accueillant des amies infirmières
coréennes. Cette rencontre m’a permis d’apercevoir enfin presque tous les
prêtres et les religieuses du diocèse, de revoir ceux que je connaissais déjà et de me
présenter aux autres. Au 1er de l’an, c’est la communauté de
Tébessa qui est venue à Chéchar et un jésuite de Constantine est allé à Bir,
emmenant avec lui un stagiaire jésuite syrien. L’occasion pour lui de découvrir
l’Algérie plus en profondeur. De fait, pour Tébessa et Bir, des prêtres de
Constantine font aussi le voyage en prenant leur tour avec moi ; ils apprécient
cette sortie et les sœurs apprécient de ne pas avoir toujours le même prêtre.
Cette année, 2 des jésuites (ils sont 4 en ce moment) et les 3 prêtres diocésains de
Constantine semblent disponibles pour ces visites pastorales de temps en temps.
L’évêque pense que je ne pourrai ne faire le tour que 2 fois par mois. Et tous,
prêtres et sœurs, aiment me rappeler que s’il y a une période de chute
importante de neige en janvier ou février, il faudra attendre qu’elle fonde. Ce
n’est pas encore arrivé (" Mazel ", comme on dit ici).
J’évoquais le temps que me prennent les gestes de la vie quotidienne, comme je
n’avais jamais connu auparavant. Sur le fond, je suis vraiment heureux de faire cette
découverte – loin des grandes villes où l’on peut quasiment vivre avec les
standards américains/occidentaux, telles qu’Alger, Constantine ou Annaba. Je veux
dire qu’à Chéchar je partage davantage les conditions de la vie quotidienne très
simple de l’immense majorité des hommes qui vivent avec moi en ce moment sur cette
terre. C’est ce que je souhaitais beaucoup : sortir un moment de notre bulle
occidentale, pour me faire plus proche de tous les hommes. Un reste de l’enseignement
républicain dans nos livres d’histoire fustigeant la période féodale très
inégalitaire comme la nôtre aujourd’hui ? La parabole du riche et du pauvre
Lazare ? Oui, pourquoi ai-je toujours rêvé de me faire proche de chaque homme, à
commencer par les moins chanceux ? Je ne peux pas expliquer et si je ne retrouvais
pas un peu la même choses chez des amis et des chrétiens, je me croirai névrosé.
Mais cette proximité, ce partage des conditions de vie des humbles de la terre, est-il
réelle à Chéchar ? Jusqu’où me suis-je fait proche ?
Par pour la taille de mon habitation en tout cas ! Car s’il était bien moins
onéreux de me loger dans l’appartement de Jean Marie que de louer un logement à
Tébessa, ville plus grande et plus au centre de mon secteur, je me trouve sans doute
être le plus largement logé de toute la commune : un F3 rien que pour une seule
personne ! (Avis à ceux qui envisagerai un voyage par Chéchar.) Sauf erreur de ma
part, ce ne doit pas être le cas de beaucoup car je vois tout le monde ici vivre en
famille et je ne vois pas de grand palais. Et chacun sait que la crise du logement est une
réalité en Algérie, ployant sous le nombre des mal-logés qui s’entassent chez un
parent en attendant mieux.
Si à Chéchar je deviens plus proche des humbles de la terre, c’est que notre
petite ville est loin des grands axes et ne bénéficie pas des équipements de confort
des grandes agglomérations. Et la population majoritairement rurale entraîne tout le
monde dans un style de vie très simple: familles nombreuses, vie rude au contact avec la
nature, habillement sans fioriture, des gens vivant avec peu d’argent et se
contentant de peu.
Ainsi pour me nourrir : A Chéchar, aujourd’hui, je n’ai aucune crainte
de mourir de faim ! Les commerçants ne manquent pas de marchandise et ils sont
nombreux. Mais le style d’ici prend beaucoup plus de temps, avec un choix bien plus
limité. A moi d’oublier vite l’organisation de bon célibataire que je
m’étais construite peu à peu en France. Car ici, pas de chaîne du froid (de
surgelés) et pas de supérette, encore moins de super marché mais une légion
d’épiceries, toutes de petites tailles, de la taille d’un garage pour voiture,
avec une 50aine de denrées différentes, plus
ou moins selon le magasin et le propriétaire. Ici, on ne remplit pas un caddie mais on
demande la boite de sardine, le morceau de savon ou le litre de lait dont on a besoin pour
aujourd’hui et on revient le lendemain. Ce que j’apprécie, d’un autre
coté, c’est la gentillesse de beaucoup d’entre eux et l’unicité du prix.
Pas de souci à devoir marchander. Le prix d’un article standardisé m’est
apparu être le même dans toutes les boutiques. J’ai pu vérifier à chaque fois
qu’aucun ne cherchait à profiter de moi et qu’au contraire ils étaient de bon
conseil. Autour de chez moi, j’ai maintenant appris à connaître 2 commerçants
parmi d’autres. Le plus proche est un homme très âgé. Hafid l’a toujours
connu depuis sa petite enfance, alors qu’il habitait encore Tabergda. Son magasin
fait un peu " débarras " et il a peu d’articles. Souvent
d’autres " shikh " sont avec lui, pour passer le temps,
d’autant que son magasin est bien exposé, plein sud. Sa rue, très résidentielle,
est pleine d’enfants qui n’arrêtent pas de venir lui acheter des bonbons.
L’autre est un homme encore jeune, au visage très sympathique : il parle assez
bien le français, chose rare ici, il a fait des études d’ingénieur agronome mais
" pas de poste " ce sont ses paroles. Il est heureux de parler en
français avec moi et j’apprécie sa conversation. En ce moment, je crois que nous
nous testons mutuellement. J’espère pouvoir avancer patiemment avec lui dans
l’échange.
Pour les fruits et légumes, le mieux est d’aller sur l’un des deux petits
marchés permanents où se trouvent les produits de saisons. L’un au bord de ma
cité, l’autre à 500m le long de la route de Tabergda. Il y a aussi le grand marché
hebdomadaire le mercredi matin, où c’est toute une partie des gens des fermes
alentours qui viennent. Les produits locaux sont très bon marché, et ont la mine très
écolo : tout est à faire, laver la terre, éplucher. Et souvent en grosse
quantité, surtout sur le marché hebdomadaire. Et je redécouvre les saisons. Les tomates
ont quasiment disparu. Les mandarines et les oranges qui doivent venir de la bande
côtière ou de Tunisie ne sont pas très chères en ce moment. Ce matin, j’ai cru
qu’il n’y avait plus que des dates et des oranges à vendre, à coté des
moutons (l’Aïd el Kebir s’approche, il est prévu ici entre le 10 et le 13
janvier). Les pommes du cru, sorte de petites goldens très juteuses, ont grimpé de prix
depuis mon arrivée et puis ont disparu : j’aurai du en acheter un gros stock
dès le 1er novembre pour aller jusqu’en janvier-février. Il ne reste
plus que des pommes bien calibrées, sans tâche et sans défaut, qu’on pourrait
croire provenir tout aussi bien du Chili ou de France que de l’Algérie, mais elles
sont très chères en comparaison.
Cette façon de faire ses courses semble davantage faite pour une maisonnée avec un ou
plusieurs adultes à demeure (je crois pouvoir dire que ce sont des femmes) qui ne font
que ça – épluchage et préparation culinaire – c’est le cas tout autour
de moi dans la cité semble-t-il. Comme je vous le disais, je croise rarement des femmes
en faisant mes courses. Les grosses courses sont faites par les hommes – les kilos de
fruits et de légumes, et les petites courses – la boite de sauce tomate, les 2 pains
et les 3 yaourts – sont faites par les enfants.
Ainsi pour se chauffer : C’est connu, l’hiver sur les hauts plateaux, il
fait froid avec régulièrement du gel et parfois de la neige. Et l’appartement de
Jean Marie construit il y a moins de 30 ans, n’est pas une antiquité. Pour autant
vous n’y trouverez aucun système de chauffage centralisé mais un simple trou
de cheminé dans le couloir pour y installer un poêle.. Et pas d’approvisionnement
en gaz naturel par conduite à Chéchar comme dans les grandes villes. Pour se chauffer,
il faut choisir entre les bouteilles de gaz, les bidons de mazout ou l’électricité
plus chère. Jean Marie a opté pour une association des deux derniers avec un poêle à
mazout dans le couloir et 2 radiateurs électriques en complément selon le besoin.
N’imaginez pas non plus du double vitrage. Encore que les volets en bois sont assez
sympathique et doivent isoler la nuit. C’est vrai que le jour, dès qu’il y a du
soleil, la température remonte au alentour de 10°. Pour ces semaines d’hiver,
après avoir un peu grelotté, je me suis mieux organisé et j’obtiens une
température confortable dans la pièce où je vis. Mais je vois bien que je fais encore
partie des riches pouvant installer un poêle et payer la facture de mazout et
d’électricité. Jocelyne nous disait sa peine de voir dans ses visites de malade
combien les veilles personnes souffrent quand il n’y a pas de chauffage dans la
maison.
Ainsi pour l’eau : Le sud de la méditerranée est connu pour recevoir moins
d’eau de pluies. Ici, le maître mot est " économie ". Toilette,
vaisselle, lessive, wc, j’apprends à tout faire en économisant l’eau qui peut
se faire plus rare dans les jours à venir. J’attends un jour
d’approvisionnement pour me lancer dans une lessive, mais encore faut-il que je sois
là quand elle arrive. L’eau est un souci très quotidien pour beaucoup ici, parmi
les moins bien lotis. Ainsi Nadia habite avec ses frères et sœurs non encore mariés
une maison sans eau – elle la prend chez les voisins. L’autre jour, en mangeant
la galette qu’elle m’avait offerte, je voyais bien que le tissu qui
l’enveloppait n’avait pas été rincé deux fois car il sentait très fort la
lessive. Je comprends mieux comment c’est un vrai souci de femmes à travers le
monde. J’apprends à me laver comme à faire la vaisselle avec moins d’eau. Me
reviennent les souvenirs de ma petite enfance à la campagne – l’eau courante a
été installée quand j’avais 6 ans chez mes parents – et la façon dont ma
mère procédait. Vous connaissez la bonne façon de faire ? Je me risque à vous
faire un résumé : Pour se laver les mains quand elles sont bien sales, pas question
d’ouvrir le robinet et de se laver tranquillement sous le flot qui s’écoule
– parce qu’il n’y a pas d’eau au robinet si vous n’avez pas de
citerne sur le toit, et parce que de toute façon ça en consommerait beaucoup. Prendre
une cuvette, verser de l’eau, s’y savonner et puis rincer au maximum le savon de
vos mains toujours dans la même eau de lavage. Alors seulement faire couler un peu
d’eau propre (avec un petit godet prévu à cet effet) pour finir de rincer. Ce
n’est pas fini : il ne faudrait pas jeter inconsidérément l’eau dans la
cuvette, on peut la stocker dans un récipient pour un usage moins exigeant, par exemple
les toilettes. " Et pour la lessive, comment fais-tu ? "
allez-vous me dire. Et oui, ici pas de " lavomatic " comme ceux que
j’ai pratiqué souvent jusqu’ici en bon célibataire. Et j’y croisais là
beaucoup de gens humbles, des migrants et des gens du voyage. Non, mais Jean Marie
m’a laissé sa petite " calor ", une sorte de bassine en
plastique avec un moteur dessus qui fait tourner l’eau et le linge. Ca demande
beaucoup plus de manipulation - fabriquer soi-même la température de lavage, vidanger,
etc… Mais sinon, c’est simple et assez efficace. Avec la proposition des
sœurs pour les draps, car elles ont en association avec Jean Marie une machine à
laver reliée à leur citerne sur le toit et de grosses cuves en plastique pour stocker
l’eau de rinçage (pas de gaspillage). Mes amis de France, ne souriez pas, il est
bien possible que ces gestes tout simples soient aussi les nôtres dans 20 ans, même si
quelques astuces techniques nous éviteront sans doute un aussi grand nombre de
manipulations.
En arrivant, j’ai eu des velléités de bricolage dans l’appartement de Jean
Marie : j’aime bricoler, j’ai tenu à glisser ma perceuse dans les bagages.
Il s’agissait dans le premier coup d’œil que j’ai eu sur
l’appartement de remettre à niveau des éléments d’origine, histoire
d’entretenir ce logement que Jean Marie me prête et l’aider à le rénover.
Cette idée me semble aujourd’hui une idée de riche et j’ai cessé tout rêve
sur le sujet en découvrant les magasins de bricolages. Ici, pas de M. Bricolage ou autre
Castorama mais comme les épiceries, on y achète ce qu’il y a – et il n’y
a pas beaucoup, ni en qualité ni en quantité. Presque tout vient de Chine, à bas prix
pour un budget d’européen mais pas tant que ça pour nos petits budgets d’ici.
Le seul avantage parfois, on achète tout à la pièce – la vis, le foret, etc…
- là encore les pauvres sur cette terre gaspillent certainement moins que nous.
Bien des choses encore me surprennent, m’étonnent ou m’enchantent. En
sachant que la contradiction est le propre de l’homme et des sociétés
humaines et le recul de l’étranger est lié à son ignorance, je
m’arrêterai là dans mes découvertes.
Je m’interroge plus sérieusement sur mon avenir pour les 3 ou 6 ans que
j’espère pouvoir vivre ici : (si tout se passe bien du coté de la demande de
carte de résident, mais pour l’instant, il n’y a pas de raison pour que cela ne
soit pas le cas.):
1er défi : Apprendre à être prêtre en Algérie… je ne vous
fais pas d’autre commentaire, je suis loin d’avoir tout compris encore de ce que
peut être le ministère presbytéral ici. Je compte entre autre sur les prêtres du Prado
pour m’y aider – Louis et Gaby dans le diocèse et Gilles et Jean à Alger. Nous
nous connaissons déjà un peu et devrions nous réunir à la fin de ce mois.
2ème défi : Agir avec d’autres dans Chéchar ou dans mon
secteur. Comment ? En rendant service ? Oui sans doute un bénévolat, car je ne
peux pas espérer un permis de travail. Quel service rendre ? L’anglais ?
– L’informatique ? Tout autre chose ? Tout va dépendre aussi, je
crois des liens qui vont se créer entre moi et des Chéchari.
J’aimerai pouvoir offrir un service bénévole dans une structure. Pourquoi pas
avec la maison des jeunes ?
J’espère ressortir avec des idées plus claires sur le sujet après la session
" nouveaux arrivants " que l’Eglise d’Algérie organise
début février sur 4 jour.
S’il fallait conclure : Commencement !
" Tu as l’air très serein ", m’écrit une amie,
sous-entendu peut-être " Ne nous cacherais-tu pas les difficultés de ta
nouvelle situation ? " Pour être honnête, j’ai connu le stress des
premiers jours et j’en ai bavé parfois ; mais c’était incontournable
alors que j’arrivai sur un terrain totalement inconnu et avec peu de certitudes sur
mon avenir. Mais l’élan qui m’a poussé patiemment à rejoindre l’Eglise
d’Algérie et me faire proche des Algériens me porte toujours et j’y trouve une
grande cohérence avec ce que j’ai cherché à vivre dans la foi avec vous depuis de
nombreuses années. J’ai l’impression d’être sur un chemin juste et qui
prépare aussi l’avenir de notre société française. Je me sens soutenu fortement
par la communauté des sœurs qui veillent sur moi – elles m’ont gâté pour
mon anniversaire, et par de nombreux amis que les sœurs ont pu se faire durant leurs
23 ans de présence ici. Soutenu aussi par ma responsabilité du secteur et de la visite
des 2 autres communautés. Soutenu enfin par une vie de prière et aussi par une équipe
fraternelle avec 3 autres prêtres du Prado qui comme moi sont partis comme Fidei Donum
cette année, mais en Amérique latine : Paraguay, Colombie et Brésil. Nous
correspondons par mail et je ne vous explique pas la différence de contexte entre moi et
eux… Deux régions du monde si différentes, mais c’est la même épreuve
d’être étranger, la tentation de juger les façons de faire nouvelles, la
nécessité de la patience du cœur pour se laisser éveiller pas à pas à la
philosophie de vie des gens que nous rejoignons. Et c’est toujours la confrontation
douloureuse à toutes les formes de souffrances vécues par des gens. C’est toujours
la prière du disciple du Christ devant la dureté de cœur sur le plan du
partage ; mais aussi devant dureté de cœur sur le plan spirituel quand il y a
refus de renouveler son regard, en particulier au sein des cultures populaires. Et
c’est toujours le même émerveillement devant des témoins de Dieu. Bruno citant
dans sa paroisse au Brésil la foi d’un papa de deux enfants autistes. Jacques en
Colombie côtoyant des jeunes adultes qui avec l’aide de la Caritas montent des
petits projets artisanaux pour sortir de la misère. La société algérienne est plus
pudique mais je sais que je vais rencontrer ici aussi ces témoins de Dieu, ces hommes et
ces femmes au grand cœur, habités par un mystérieux élan tourné vers
l’Avenir.
Je nous souhaite pour cette nouvelle année d’êtres habités de cet élan
mystérieux qui parle le mieux de l’origine de la vie et de notre destinée humaine,
que l’on soit habitant du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest.
A bientôt. Amitié et prière. Henri
Le meurtre de la réalité
Philosophe, sociologue, mais surtout inclassable, Jean Baudrillard,
auteur du Crime parfait observe avec gravité le basculement dans la virtualité de la
société. Etat d’un monde moderne en pleine décomposition.
A bientôt 77 ans, il va toujours le nez au vent, flairant le monde, levant des lièvres,
tel un chien de chasse qui n’obéirait qu’à ses propres injonctions. Jean
Baudrillard détecte ce qui est à l’œuvre dans nos sociétés, ce qui prend
sens en notre monde, comme on filme l’éclosion d’une fleur en accéléré :
vertigineusement. Il est « envoûté par le problème de la faible réalité de la
réalité, à notre époque de plus en plus dominée par la technique, le médiatique, les
développements du virtuel et du numérique », selon Edgar Morin (1).
Pas question d’attendre du prémâché rassurant. Baudrillard pense avec le chaos
contre le cocon. Et il a toujours mis les pieds dans le plat tout en restant à la marge.
Les universités américaines l’accueillirent tandis que le système français lui
fut longtemps fermé. Germaniste de formation mais sans agrégation en poche, dans le
sillage de Roland Barthes mais évoluant entre la sociologie et la philosophie,
inclassable – il verse également dans la pataphysique et pratique la photographie
avec ferveur –, « Jean-Baud » exaspère autant qu’il fascine. Il s’est
ainsi mis la gauche officielle à dos en déclarant que le PS au pouvoir ne fut que « la
délivrance d’un enfant caché que le capital aurait fait dans le dos à la société
française ».
Ce style inimitable, tout de provocations poétiques, de lucidité opaque et
d’éclairs complexes, en fait une sorte de pythie postmoderne. Voici comment il
entame l’un de ses essais les plus stimulants, Le Crime parfait (éd. Galilée, 1995)
: « Ceci est l’histoire d’un crime – du meurtre de la réalité. Et de
l’extermination d’une illusion – l’illusion vitale, l’illusion
radicale du monde. Le réel ne disparaît pas dans l’illusion, c’est
l’illusion qui disparaît dans la réalité intégrale. »
Dans l’excellent Cahier de l’Herne qui lui fut consacré l’an dernier (1),
le penseur est décrit comme un soldeur jubilant de voir tout disparaître. Il y a
davantage de gravité attentive chez Baudrillard, observateur de notre époque, cruelle,
mutante, darwiniste. Il la pèse et la soupèse, à la recherche de ce qui résiste et
survit.
Télérama : Puisque nous sommes en janvier, que signifie encore, en 2006, de présenter
ses vœux ?
Jean Baudrillard : C’est à première vue un rituel symbolique télécommandé
collectivement, qui s’insère dans une gratuité marginale, comme les journaux mis à
disposition des voyageurs, ou les cadeaux d’entreprise. Moi qui suis parti de
l’échange symbolique tel que le décrivait le sociologue et anthropologue Marcel
Mauss dans son Essai sur le don (1923-1924), je pourrais discerner un vestige de tout cela
dans la carte de vœux. Celle-ci pourrait faire partie des sédiments sociaux de tous
ces rituels porteurs de relations, qui avaient leur force et leur puissance. Mais en fait
les vœux relèvent plutôt de ce prétendu lien social que nous tentons
désespérément de recréer à travers des signes désintensifiés, des rituels
déritualisés. Nous échangeons désormais des signes vides, malgré la petite couleur
cérémoniale et la petite tonalité somptuaire de ces cartes, qui ne viennent cependant
sceller aucun pacte. Quand les signes passent ainsi dans une existence seconde, au-delà
de leur propre finalité, leur existence peut devenir interminable…
Télérama : A quoi pensez-vous ?
Jean Baudrillard : Je pense aux commémorations, aux fêtes qui ne rythment plus une
véritable vie collective, et ne font qu’évoquer la nostalgie du « lien social ».
Je pense à toutes les pratiques politiques, et même au système électoral : c’est
une survivance maintenue à bout de bras, mais ce n’est plus un système vivant de
représentation. Le mécanisme fonctionne encore, comme chez tant de sépulcres
vivants…
Télérama : Ne sommes-nous pas déjà au cœur de votre pensée, née des saturations
et des désagrégations propres au monde moderne ?
Jean Baudrillard : J’ai effectivement commencé par me pencher sur la « consommation
» comme phénomène global. Pas seulement les produits d’usage mais la mutation
mentale relevant d’actes obligatoires et compulsifs : au-delà du règne de la
nécessité, nous voilà dans une mécanique fonctionnant toute seule. Nous en sommes les
vecteurs et les otages. Nous ne sommes plus acteurs ou producteurs mais consommateurs.
Plus de besoin ni de désir : ce que produit l’appareil de production doit être
consommé. La relation sociale devient donc subordonnée à cette circulation obligée.
Voilà pourquoi je préfère désormais l’expression d’« échange généralisé
» à celle de « consommation », qui se rapporte trop à une valeur d’usage
dépassée. Nous sommes dans la valeur-signe : nous consommons des signes, en pilotage
automatique.
Télérama : Du coup, pour vous citer, « on ne sait plus quoi faire du monde réel. On ne
voit plus du tout la nécessité de ce résidu, devenu encombrant »…
Jean Baudrillard : Ce qui disparaît, c’est le principe de réalité. A partir du
moment où le réel ne peut plus renvoyer à une raison, à une rationalité, à une
référence, à une continuité dans le temps, à une histoire ; à partir du moment où
l’on ne peut plus se référer à une instance autre – transcendante ou divine
–, on ne sait plus quoi faire de la réalité brute dans sa matérialité. La
réalité a besoin d’une caution pour exister.
Prenons le corps, l’une des réalités premières dont nous disposons : nous nous en
occupons de plus en plus à travers la santé ou les loisirs. Il nous obsède, mais nous
ne savons plus qu’en faire. Du temps où il y avait une âme, nous vivions une
confrontation mentale entre les deux. Le corps n’est plus cette substance symbolique,
il est l’instrument banal de nos transhumances quotidiennes, quand il n’est pas
cloué face à un écran.
Photo prise par Jean Baudrillard : « Photographier n’est pas prendre le monde pour
objet, mais le faire devenir objet. » (Dans Car l’illusion ne s’oppose pas à
la réalité, 1998)
Télérama : Vous écrivez : « Contrairement à ce qui en est dit (le réel est ce qui
résiste, ce sur quoi butent toutes les hypothèses), la réalité n’est pas très
solide et semble plutôt disposée à se replier en désordre. »
Jean Baudrillard : L’anthropologue Marc Auger affirme de son côté que la réalité
n’a plus d’autre raison d’être que de se répéter ou de se détruire.
Elle ne débouche sur rien qui la dépasse dans un autre monde, donc elle est obligée de
se démultiplier, de se dupliquer, de se cloner elle-même, à l’image du corps ou
des idées. A partir du moment où il n’y a plus un objectif, une finalité, une
transcendance encore une fois, les choses sont livrées à elles-mêmes,
c’est-à-dire au destin de se reproduire indéfiniment. A ce moment-là, elles
n’ont plus de fin, aux deux sens du terme, c’est-à-dire qu’elles
n’ont plus aucune finalité mais dans le même temps se révèlent interminables,
définitivement lancées sur une orbite vide.
Cela dit, on peut aussi émettre l’hypothèse que le monde, dans sa matérialité,
est une illusion, au bon sens du terme : quelque chose que nous produisons mentalement,
quelque chose dont la preuve ne peut être faite. Nous ne pouvons plus faire équivaloir
ce dont nous disposons à une vérité définitive, donc à une réalité. Voilà la mise
en jeu donc l’illusion perpétuelle du réel. On peut hurler à la métaphysique,
mais aujourd’hui toutes les productions cinématographiques et romanesques tournent
autour de cette obsession collective : sommes-nous dans un monde réel ? Tout
n’est-il pas en train de basculer dans du virtuel ?
Télérama : Alors faut-il « sauver la réalité », comme vous l’écrivez dans Le
Crime parfait ?
Jean Baudrillard : Ce n’est pas moi qui l’édicte : je parle là d’une
obsession collective. On invente des techniques de plus en plus « irréalisantes » et
dans le même temps on essaie de trouver de plus en plus de gravité, de pesanteur, de
raison d’être. Contre la disparition, la ventilation dans le virtuel, on cherche à
revenir au point où il y avait encore du réel.
Contre la nouvelle donne mondiale d’échange généralisé, peut-être faudrait-il en
revenir à un principe de réalité. J’en arrive ainsi, paradoxalement, à souhaiter
la réhabilitation du capital contre quelque chose de pire que le capital. Toute la
pensée critique s’est exercée contre le capital, contre l’idéologie de la
marchandise. Aujourd’hui, cette pensée ne peut plus rien faire contre le nouvel
ordre mondial. L’ordre capitaliste constituait peut-être un ultime rempart contre
cette ultradéréalisation qui nous attend partout…
Télérama : Il y a bientôt un quart de siècle, dans La Gauche divine, vous évoquiez un
autre sauvetage, celui du Parti communiste…
Jean Baudrillard : On a effectivement sauvé le PCF. Il fait partie de ces fantômes aux
existences interminables dont nous parlions. Il est là, tel un petit contrepoids, jadis
combattu mais aujourd’hui conservé, comme une espèce menacée. Idem vis-à-vis du
salariat : contre une politique de l’emploi diffractée, je comprends que les
salariés défendent le salariat, malgré le paradoxe de leur démarche, qui consiste donc
à défendre aussi le capital. C’est garantir un ordre, avec ses rapports de force,
sa réalité et son lien social. Tout fonctionne actuellement ainsi, en enfilade : on
sauve les meubles, parmi lesquels le PS. La désuétude est contagieuse, tous les partis
sont en état de survie artificielle. Ils ne vivent plus que des signes de leur existence
et tentent de faire perdurer une société bancale, qui ne sait plus où elle va ni sur
quoi elle roule. Nous sommes dans une architecture de décombres. Voilà ce que nous ne
pouvons qu’éprouver, si nous ne sommes pas trop en état d’autodéfense
idéologique…
Télérama : Nous ne serions plus que dans la décomposition et le fantomatique ?
Jean Baudrillard : Avec le fantasmatique, il y avait encore du conflit et du
remue-ménage. Avec le fantomatique, nous avons perdu notre ombre, nous sommes devenus
transparents, nous évoluons dans un monde d’ectoplasmes. Nous vivons les choses sans
épaisseur, sans gravité. Une gravitation a disparu au profit d’une diffraction
totale, que beaucoup analysent comme un progrès : vous êtes là, dans votre élément,
avec une irradiation totale et mondiale à travers toutes les technologies du
virtuel… Je considère pour ma part qu’un cœur des choses est perdu.
C’est au prix de cette perte de densité que vous pouvez vous mondialiser et avoir
une information totale sur tout. C’est un peu comme si vous étiez passés de
l’autre côté du Styx, le fleuve de l’Enfer : vous avez affaire à des gens qui
courent après leur ombre perdue…
Télérama : La gravitation a disparu, d’où l’importance, à vos yeux, du 11
septembre 2001, qui fait retrouver la gravitation avec les tours jumelles qui
s’écroulent ?
Jean Baudrillard : Bien entendu, il y eut là précipitation, au sens littéral.
J’avais vu, au début des années 70, se construire ces deux tours, qui ne
demandaient qu’à s’effondrer pour qu’il y eût au moins dans ce vide ainsi
créé un suspens à cette évolution irrésistible et fatale ; c’est ainsi, du
moins, qu’on peut le voir à travers ce qui nous reste d’imagination
vitale…
Télérama : L’attentat du 11 Septembre s’inscrivait dans le triangle :
violence-réel-symbolique…
Jean Baudrillard : Oui, dans la mesure où le symbolique est pour moi cette zone dans
laquelle joue une réversibilité violente – comme le symbolique fut toujours une
relation duelle, illustrée par le don et le contre-don. Nous sommes dans le même schéma
: plus le building s’élevait, plus il incarnait la virtualité toute-puissante, plus
on rêvait donc qu’il s’effondre, par cet obscur désir de réversibilité que
tant de personnes partagent, sans être pour autant terroristes. A cela s’ajoute sans
doute une logique interne, fondée sur l’apparition puis la disparition, qui gouverne
l’espèce humaine et à laquelle nul n’échappe. On peut donc combattre les
vecteurs que furent les terroristes, mais on ne peut combattre la logique qui fit
d’eux le bras à travers lequel est passé cet « acting out » mondial, cet
événement symbolique venu de nulle part.
On ne peut retrouver du symbolique qu’au prix d’une dénégation violente de
tout ce qui s’est institué sur les débris de la symbolisation. Cette dénégation
m’apparaît primordiale. En ce sens, je suis dénégationniste – et non pas
négationniste. De même que je suis un désillusionniste et non un illusionniste ; un
apostat et non un imposteur ; un abréactionnaire [l’abréaction est en psychanalyse
la libération d’un refoulement, NDLR] et non un réactionnaire.
Télérama : On vous sent dans une espèce de pas de deux face à la marche du monde…
Jean Baudrillard : Rien n’est pour moi unidirectionnel ni unilatéral. Rien ne va
jamais dans un seul sens, tout est ambivalent. Quand un système se développe, se
perfectionne, voire se sature, quand il ne semble aller que dans sa direction positive, on
ne tient plus compte de son ambivalence, de sa part maudite. Or celle-ci grandit, comme
dans la théorie du chaos, comme l’eau qui s’accélère à l’approche de la
cascade. A un moment donné, cette part d’ambivalence prend le dessus, tandis que
l’autre part se décompose d’elle-même. C’est ce qui est arrivé au
communisme, qui a sécrété sa propre ambivalence et qui, avec la chute du mur de Berlin,
est arrivé au bout de sa décomposition, sans coup férir.
Télérama : Dans un tel monde, où la décomposition est selon vous le maître mot,
peut-on encore être requis ? Peut-on encore exercer son intelligence critique ?
Jean Baudrillard : Je livre une vue cavalière de l’évolution d’un système
– le nôtre –, mais j’ai toujours pensé qu’une énergie inverse
s’y nichait, celle qui est à la source de l’ambivalence et que chacun peut
exploiter. Rien à voir avec la conscience, le bon sens, ou la moralité : nous disposons
tous d’une force d’ambivalence supérieure à la pensée critique, absolument
catastrophique, c’est-à-dire capable de faire changer les formes établies. Une
telle énergie peut se localiser dans la pensée, qui fera brèche dans l’ordre ou le
désordre des choses, pour accélérer le mouvement. Je ne vois pas d’autre
possibilité pour une pensée critique devenue radicale. Voilà l’ultime espoir : la
pensée fait partie, sans privilège aucun, de ce monde dans son autodissolution, dans son
évolution irrésistible vers sa propre disparition. Notre privilège, c’est
l’intuition de ce que sera peut-être la stratégie fatale de tout un système…
La pensée radicale se doit d’être en complicité secrète avec ce qui arrive de
meilleur ou de pire. Elle est différente d’une pensée critique, qui entend
forcément freiner une telle évolution, sur l’air de « on va dans le mur ! ». La
pensée critique eut une action et une transcendance à défendre. Or nous avons perdu
cette transcendance, et la pensée radicale, elle, est immanente au monde actuel, elle en
fait partie, elle est à son image : catastrophique, ou en tout cas paradoxale,
aléatoire, virtuelle aussi.
Désormais, la pensée radicale est active, elle incube au cœur du système
lui-même, et ce n’est plus une alternative. Elle ne peut être qu’un défi,
poussant les choses à bout. Je ne saurais donc parler d’espoir, mais j’ai la
fascination et l’envie d’entrer dans cette histoire et d’y voir clair.
C’est ce que j’appelle le « pacte de lucidité ». Je considère que les gens
se partagent en fonction de cette lucidité. Tant d’esprits prétendument critiques
s’immergent dans une tentative désespérée de rationalisation et refusent de
prendre en compte cette puissance obscure, incontrôlable, qui ne peut pas rendre compte
d’elle-même en termes de raison, mais qui est à l’œuvre partout. Si la
pensée ne se met pas au diapason, elle n’aura rien à dire sur rien et ne sera rien
d’autre qu’une parodie de l’actualité.
Je digère mal d’être traité de pessimiste, de nihiliste, au sens péjoratif du
terme. Tant pis, c’est la loi du milieu intellectuel. Et au fond, je n’aurais
pas le droit de dire ce que je dis si je n’étais pas, d’une certaine façon,
hors jeu…
Jean Baudrillard a publié une cinquantaine de livres aux titres évocateurs : Le Système
des objets (éd. Gallimard, 1968), La Société de consommation (éd. Denoël, 1970),
L’Echange symbolique et la mort (éd. Gallimard, 1976), Simulacres et simulation
(éd. Galilée, 1981), La Gauche divine (éd. Grasset, 1985), La Guerre du Golfe n’a
pas eu lieu (éd. Galilée, 1991), Le Crime parfait (éd. Galilée, 1995), De la
conjuration des imbéciles (éd. Sens et Tonka, 1998) ou encore Le Pacte de lucidité ou
l’intelligence du Mal (éd. Galilée, 2004
Propos recueillis par
Antoine Perraud
(1) Baudrillard, sous la direction de François L’Yvonnet, Cahier de L’Herne,
328 p., 49 €.
Télérama n° 2923 - 19 janvier 2006
http://www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrandpalais/
En voulant rendre l'école plus "accessible", a-t-on
orchestré son nivellement par le bas ?
L'école joue-t-elle encore son rôle d'ascenseur social, qui a permis par exemple à
Georges Pompidou, modeste fils d'instituteur du centre de la France, d'intégrer une
grande école parisienne et de devenir président de la République ? Non, répond
Jean-Paul Brighelli dans un ouvrage au titre explicite, La Fabrique du crétin, vite
devenu best-seller. Il y dresse pourtant un constat effarant de l'école d'aujourd'hui, en
racontant comment, en moins de trente ans, ce qui fut sans doute le meilleur système
éducatif au monde a fait naufrage. Professeur de français à Montpellier (« un métier
de seigneur », dit-il), Jean-Paul Brighelli ne mâche pas ses mots pour analyser les
causes et les mécanismes de cette catastrophe. Un processus irréversible ?
Télérama : Pourquoi avoir délibérément choisi ce titre provocateur et un rien ambigu
pour dénoncer ce que vous appelez la mort programmée de l'école ?
Jean-Paul Brighelli : Plutôt que de parler de provocation, je préfère parler de
réaction face à la violence qui est faite à la quasi-totalité des élèves des classes
primaires et secondaires de ne plus pouvoir accéder au savoir. Aujourd'hui la majorité
des enfants ne savent plus lire, ni compter, ni écrire, encore moins penser. Et, loin de
combattre cette réalité qui aurait scandalisé les responsables pédagogiques et
politiques il y a quelques décennies, toutes les réformes et refontes de programmes ne
font qu'amplifier le phénomène.
Le constat est dramatique : notre système éducatif est devenu un système à deux
vitesses. A côté des rares écoles et lycées qui perpétuent encore un enseignement
digne de ce nom, où les élites se reproduisent tranquillement d'une génération à
l'autre (enseignement privé, grands lycées de Paris ou de quelques grandes villes de
province), il y a des zones entières de « non-savoir », comme on dit de non-droit, où
la difficulté des apprentissages s'efface derrière les joies ludiques des pratiques de
l'oralité et de l'expression libre.
Quant à l'ambiguïté du titre de mon livre, elle est délibérée. Je voulais que le
lecteur, après avoir craint que le crétin visé soit le produit de cette « fabrique »,
comprenne qu'il en est aussi l'instigateur. Le crétin, c'est celui qui conçoit les
programmes en les révisant systématiquement à la baisse ; celui qui édicte des
circulaires mettant l'élève au centre du système éducatif ; celui qui, habile
didacticien et malin démagogue, se targue de « nouvelle pédagogie » et de ses
excellents résultats. Après tout, 80 % des postulants, et bientôt 80 % d'une tranche
d'âge, n'arrivent-ils pas à avoir le baccalauréat, selon les voeux de l'ancien ministre
Chevènement ? On oublie de préciser que c'est au prix de la multiplication des filières
(plus de soixante bacs différents !), de directives concernant la notation et de
véritables calculs d'apothicaire, pour ne pas dire trucages, afin que les statistiques de
réussite aux examens soient respectées.
Télérama : Comment ce système a-t-il pu se mettre en place ?
Jean-Paul Brighelli : Par une succession de réformes, parfois impulsées avec les
meilleures intentions du monde. Tout a commencé au milieu des années 1970 avec la
réforme Haby, du nom du ministre de l'Education nationale de l'époque, qui a instauré
le collège unique et la sectorisation. Puis la gauche a accentué ces inégalités mises
en place par le régime précédent par une série de mesures, louables sur le papier,
mais qui se sont révélées catastrophiques. La création des ZEP (zones d'éducation
prioritaire), par exemple, où l'analphabétisme, l'absentéisme, les incivilités
commençaient à se développer de façon inquiétante. Il va de soi que ces ghettos, qui
sont vite devenus les culs-de-basse-fosse de notre système éducatif, ont été dotés de
moyens financiers importants et de matériel informatique dernier cri. Et on a cru ainsi
acheter - à bon compte - la paix scolaire.
Autre réforme consternante, celle touchant les programmes et l'esprit même de
l'enseignement. On a vu fleurir des circulaires et des discours ministériels, d'esprit
libertaire et post-soixante-huitard, affirmant que c'était à l'élève de constituer ses
propres savoirs et qu'il ne devait rien acquérir par la contrainte. Donc, plus
d'humiliantes dictées, d'apprentissage par coeur, de devoirs le soir. Plus de latin, de
grec, d'histoire, de culture littéraire inutile. En un mot, on a baissé le seuil
d'exigence, sans se rendre compte que moins on exige des élèves, moins ils donnent, et
moins ils donnent, moins ils reçoivent et plus ils se trouvent sans repères face au
monde des adultes.
Télérama : Quel est le but poursuivi, selon vous, par toutes ces réformes ?
Jean-Paul Brighelli : Leur fonction première semble claire : la formation d'individus
qui, à un titre ou à un autre, seront impliqués dans la grande guerre économique
mondiale du XXIe siècle. Il faut en effet fabriquer une immense population de
main-d'oeuvre bon marché, pas trop éduquée, surtout dénuée de sens critique mais
dotée de certaines compétences techniques, taillable et corvéable à merci au gré des
fluctuations économiques : un public captif devant lequel on agitera en permanence le
spectre du chômage et de l'exclusion.
Ce fort contingent est dirigé par ceux qui sont issus de ce que Jean-Claude Michéa, dans
un livre lumineux d'intelligence et au titre évocateur (1), nomme les pôles d'excellence
: des lieux aux conditions d'accès sélectives qui continuent à transmettre sur le
modèle de l'école traditionnelle - disons celle des années 1960 -, non seulement des
savoirs sophistiqués et créatifs, mais ce minimum d'esprit critique sans lequel la
maîtrise des connaissances n'aurait aucune efficacité. Ailleurs, loin de ces pôles
d'excellence, il est impératif d'enseigner l'ignorance. C'est le nouvel objectif assigné
à l'école publique. Il suppose une double transformation : celle des enseignants,
d'abord, devenus des animateurs chargés de diriger des activités d'éveil et d'organiser
des sorties pédagogiques ou transversales ; celle de l'école elle-même, ensuite,
transformée en « lieu de vie » convivial et ludique, démocratique et citoyen, où l'on
apprend à ne surtout pas apprendre, où les entreprises se poussent du coude pour
pénétrer en force et peser sur le contenu des activités pédagogiques au nom du
pragmatisme et de l'efficacité.
Le résultat de cette situation incroyable, c'est que l'école, jadis véritable ascenseur
social, ne remplit plus du tout cette fonction. Dans un tel système, jamais Albert Camus,
fils d'une femme de ménage illettrée vivant dans un quartier pauvre d'Alger, mais
poussé par un maître d'école « à l'ancienne » conscient de son potentiel, n'aurait
pu devenir Prix Nobel de littérature.
Télérama : Quelles seraient les dispositions d'urgence à prendre pour éviter cette
dérive, sinon ce gâchis ?
Jean-Paul Brighelli : Notre école se meurt, notre école est morte, suis-je tenté de
conclure. Mais peut-être n'est-il pas trop tard, bien que le système libéral se soit
taillé le système éducatif dont il avait besoin. Et le pire, dans cette histoire, c'est
que rien de tout cela n'a été délibérément programmé. Il n'y a pas de complot, pas
de plaisantins cyniques et pervers qui se seraient un jour réunis avec la volonté de
détruire un système éducatif. Quant aux mesures à prendre pour freiner ou empêcher ce
gâchis, elles sont évidentes : supprimer les cartes scolaires pour retrouver les
brassages sociaux, couper l'école des entreprises, faire en sorte qu'elle redevienne un
lieu d'apprentissage, ne plus engager les énièmes réformes, et surtout faire confiance
aux équipes pédagogiques qui, sur place, savent mieux que quiconque ce qui convient à
leurs élèves. Nous avions autrefois pour les enfants une véritable ambition de
réussite, aujourd'hui nous ne faisons que gérer leurs carences.
Télérama : Ne craignez-vous pas d'être taxé de passéiste et de prôner un élitisme
un peu réactionnaire ?
Jean-Paul Brighelli : Qui est passéiste ? Moi ou tous ces parents déboussolés qui,
constatant les carences du système éducatif, inscrivent leurs rejetons dans des
établissements privés qui enseignent... à l'ancienne ? Paul Langevin préconisait il y
a déjà presque un siècle « la promotion de tous et la sélection des meilleurs » :
c'est la formule même de l'élitisme républicain. Le vrai élitisme, au sens le plus
valorisant du terme, doit permettre l'expression pleine et entière des potentiels de
chacun. Et on n'y arrivera qu'en revenant à l'enseignement d'une polyvalence, de savoirs
généraux qui rendront l'individu plus libre de se spécialiser, à son gré, par la
suite.
(1) L'Enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, éd. Climats, 1999.
Propos recueillis par Xavier Lacavalerie
Télérama n° 2918 - 15 décembre 2005

Y a-t-il une voie pour une histoire juste et des
mémoires apaisées ?
Le mardi 29 novembre 2005, alors que les députés socialistes tentent de faire abroger le
texte – qu'ils avaient approuvé un an plus tôt – sur le " rôle positif
" de la colonisation, une dépêche de l'Agence France-Presse annonce la sortie d'un
livre intitulé Le Crime de Napoléon. Pour son auteur, Claude Ribbe, tête pensante du
Collectif DOM des Antillais, Guyanais et Réunionnais, et tout juste nommé par Dominique
de Villepin à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Napoléon n'est
pas seulement celui qui, en 1802, a rétabli par la force l'esclavage aboli huit ans plus
tôt par la Convention. Il est le génocidaire de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Un
Hitler avant l'heure, inventeur des chambres à gaz (dans les bateaux), des plans de
déportation, des escadrons de la mort, des camps de triage (en Bretagne) et de
concentration (sur l'île d'Elbe et en Corse). " Bien connus des historiens ",
les faits seraient " volontairement passés sous silence ", assène l'auteur,
par " peur de dire la vérité ou, pire, approbation ".
Avec ce " pamphlet " lancé à quelques jours du bicentenaire d'Austerlitz,
Claude Ribbe se retrouve sur toutes les radios. Lui qui accuse " la télévision de
service public d'être [avec son Napoléon/Clavier, NDLR] activement associée à la
campagne de promotion du négrier français " va squatter les plateaux de France 2 et
de France 3 (JT, On ne peut pas plaire à tout le monde, Campus, Culture et
dépendances…). La BBC et les quotidiens britanniques se régalent. D'autant que le
Collectif DOM appelle à une manifestation pour le 3 décembre sur l'esplanade des
Invalides. Grande frayeur au gouvernement. Plus question de célébrer Austerlitz. Le 2,
jour anniversaire de la bataille, Chirac est opportunément en voyage à Bamako, et
Villepin laisse à Michèle Alliot-Marie le soin d'assurer l'intendance. Le 3 décembre,
pourtant, entre deux drapeaux tricolores, il n'y aura guère plus de deux cents personnes
aux Invalides pour honnir le génocidaire…
Dans le portrait plutôt sympathique que Libération fait de Claude Ribbe quelques jours
plus tard, le quotidien oublie une chose : l'auteur n'a pas que Napoléon en ligne de mire
; avec le Collectif DOM, il a assigné en justice un historien, Olivier
Pétré-Grenouilleau, auteur en 2004 d'un volumineux Essai d'histoire globale sur Les
Traites négrières. L'historien est attaqué pour une interview donnée en juin dernier
au Journal du dimanche, que l'on peut résumer ainsi : en déclarant la traite des Noirs
par les Européens " crime contre l'humanité ", la loi Taubira du 21 mai 2001 a
établi un lien possible avec la Shoah, donc avec l'idée de génocide, ce que les
traites, si monstrueuses qu'elles fussent, n'étaient pas. Mais derrière cette interview,
c'est le livre, donc le travail d'historien, qui est visé, parce qu'il montre la
complexité historique, et rappelle que les traites dites " intra-africaines "
et " orientales ", plus importantes en volume que la traite atlantique des pays
occidentaux, méritent autant d'attention et d'étude. Sur Internet, Claude Ribbe se
déchaîne contre " cet universitaire de second choix qui, à point nommé, sort de
sa basse Bretagne pour falsifier les chiffres, relativiser la traite atlantique et oser
comparer l'esclavage en Orient du VIIe siècle au crime raciste organisé des Lumières
". Verdict : " Le livre de M. Pétré-Grenouilleau relève purement et
simplement des tribunaux sous le chef de racisme et d'apologie de crime contre
l'humanité. "
L'affaire révolte les historiens, mais reste inconnue du grand public… jusqu'à
l'emballement de décembre. Le refus de l'UMP d'abroger l'article 4 de la loi du 23
février, qui demande très précisément aux programmes scolaires de " reconnaître
en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer ", provoque la
colère aux Antilles, où le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, est contraint
d'annuler son voyage. Le 9 décembre, Jacques Chirac confie au président de l'Assemblée
nationale, Jean-Louis Debré, le soin de " constituer une mission pluraliste pour
évaluer l'action du Parlement dans les domaines de la mémoire et de l'histoire ".
Dans le même temps, agacé par cet article 4, dont on dit qu'il le considère comme
" une grosse connerie ", Chirac donne le ton : " Ce n'est pas à la loi
d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. "
Lesquels ne se le font pas dire deux fois. Dans un texte, " Liberté pour l'histoire
! ", daté du 12 décembre, dix-neuf d'entre eux, grandes pointures allant de
Jean-Pierre Azéma à Michel Winock, en passant par Françoise Chandernagor, Marc Ferro,
Pierre Nora, Jean-Pierre Vernant ou Paul Veyne, ont donc rappelé que " dans un Etat
libre, il n'appartient ni au Parlement, ni à l'autorité judiciaire de définir la
vérité historique ". Jusque-là, pas de problème. Sauf que les " 19 " ne
se contentent pas de demander l'abrogation du fameux article 4. Sont désormais dans leur
collimateur toutes les lois " mémorielles " : la loi Gayssot du 13 juillet 1990
contre les négationnistes ; la loi du 29 janvier 2001, qui reconnaît le génocide
arménien de 1915 ; enfin, la loi Taubira du 21 mai 2001, qui déclare la traite
négrière atlantique et l'esclavage " crime contre l'humanité ".
En soutien à ces historiens, vingt-cinq intellectuels, parmi lesquels Edgar Morin, Max
Gallo et Paul Thibaud, signent à leur tour une pétition sur " la liberté de
débattre ". Ce dernier, ancien directeur de la revue Esprit, explique son point de
vue sur la loi Taubira : " Inscrire dans la loi que l'esclavage est un crime contre
l'humanité pose deux problèmes. Premièrement, c'est un crime aussi vieux que
l'humanité. Va-t-on condamner Aristote ? Ensuite, c'est un crime qui a été commis par
énormément de gens, pas seulement des Français. Certes, la loi Taubira se limite à la
condamnation de la traite atlantique, commise par les Européens. Mais l'article 34 de la
Constitution établit qu'on ne peut légiférer que sur l'action des Français. La
condamnation de l'esclavage ne relevait donc pas du Parlement français mais d'une
instance internationale. " Plus grave, poursuit Paul Thibaud, l'accumulation des lois
" mémorielles " constitue un cocktail explosif : " Les gens qui assignent
Pétré-Grenouilleau s'appuient sur la loi Taubira, mais aussi sur la loi Gayssot, qui
visait au départ à combattre les négationnistes d'extrême droite. L'attaque est en
deux temps : on dit tout d'abord que l'historien a contrevenu à la loi Taubira, qui
définit l'esclavage comme crime contre l'humanité, parce qu'il met des nuances, et qu'on
ne peut nuancer un crime contre l'humanité. Après ça, en vertu de la loi Gayssot, il ne
reste plus qu'à demander des sanctions contre lui parce qu'il a nié un crime contre
l'humanité. C'est un enchaînement fou ! "
L'abrogation de cet ensemble de lois est-il pour autant la solution ? Non, répondent
Gérard Noiriel, historien de l'immigration, et, avec lui, toute une génération de
jeunes historiens et enseignants qui s'étaient mobilisés dès mars dernier pour
condamner ce fameux article 4 sur les programmes scolaires et la colonisation, mais qui
refusent de rejoindre les " 19 " pour demander l'abrogation des autres lois :
" Un historien, enseignant d'histoire ou chercheur, n'a pas à dire aux hommes
politiques comment ils doivent intervenir par rapport au passé. Car cela relève de la
mémoire collective. Que l'on puisse contester ces lois en tant que citoyen, certes, mais
pas en tant qu'historien. En revanche, l'article 4 de la loi du 23 février prétend dire
la manière dont nous devons travailler sur la colonisation. C'est une intrusion directe
dans nos affaires. "
Chercheur en civilisation américaine à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS) – honteusement attaqué sur le web comme le " prototype du nègre
domestique " parce qu'il est l'auteur d'un article favorable au livre de
Pétré-Grenouilleau –, Pap Ndiaye n'a pas non plus signé la pétition des " 19
" : " Les historiens ne peuvent se retrancher du monde. L'histoire est une
discipline poreuse à la société. Mais on peut imaginer que les relations entre histoire
et mouvements sociaux soient des liens créatifs. Pour prendre l'exemple des Etats-Unis,
le grand développement de l'histoire afro-américaine, à partir des années 60, est lié
au mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King parlait souvent d'un remarquable
ouvrage d'un historien du Sud, Vann Woodward, véritable bible du mouvement pour les
droits civiques. Entre historiens et militants, il y avait une relation de confiance.
" A l'inverse, ajoute Pap Ndiaye, " la violence du Collectif DOM, inadmissible,
quasi terroriste, mais aussi la colère des Antillais, se nourrissent de l'occultation des
traites et de l'esclavage – contrairement à la colonisation – depuis un siècle
et demi en France. Occultation, ça ne signifie pas qu'on n'en parle pas, mais qu'on en
parle d'une certaine manière : dans les programmes de seconde, tout est centré sur
l'abolition, celle de 1848, parce qu'elle valorise la République. Mais on ne parle pas de
ce à quoi l'abolition met fin… "
Historienne du fait colonial au CNRS, Myriam Cottias, de mère antillaise, qui travaille
entre Paris et Fort-de-France, est encore plus sévère : " Après l'abolition de
1848, les hommes politiques de couleur qui arrivèrent au pouvoir aux Antilles prônèrent
tous l'oubli du passé. Car la République constituait le point zéro, la nouvelle
histoire s'écrivait. Pour tous les Antillais, l'intégration à l'Etat français était
une intégration à la nation française. Mais la nation française a continué à se
définir à l'intérieur des frontières hexagonales et, avec Charles Seignobos et son
Histoire sincère de la nation française (1937), comme blanche et uniquement blanche.
L'implicite de l'universalisme, véhiculé de génération en génération, transmis par
l'école, est blanc. Ce qui a induit une mise à distance de toutes les autres composantes
de la nation française. Le fait d'être en permanence dans un silence de l'histoire
provoque aujourd'hui un retour du refoulé. " Pour Myriam Cottias, " écrire une
histoire nationale qui tienne enfin compte de l'ensemble de la population française est
un défi important. Quand on voit, par exemple, que dans le Dictionnaire critique de la
Révolution française, de François Furet et de Mona Ozouf, il n'y a aucune entrée sur
la première abolition de l'esclavage, en 1794, ni sur la révolte de Saint-Domingue de
1791 à 1804, année de l'indépendance ! Les historiens devraient faire un peu
d'autocritique sur la façon dont ils écrivent l'histoire nationale ! ".
En cette année 2006, les choses vont bouger, forcément. Dans les écoles tout d'abord.
Le Comité pour la mémoire de l'esclavage, mis en place après la loi Taubira et piloté
par Maryse Condé et Françoise Vergès, a remis son rapport au Premier ministre et
formule des propositions détaillées, sur les manuels scolaires notamment. Dans la
recherche, ensuite. Myriam Cottias a été chargée de mettre sur pied ce que le CNRS
appelle un " réseau thématique prioritaire ", qui coordonnera l'ensemble de la
recherche francophone sur l'esclavage, tous continents confondus, et depuis l'Antiquité,
et lui assurera d'abord une " visibilité ". Car les travaux ne manquent pas :
dans la dernière livraison des Cahiers d'études africaines de l'EHESS, on trouve, par
exemple, un article de l'historien camerounais Issa Saïbou sur " la rémanence de la
condition servile dans le nord du pays ". La description des " razzias de
bétail humain " faites encore au XIXe siècle au nom de l'islam et au détriment des
populations païennes par une aristocratie brigande est d'une violence sans équivalent
chez Pétré-Grenouilleau… Myriam Cottias est optimiste : " La diversité
d'origine et de formation d'une nouvelle génération d'historiens va permettre de
multiplier les approches et les problématiques. "
Reste, après les querelles d'historiens, une question que ne résoudront pas toutes les
bonnes volontés pour mieux prendre en compte le passé : " Comment, se demande le
philosophe Paul Thibaud, un gouvernement qui devrait s'occuper des affaires du pays en
vient-il à légiférer sur l'histoire ? Les sociétés antillaises, tout comme d'ailleurs
la société française dans son ensemble, n'auraient-elles pas avant tout besoin d'un
avenir, d'un projet ? " Ce que Pap Ndiaye formule ainsi : " Au-delà du contexte
français d'occultation de l'esclavage, au-delà de l'action spécifique d'un collectif
tonitruant, il y a bien la crise économique, sociale, identitaire des Antilles. " La
focalisation autour de l'esclavage ne serait qu'un symptôme, aggravé par ce que Myriam
Cottias appelle " l'expérience de l'exclusion à l'intérieur de l'Hexagone ".
" On aurait pu, concède-t-elle, faire l'économie de la loi Taubira si l'on avait
été dans un modèle idéal de fonctionnement égalitaire, non discriminatoire. C'est ce
que dit Paul Ricœur dans Parcours de la reconnaissance : il y a un moment où il faut
formuler les attentes sociales. Et je pense que la loi Taubira était une façon de
formuler ces attentes. " Certes, mais dans son dernier livre,La Mémoire, l'histoire,
l'oubli, publié en l'an 2000, Paul Ricœur disait aussi : " Je reste troublé
par l'inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs.
" Y aura-t-il enfin une vie commune – un projet, un avenir – après cette
bataille des mémoires ?
Vincent Remy
Télérama n° 2922 - 10 janvier 2006
Ripostes
Dernière diffusion le dimanche 5 février 2006
JEUNES : ATTENTION PLANÈTE PRÉCAIRE !
Fabien de San Nicolas
Fabien de San NicolasFabien de San Nicolas, âgé de 28 ans, est président des Jeunes
populaires, une fédération à part entière au sein de l'UMP regroupant les militants
âgés de 16 à 29 ans.
"Le contrat première embauche s'inscrit dans une logique de cohérence globale.
Aujourd'hui, on n'a pas créé un pôle de cohésion sociale pour faire jolie. Le CPE
permet à un jeune de rentrer dans une entreprise (...) Il a deux ans pour faire ces
preuves..."
Razzye Hammadi Après avoir été secrétaire nationale du Mouvement des jeunes
socialistes, Razzye Hammadi, âgé de 26 ans, vient d'en être élu président pour deux
ans.
"La droite est entrée dans l'ère du cynisme ! On nous explique que c'est
compliqué, que l'on comprend les gens mais ce n'est pas compliqué, c'est très simple.
C'est la question sociale qui est à l'origine de ce qu'il s'est passé dans les banlieues
et, qu'est-ce qu'a été la réponse du gouvernement ? Cela a été la précarité. Dans
un premier temps la répression, puis on a parlé de l'apprentissage à 14 ans. Pourquoi
pas les enfants dans les usines dès 8 ans ? (...) Et sur les stagiaires, c'est très
dangereux ce que l'on a dans le loi sur l'égalité des chances : on donne un statut et on
légitime le stagiaire..."
Louis ChauvelProfesseur des universités à l'IEP de Paris, sociologue spécialisé dans
l'analyse des structures sociales et du changement par génération, Louis Chauvel est
chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques et membre de
l'Association française de sociologie.
Auteur d'une thèse de sociologie publiée sous le titre Le destin des générations aux
éditions PUF en 1998, et rééditée en 2002, il a consacré plus d'une cinquantaine
d'articles au changement social en France et en comparaison internationale.
"Un jeune sur cinq ou un jeune sur trois est au chômage à la sortie des études
depuis vingt ans. Cela fait vingt ans que l'on accepte une situation (...) qui présente
des intérêts (...) Aujourd'hui, il y a autant de pauvres dans la société française,
sauf que les pauvres sont jeunes et plein d'avenir dans la pauvreté..."
Martin HirschDirecteur général de l'Agence Française de la Sécurité Sanitaire des
Aliments (AFSSA) depuis 1999, Martin Hirsch est aussi président d'Emmaüs France.
Il a participé à plusieurs cabinets ministériels (Santé, Emploi et Solidarité) et a
enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'ENA, il a signé de nombreux
ouvrages, dont L'affolante histoire de la vache folle, paru chez Balland en 1996, Ces
peurs qui nous gouvernent, édité par Albin Michel en 2002, et le Manifeste contre la
pauvreté, sorti chez Oh Editions en 2004.
"On est dans la situation d'un pays qui est entrain de se priver de son avenir,
puisque l'on prive les jeunes de leurs avenirs (...) On a une société qui est pleine de
portes fermées qu'il faut déverrouiller sous peine d'assister à une explosion..."
Karim Boualem
Karim BoualemTitulaire d'un DEA d'histoire, Karim Boualem est actuellement travailleur
social au centre social Africa 93, situé à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.
"Je galère. J'ai fait des études, donc, je galère, je rame. Les jeunes que je
côtoie au quotidien sur mon lieu de travail ou d'habitation, à Saint-Denis, ne galèrent
pas, ils sont dans le trou ! Il n'y a aucune perspective et cela a conduit à des
situations que l'on a connu au mois d'octobre et de novembre 2005. C'est une
'Cocotte-Minute' qui explose, une situation de détresse, un cri..."
Fanny
FannyDétentrice d'un DESS de communication, Fanny est membre de Génération-Précaire,
un mouvement qui tente de faire reconnaître le droit aux stagiaires de bénéficier d'un
véritable statut intégré dans le droit du travail.
"J'ai actuellement l'impression que des postes pour des jeunes diplômés n'existent
plus. Quand on cherche un emploi, un poste junior, cela veut dire deux ans d'expérience
professionnelle. Il faut bien qu'on l'acquiert à un moment donné cette expérience
professionnelle (...) Le CPE, c'est quand même un pis-aller (...) Nous ce que l'on
veut,c'est avoir accès à un véritable salariat..."
Caricatures :

http://www.lemonde.fr/web/portfolio/0,12-0@2-3214,31-737435@51-735567,0.html
Entre l'envol et la chute
(vers une fédération planétaire)
http://www.humains-associes.org/No6/HA.No6.Edito.html
Tatiana F.
Le libre arbitre est notre seule vraie richesse et, de ce fait, il doit être considéré
comme inviolable. Imposer quoi que ce soit est un crime contre l'humanité, contre nature,
contre conscience. Il ne peut s'agir que de proposer, d'inviter au partage. Ce qui est
vérité pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. L'échange des idées et des
points de vue ne peut que nous enrichir mutuellement, mais pour cela il est une condition
sine qua non : le respect réciproque. Ce sont toujours les "idées insolites"
qui ont fait avancer la culture humaine, aussi bien dans l'histoire de la science que
celles de l'art, de la philosophie, de la psychologie et même des religions.
L'utopie d'hier est l'ordinaire d'aujourd'hui. Le fait qu'une idée soit prématurée ne
signifie pas qu'elle ne soit pas réalisable un jour futur. Dans notre civilisation, avoir
l'esprit ouvert, c'est-à-dire sans préjugés, est assez rare, non pas parce que
l'intelligence en est absente, mais par conformisme socio-psychologique qui veut que l'on
soit en accord avec la majorité, faute de quoi on risque de subir l'exclusion du groupe.
Notre horizon mental est proportionnel à notre champ de vision, et nous savons tous que
nous avons la vue - et la vie - courte. Comme la limite des yeux crée l'horizon, seul
l'élargissement de notre compréhension peut nous apprendre que plus nous marchons vers
l'horizon, plus il s'éloigne.
Exclure de notre champ de vision mental tout ce qui le dépasse, sous prétexte que l'on
ne voit pas, c'est nous maintenir nous-mêmes derrière les barreaux limités de notre
propre prison, c'est être son propre bourreau, en quelque sorte. Ce que je veux signifier
par là, c'est qu'il ne s'agit ni d'affirmer, ni d'infirmer, mais d'accepter les
"propositions insolites" comme hypothèses de travail et d'aller voir par
soi-même si oui ou non, si oui et non, cela est envisageable dans un futur proche, et de
le démontrer arguments à l'appui. L'absence de preuves n'a jamais constitué une preuve
d'absence. Nous pensons que malgré notre haute technologie, nous demeurons
psychologiquement égocentriques, géocentristes, anthropocentristes et nationalistes
primaires de surcroît.
Or, depuis le jour mémorable du 24 juillet 1969, où nous avons aperçu sur nos écrans
l'image du vaisseau spatial Gaïa bleue blues, nous savons que celle-ci est un corps
astronomique indivis et que nous sommes tous, sans exception, des voyageurs à son bord;
plus jamais - me suis-je dit - les hommes ne se verront séparés et différents les uns
des autres. Hélas ! 1010 mille fois hélas ! cette attitude d'exclusion et de blocage
psychologique est toujours de mise.
Aujourd'hui, du moins en Occident, nous avons: d'un côté une science qui nous apprend
que notre galaxie est une ruche de cent milliards d'étoiles dans un univers observable
où il existe environ cent milliards de galaxies semblables à la nôtre, avec des
dimensions chiffrées en milliers d'années-lumière et où pour notre seule galaxie
apparaît le nombre vertigineux de cent mille années-lumière de diamètre (une
année-lumière = 10 000 milliards km), et de l'autre côté une mentalité sectaire,
tribale - à quelques exceptions près.
Pour la plupart, nous vivons pour le panem et circenses, malgré toutes les informations
que nous avons sur l'empire romain et sur l'une des causes majeures de sa chute. Les
civilisations sont mortelles, elles aussi, et la nôtre se meurt, pendant que la nouvelle
est déjà en gestation au sein même de l'actuelle.
Et pendant ce temps-là, notre monde présente une face de plus en plus uniforme,
internationalisée par l'économie, les sciences, les mass-média et les toutes puissantes
transnationales qui règnent en despotes quasi-absolus et pour lesquelles tout est permis.
Et pendant ce temps-ci, ces mêmes puissances nous disent l'impossibilité de réaliser
l'unité dans la diversité, c'est-à-dire l'union de la grande famille fraternelle et
humaine, en nous étiquetant d'irréalistes, et selon les latitudes de fauteurs de
troubles, c'est-à-dire de dangereux individus. Implicitement,
"cartésiennement", tout est fait pour que nous n'ayons plus de but en commun,
plus d'idéal à partager, alors voilà quelques-uns des résultats: par excès de
matérialisme, nous sommes en train de nous effondrer, de nous étouffer lentement mais
sûrement.
Faute d'idéal humain véritable, notre indifférence nous mène droit à la destruction
de notre planète et à l'autodestruction. Certes, nous voyons apparaître des tentatives
communautaires en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, mais tout en essayant
de rester ouverte et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je constate qu'il
suffit de gratter le vernis économico-démago pour s'apercevoir que le souci majeur est
de faire bloc contre... Communautés d'exclusion en réalité, ou il se peut que ce soit
pour nous un passage obligé dont nous ne saurions pas nous détourner. Il se peut...
En face de cela, qu'avons-nous à proposer, tout en prenant en considération le
mercantilisme, l'ignorance, la médiocrité et l'égoïsme?...
L'histoire de l'humanité sur Terre nous a appris que c'est toujours un petit nombre - à
son propre détriment d'ailleurs - qui met en doute le schéma mental établi comme dogme
absolu, qui ose proposer ce que d'autres - par ignorance et par peurs de toutes sortes,
peur du ridicule et de l'exclusion entre autres - n'oseront jamais.
Alors nous sommes partis à la recherche de ceux qui osent, en leur demandant de penser
avec nous un monde où il n'y aurait qu'une seule nationalité, et où le respect de la
diversité dans la solidarité serait notre bien commun.
Vers une communauté planétaire, utopie, rêve de fous, ou recherche nourrie dans l'amour
et au nom de l'espérance pour que demain existe encore ?
Quant à "moi", par extrapolation et aussi par humour (noir ?), je me plais à
demander ce qui arriverait si un jour une civilisation supérieure à la nôtre
établissait le contact avec nous, une civilisation tellement supérieure que, face à
elle, nous nous sentirions comme des prédateurs barbares quoiqu'impuissants, immuablement
figés dans un âge de pierre révolu. Serions-nous prêts à nous unir enfin?
Certainement, forcément comme dirait M.D., mais je crains que - comme il en va souvent
avec les hommes - il ne soit déjà trop tard pour le faire, à moins que..
Caricatures : choc des images ou des civilisations ?

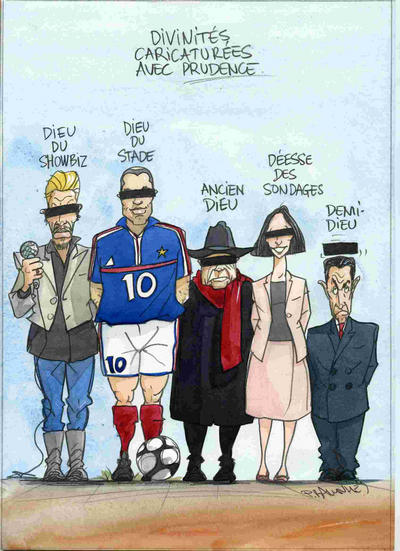 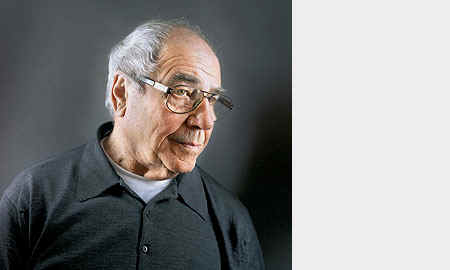
Le dessinateur : » D'où la bombe dans le turban «
Par JANNIK BRINCH
Un dessin du prophète Mahomet avec une bombe dans le turban a fait scandale
aux quatre coins du monde. Mais quel était le message du dessinateur ?
* Qu'est-ce que le Morgenavisen Jyllands-Posten ?
* Honorés concitoyens du monde musulman
* Chronologie
* Historique
* Le dilemme du rédacteur en chef
* Les dessins de la colère
Le dessin du prophète Mahomet avec une bombe dans le turban a fait le tour du monde au
cours de ces derniers mois. A la fois célèbre et haï. Parce que mélanger l'islam et le
terrorisme a offensé des millions de musulmans qui ont interprété le crayon satirique
comme une marque du mépris du monde occidental envers les musulmans et leur religion.
Mais il s'agit d'un malentendu, estime l'auteur du dessin contesté.
Quel était le message dans votre dessin du prophète Mahomet avec une bombe dans le
turban ?
» Le dessin n'illustre pas l'islam dans son ensemble, mais la partie de l'islam qui
apparemment peut pousser à la violence, au terrorisme, au meurtre et à la destruction.
Et donc l'islam fondamentaliste. J'ai voulu montrer que les terroristes tirent leurs armes
spirituelles de l'islam. «
Pourquoi était-ce important pour vous de faire passer ce message ?
» Si une religion tourne au fascisme religieux, nous nous trouvons face à des tendances
totalitaires que nous avons connues en d'autres temps, comme le fascisme et le nazisme.
C'est la même situation, où les gens sont obligés de baisser la tête et de faire ce
que le régime leur commande de faire. Je trouve que c'est une chose que nous devons
combattre, et l'arme du dessinateur, c'est justement cette plume ou ce crayon et puis une
certaine indignation. «
Avez-vous le sentiment que votre dessin a été mal compris ?
» Il y a des interprétations qui ne sont pas correctes. L'opinion couramment répandue
parmi les musulmans est que le dessin traite de l'islam en général. Ce n'est pas le cas.
Il traite de certains signes fondamentalistes qui bien entendu ne sont pas partagés par
tous. «
» Mais ce qui incite aux actes de terrorisme vient de l'interprétation de l'islam. Je ne
pense pas qu'il faille l'ignorer. Cela ne veut pas dire que tous les musulmans sont
responsables du terrorisme. Il s'agit de mettre en évidence une liaison d'où naissent
les armes spirituelles. Il y a certaines interprétations de l'islam selon lesquelles vous
mourez en martyre si vous mourez pour l'islam et vous pouvez tranquillement tuer les
infidèles, vous serez récompensé dans l'au-delà. «
Votre indignation a fait que des millions de musulmans se sentent offensés. Votre dessin
respecte-t-il l'islam dans une mesure suffisante ?
» Il ne respecte pas la version de l'islam qui fournit aux terroristes leurs armes
spirituelles. Je n'ai rien contre l'islam ou contre les musulmans. Ils ont droit à leur
liberté, mais si certaines parties d'une religion prennent une tournure totalitaire et
agressive, j'estime qu'il faut protester. C'est ce que nous avons fait sous les autres
ismes. Sous le communisme ont vu le jour des milliers de dessins satiriques ainsi que
d'autres formes de satire qui le démasquaient et se tournaient contre lui. «
Mais même si vous avez visé les forces fondamentalistes, votre satire a frappé large.
Doit-on au nom de la liberté d'expression avoir le droit d'offenser des religions
entières pour en atteindre une petite partie?
» On doit avoir le droit de faire la satire des religions. Certaines religions souhaitent
tout fixer dans toute la vie humaine, et l'idée religieuse ou la foi renferme en soi une
force effroyable. La tradition satirique est très forte au Danemark. On peut se moquer de
tout. Et de tous. C'est notre idée de base, et normalement la réaction à la satire est
plutôt amicale. Cela ne s'est pas produit ici, et je ne pouvais en tout cas pas le
prévoir. «
Avez-vous envisagé de faire passer le message d'une autre façon sans offenser une
religion entière ?
» C'est une métaphore que j'ai employée dans d'autres circonstances où le
fondamentalisme et le terrorisme ont été critiqués. Mais elle a été ici combinée
avec le Prophète sacré et certains musulmans l'ont très mal pris. Mais moi, je ne suis
pas musulman, ce n'est pas ma religion, je suis dans mon propre pays, j'ai le droit de
suivre la tradition qui, pour ce qui est de la liberté d'expression, est l'une des
pierres angulaires de la démocratie. On ne peut pas y renoncer, ce n'est pas normal. On a
été obligé d'ébaucher la ligne de front. «
Pourquoi était-ce nécessaire ?
» Nous étions obligés de défendre notre attitude envers la liberté d'expression parce
qu'une religion ou les gens qui pratiquent une religion, et en confessent peut-être les
aspects plus fondamentalistes, ont commencé à revendiquer un privilège ou une position
privilégiée dans l'espace public. Par exemple cet auteur qui ne trouvait pas
d'illustrateur pour son oeuvre. Nous devons préserver nos traditions de liberté
d'expression, et je crois que si nous n'avions pas fait ces dessins maintenant, la
confrontation serait arrivée quand même tôt ou tard. A propos d'un film, d'une pièce
de théâtre ou d'un livre. Nous devons y passer, mais nous devons bien entendu en parler
les uns avec les autres et nous comprendre mutuellement. «
Vous-même vous êtes athéiste et connu pour la sévérité de votre plume contre les
religions. Vos dessins sont-ils un règlement de compte avec la religion en général ?
» Je n'ai rien du tout contre les religions, mais pour les versions fondamentalistes, je
pense qu'il faut faire preuve de scepticisme. Une religiosité croissante signifie plus
d'intolérance et d'esprit borné. Cela se complique quand toute l'existence se définit
d'une manière religieuse. Tant pour ceux qui sont séduits, que plus encore pour tous les
autres qui ne le sont pas. Nous vivons un temps où l'obscurantisme religieux se propage,
apparemment la religion acquiert de plus en plus d'importance. Cela signifie qu'en tant
que vieil athéiste, je suis renforcé dans ma conviction. «
Le nom du dessinateur est sciemment omis puisque le Service des Renseignements de la
Police danoise lui conseille pour sa sécurité de conserver l'anonymat dans le débat
autour des dessins sur le Prophète. Les dessinateurs ont reçu plusieurs menaces de
meurtre.
In ripostes du 12 Fevrier
Max Gallo
Max Gallo Historien et romancier, Max Gallo est l'auteur, entre autres, de Fier d'être
Français, paru aux éditions Fayard.
"Il y a une différence de civilisations que certains veulent, là, transformer en
choc de civilisations. On a manipulé l'affaire des caricatures. J'y vois la volonté
qu'il y est un choc de civilisations qui se transforme en guerre de civilisations (...)
Dire la vérité, ce n'est pas souhaiter que cette vérité devienne plus grave encore. Il
y a un enjeu formidable, qui est le destin de l'islam européen, et derrière cet enjeu
des caricatures (...) Il y a le fait de solidarité avec les intégristes de l'islam des
musulmans européens."
Philippe Val
Philippe ValPhilippe Val est directeur de la rédaction de Charlie-Hebdo.
Cet hebdomadaire a publié, mercredi 8 février 2006, un numéro avec, en première page,
un dessin du prophète Mahomet disant : "C'est dur d'être aimer par des cons"
et reproduit, en pages intérieures, les douze dessins parus dans un quotidien danois.
Poussant la logique de la liberté d'expression jusqu'au bout, Philippe Val s'est engagé
à publier les caricatures du "concours international de dessin sur
l'holocauste" organisé par du quotidien iranien Jyllands-Posten.
"Pas choc des civilisations, des difficultés. Un journal égyptien à grand tirage a
publié ces caricatures, il y a trois mois, notamment celle du prophète avec la bombe,
tout le monde s'en est foutu. C'est la preuve que c'est une manipulation politique."
Abdelwahab Meddeb
Abdelwahab MeddebEcrivain et poète, Abdelwahab Meddeb est né à Tunis et vit aujourd'hui
à Paris. Directeur de la revue internationale Dédale, il enseigne la littérature
comparée à l'université Paris X-Nanterre. Il anime l'émission "Cultures
d'islam" sur France Culture.
"Nous sommes en guerre, et l'essentiel, c'est comment faire pour détacher l'islam de
l'islamisme, de ces démons islamistes ? Je crois que c'est la tâche de quiconque,
musulman et non musulman, parce que plus que jamais, nous vivons dans un monde
unique."
Fouad Alaoui
Fouad AlaouiDocteur en neuro-psychologie, Fouad Alaoui, originaire du Maroc, est
aujourd'hui et depuis 1993, secrétaire général de l'Union des Organisations Islamiques
de France (UOIF). Il est également ancien vice-président du Conseil Français du Culte
Musulman CFCM.
"J'entends ici, en France, un discours qui nourrit la notion de choc des
civilisations. La question de l'insulte aux caricatures, des uns et des autres, devient
banalisé. Je pense qu'il faut définir des limites de parts et d'autres (...) On constate
une blessure de toute une partie de notre société et on continue à vous blesser. On va
où ? Est-ce que l'on peut accepter dans notre société de voir des gens blessés et de
leur dire : 'Vous êtes blessés mais c'est notre liberté' ? La liberté d'expression ne
peut pas fonctionner sans limite."
A Philippe Val : "Il faut se dire les choses en face. J'espère, dans notre
société, que l'on instaurera une éthique où il ne vous sera plus permis d'insulter les
autres. Vous parlez de liberté d'expression, c'est la liberté de l'injure".
Olivier Roy
Olivier Roy Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de
recherche au CNRS, Olivier Roy travaille sur l'islam politique et a notamment publié
L'échec de l'islam politique et L'islam mondialisé, parus au Seuil en 1992 et 2002.
Dans le monde musulman, "il y a un esprit sérieux qui, là, est entrain de prendre
le dessus". Un esprit sérieux "qui vient de cette insécurité née du fait
qu'à l'heure actuelle, se pose la question de 'qu'est-ce que cela veut dire être
aujourd'hui musulman', alors que la notion même de culture musulmane est en crise et que
l'on est dans un processus d'occidentalisation."
Ali Dilem
Ali Dilem Caricaturiste algérien, Ali Dilem sévit chaque jour au sein du journal
indépendant Liberté. Il a été condamné, en juin 2005, à verser qu'une amende de 50
000 dinars (environ 550 euros) pour offense à la personne du président de la
République.
"Vous êtes entrain de payer la politique des Etats-Unis. On a vu des bébés
bombardés à Bagdad, des hommes tués dans les mosquées, le Coran foutu dans les
toilettes... et personne n'a réagit. Je pense qu'il s'agit d'une accumulation de choses.
Les dirigeants arabes, sachant qu'il y avait une espèce d'effet Cocotte-Minute qu'il
fallait décompresser un petit peu, se sont dit : 'Allez, on sort tout le monde, trois
petits tours et puis s'en vont'. Les dirigeants arabes n'ont pas de quoi s'opposer à
Bush, ils ont choisi douze Danois. C'était le prétexte pour un peu défouler tout le
monde mais c'est tout. Cela s'arrête là l'affaire des caricatures."
Pouvait-on caricaturer le prophète Mahomet ?
Cette question, qui a déclenché des réactions en chaîne, a relégué à
l'arrière-plan d'autres interrogations. Peut-on opposer à la liberté d'expression le
respect du sacré ? L'escalade de la violence a-t-elle été instrumentalisée et dans
quel but ? La fracture Orient-Occident s'est-elle creusée ? Des intellectuels issus du
monde arabo-musulman répondent.
Quinze jours plus tard, que reste-t-il de cette affaire des caricatures ? Une poignée de
dessins médiocres, certains islamophobes et inutilement provocateurs, ont déclenché une
vague de protestation planétaire, plus manipulée, d'ailleurs, que spontanée. Les
drapeaux brûlés pour les caméras et les plans serrés sur les manifestants masquaient
la taille modeste des manifestations. Rien à voir avec les grandes démonstrations
populaires dont sont capables les islamistes, comme au début de la guerre en Irak, par
exemple. Nous en étions donc là, vendredi 10 février, au moment où nous bouclions ce
numéro, dans ce maesltröm peu ragoûtant de fureurs imbéciles orchestrées dans des
pays musulmans et, en Europe, de leçons de démocratie en forme d'oukases.
L'affaire des caricatures a accouché d'une caricature de débat, dangereuse et mortelle,
puisque ces misérables dessins ont tout de même causé, indirectement, la mort d'une
dizaine d'Afghans, aussi vite oubliée. On retiendra que cette mise en scène médiatique
d'une guerre de religion (quatre mois après la première publication des caricatures !) a
jailli, mondialisation oblige, à la vitesse de la lumière… Le ressentiment du «
monde musulman » vis-à-vis de « l'Occident », deux entités abstraites dont on aurait
d'ailleurs bien du mal à définir les contours, est une mèche d'amadou qui peut
s'enflammer à tout instant.
Cette fracture Orient-Occident, qui n'est pas imaginaire, n'est pourtant ni ethnique ni
culturelle. Sauf, peut-être, pour les tenants du « choc des civilisations ». Derrière
les masques religieux et identitaires, ce sont des lignes de fracture très profanes et
des intérêts politiques qui expliquent le malaise dans cette région étouffée par des
régimes autoritaires, de plus en plus acquise aux thèses conservatrices des Frères
musulmans, et dominée par l'hyperpuissance américaine. « Ne serions-nous pas, à
prendre tout cela au sérieux, les "idiots utiles" d'une farce ? » écrit
l'islamologue François Burgat. A la différence de certains journaux qui ont brandi la
liberté d'expression comme seul étendard, nous avons essayé de comprendre comment «
l'autre côté » avait perçu la crise. Nous sommes donc allés interroger des écrivains
et intellectuels qui sont nés dans le monde arabe ou musulman. Et, au premier chef,
Farouk Mardam-Bey. D'origine syrienne, ce grand connaisseur de la culture et de la
littérature arabes vit à Paris et voyage régulièrement dans le Moyen-Orient. Il est le
coauteur, avec Elias Sanbar, d'Etre arabe, un livre d'entretiens dans la mythique
collection Sindbad, que Farouk Mardam-Bey dirige lui-même chez Actes Sud.
Thierry Leclère
Télérama : Depuis le début de cette affaire, beaucoup de voix, en France, clament que
la liberté d'expression est inaliénable et que les manifestants musulmans demandent aux
démocraties de renoncer à leurs valeurs. Est-ce votre analyse ?
Farouk Mardam-Bey : Le débat est piégé. Et je sens bien cette pression, ici, qui
inciterait à aller dans ce sens. Bien évidemment, je suis « pour la liberté
d'expression ». Et on a vu tous ces derniers jours des musulmans excités, réagissant de
manière totalement irrationnelle, c'est entendu. Mais ces caricatures, aussi, sont une
imbécillité. Elles ne sont pas particulièrement drôles et il y en a même une –
celle qui représente Mahomet coiffé d'une bombe – qui est particulièrement abjecte
: n'importe quel musulman comprend que c'est l'Islam, par essence, qui est terroriste. Il
y a quelque chose de profondément gênant à blesser des gens dans leur foi, dans ce
qu'ils sont, au plus intime. Est-ce qu'il est nécessaire, pour défendre une certaine
liberté de la presse, de publier et republier ces dessins, de vouloir à tout prix
blesser et exciter des millions d'êtres humains, comme si on agitait un chiffon rouge
devant un taureau ?
Insulter le Prophète, depuis Copenhague, franchement… Je trouve l'anticléricalisme
très respectable dans les pays cléricaux, tout comme le blasphème des grands esprits
que vantait Ernest Renan… si c'est dans un Etat théocratique. Je suis donc plus
enclin à défendre la liberté d'expression des intellectuels, dans les pays musulmans,
quand ils font une recherche libre sur l'islam et qu'ils s'exposent, réellement, comme
c'est le cas de certains penseurs.
Télérama : A quels libres esprits faites-vous allusion, alors qu'il est si courant de
dénoncer le « silence des intellectuels arabes » ?Farouk Mardam-Bey : Je pense à
l'Egyptien Nasr Abou Zeid ; il a commencé à penser l'islam de l'intérieur et à
présenter une voie profondément réformiste. Dans les années 90, il a été maltraité
à l'Université puis menacé de mort par des intégristes. Il a dû quitter l'Egypte, et
vit maintenant en Europe (1). D'autres intellectuels ont payé cette liberté d'esprit de
leur vie, comme Mahmoud Mohamed Taha, au Soudan, qui a été condamné à mort et pendu en
janvier 1985, à Khartoum. Il a écrit un livre sur l'histoire de l'islam où il
défendait l'idée d'une séparation du politique et du religieux (2). Il avançait
l'idée que le message spirituel du Prophète, tel qu'il fut révélé à La Mecque, est
universel mais que toute la construction juridique élaborée, à côté, dans un contexte
historique précis, n'était plus en phase avec la vie des musulmans d'aujourd'hui. Tous
les deux avaient d'ailleurs été traduits en français, il y a une quinzaine d'années,
et cela n'avait pas suscité grand intérêt, ici.
Télérama : Régis Debray déclarait dans Le Nouvel Observateur, la semaine dernière :
« Ne projetons pas nos catégories de pensée et notre système d'émotions sociales sur
une aire culturelle – le monde arabe – qui a une autre mémoire, une autre
histoire, et dans laquelle le facteur religieux joue le rôle structurant qu'il jouait
chez nous il y a deux ou trois siècles. » Est-ce, cela aussi, le fond du problème ?
Farouk Mardam-Bey : Je ne crois pas et je me méfie de cette approche différentialiste.
Ce que veulent les sociétés arabes, c'est bien souvent la ressemblance : les gens
souhaitent jouir du même bien-être qu'en Occident. Commencer à dire qu'il y a une
histoire musulmane, une économie musulmane, une sociologie musulmane, des écrivains et
des artistes musulmans… me paraît dangereux. C'est la position des islamistes. Moi,
je pense qu'il y a des valeurs universelles, des concepts comme l'égalité ou la
liberté, qui ont d'ailleurs été cristallisés, à un moment donné, par la pensée
européenne. Ils valent pour tous, dans le monde entier. On connaît d'ailleurs trop bien
le discours que tiennent des régimes autoritaires : la démocratie, pas tout de suite,
pas chez nous, ce n'est pas dans nos traditions… Comme si notre tradition, à nous
Arabes, était de jouir de la torture !
Télérama : Il y a, au départ de cette affaire, la question de la représentation du
Prophète...
Farouk Mardam-Bey : Cette question du rapport de l'islam aux images est très secondaire
dans cette histoire. D'ailleurs, dans l'art musulman, il y a souvent eu des
représentations d'êtres vivants. Dans la tradition persane, on retrouve des êtres
humains sur les miniatures. Dans la tradition turque aussi, et dans la peinture arabe des
XIIe, XIIIe et XIVe siècles, des personnages humains sont présents. Ça a continué,
dans la tradition chiite, avec la représentation d'Ali, le gendre du Prophète. Encore
aujourd'hui, à Téhéran ou dans la banlieue sud de Beyrouth, vous voyez des
fresques représentant Ali et ses fils, Hassan et Hussein.
Télérama : Mais Mahomet, lui-même, n'a jamais été représenté ?
Farouk Mardam-Bey : Si, mais rarement. En Turquie, à l'époque ottomane, on le retrouve
dans une miniature, figuré par une sorte de flamme ou de lumière. Ces dernières
années, l'écrivain tunisien Youssef Seddik avait réalisé une bande dessinée sur
l'histoire des religions en représentant plusieurs prophètes. L'album a été censuré
dans plusieurs pays arabes. Ni les sunnites ni les chiites n'ont l'habitude de le
représenter. Mais ce n'est pas vraiment le problème : imaginons qu'un artiste occidental
ait dessiné le prophète Mahomet sous des traits sympathiques, personne n'aurait
protesté. Chacun a le droit de haïr les religions. De haïr l'islam, pourquoi pas ?
Mais, dans cette affaire des caricatures, c'est différent : au-delà du blasphème, il y
a de l'islamophobie. La marque d'une haine de l'autre. Une forme de racisme mi-ethnique
mi-religieux. D'ailleurs, beaucoup de musulmans ne comprennent pas que l'islamophobie ne
soit pas condamnée par les tribunaux, en Europe, de la même manière que
l'antisémitisme.
Télérama : La semaine dernière, les manifestations semblaient peu spontanées et
largement téléguidées par les pouvoirs en place. Comment a réagi la population dans
les pays que vous connaissez bien ?
Farouk Mardam-Bey : Le monde arabe et musulman, malgré toute sa diversité, est traversé
par un sentiment profond d'injustice. Les musulmans voient qu'ils ne sont pas traités à
égalité avec les autres communautés. Ce sentiment de « deux poids, deux mesures »,
qui a été ravivé par cette polémique, est particulièrement flagrant dans le conflit
israélo-palestinien. Les nombreuses résolutions de l'ONU condamnant l'occupation par
Israël, qui sont restées lettre morte depuis des années, en sont un des symboles
évidents.
Il ne faut jamais oublier la centralité de la question palestinienne dans la conscience
arabe et musulmane. Avec les télévisions satellitaires comme Al-Jazira, les choses ont
réellement changé. Quand on parle d'un mort palestinien, ici, en Europe, c'est un
chiffre ; les télévisions arabes, elles, vont chez ses parents, interviewent ses
proches. Tout cela est vu par cinquante millions de foyers arabes et suscite une
indignation. Et une haine, aussi. Chose inouïe, on a même vu, la semaine dernière, dans
ce vent de folie lié à l'affaire des caricatures, un manifestant brûler un drapeau
français à Jérusalem. Une chose impensable, quand on sait que les Français
apparaissaient, encore récemment, comme faisant partie des rares amis des Palestiniens.
Télérama : Comment l'expliquer ?
Farouk Mardam-Bey : L'Europe paie, notamment, sa réaction hostile à la victoire des
islamistes du Hamas aux récentes élections législatives en Palestine. Beaucoup d'Arabes
sont indignés et se disent : « Comment ? L'Occident veut la démocratie, il observe les
élections sans doute les plus libres et les plus transparentes qui se sont jamais
déroulées dans tout le monde arabe et, parce que le "mauvais" candidat gagne,
ils regardent de travers les résultats ? »
Le discours sur la démocratie tenu par les Occidentaux n'est pas crédible dans un monde
arabe où l'antiaméricanisme est plus virulent que jamais. Les gens remarquent que les
Occidentaux s'attaquent aujourd'hui à la Syrie, au nom de grands principes, mais ne
disent rien contre le régime de Ben Ali, en Tunisie, ou contre celui de l'Arabie
saoudite, qui n'ont rien de démocratique. Ce sentiment, répandu depuis des décennies
chez les Arabes, selon lequel l'Occident a peut-être de bons principes, mais qu'il ne les
met jamais en application chez les autres, est devenu presque un article de foi.
Télérama : Comment les régimes autoritaires en place dans les pays arabes ont-ils
instrumentalisé la colère suscitée par l'affaire des caricatures ?
Farouk Mardam-Bey : La Syrie est un bon exemple. A Damas, d'ordinaire, quand dix
intellectuels essaient de manifester dans la rue, ils trouvent, en face d'eux, trois mille
policiers ! Or, le 4 février dernier, des centaines de manifestants sont sortis,
notamment des écoles théologiques très liées au pouvoir, et ont parcouru longtemps la
ville, brûlant l'ambassade du Danemark et celle de Norvège. Il est rigoureusement
impossible que cela se soit passé sans l'assentiment du pouvoir. A mon avis, cela s'est
même passé à son instigation. Un pouvoir syrien qui se pose aujourd'hui en défenseur
de l'islam, alors qu'il a massacré des dizaines de milliers de Frères musulmans dans les
années 80 !
Comme l'a observé le chercheur Olivier Roy, la carte des émeutes en réaction aux
caricatures de Mahomet montre que les pays où la violence a été la plus forte sont ceux
dont le régime et certaines forces politiques ont des comptes à régler avec les
Européens. La France, et toute l'Europe avec elle, est en train de payer son alignement
sur les Etats-Unis au Proche-Orient, en Afghanistan, et aussi à propos du nucléaire
iranien.
Télérama : C'est d'Iran qu'est venue la réaction la plus abjecte, avec ce « concours
international de dessins sur l'Holocauste » lancé par le quotidien iranien Hamshahri, le
plus fort tirage de Téhéran. Comment ont-ils pu inventer cela ?
Farouk Mardam-Bey : Par cette réponse ignoble, les Iraniens ont voulu attaquer, en
retour, la chose peut-être la plus sacrée dans la mémoire occidentale. La Shoah étant,
en Occident, encore plus taboue que la religion, c'est précisément là qu'ils ont voulu
frapper. Il n'y a pas de sentiment antichrétien dans le monde musulman et arabe, mais il
existe un fort sentiment antijuif, c'est incontestable. Le discours négationniste du
président iranien qui, en décembre dernier, a réfuté l'Holocauste, a été repris dans
beaucoup de pays musulmans ; cette idée que la Shoah est un « mythe » circule partout,
malheureusement, même en dehors des milieux islamistes. Cela fait partie de cette
régression générale, depuis quelques années, très liée à la montée du
fondamentalisme, mais aussi à ce sentiment profond qu'il n'y aura pas de solution en
Palestine. Que cette guerre ne finira jamais.
Télérama : Le « choc des civilisations » n'est-il pas en train de devenir l'une de ces
« prophéties autoréalisatrices », comme disait le sociologue américain William Isaac
Thomas, c'est-à-dire un mensonge qui prend corps à force d'être répété ?
Farouk Mardam-Bey : En effet, aussi bien en Occident que dans les pays musulmans, on a
l'impression qu'on pousse les gens vers une forme de guerre de religion. Je ne crois pas
à un « complot » délibéré ; ce sont plutôt des mécanismes irrationnels qui sont en
marche. Y trouvent leur compte tous ceux qui pensent de manière manichéenne que le monde
se divise entre bons et méchants. Certains néoconservateurs américains ont sans doute
ce schéma en tête. Et aussi les islamistes les plus extrémistes. Mais l'islam politique
– et tout particulièrement celui, dans la mouvance des Frères musulmans, qui a
gagné en Turquie et en Palestine, et qui est très fort en Egypte et au Maroc, notamment
– ne veut pas d'un clash de civilisations. Cette forme d'islamisme-là, que je
n'approuve pas, mais avec laquelle il faut dialoguer, est un conservatisme musulman,
semblable à la démocratie chrétienne qu'a connue l'Europe d'après la Deuxième Guerre
mondiale.
Télérama : Mais la fracture Orient-Occident existe bel et bien…
Farouk Mardam-Bey : Certes, mais elle se creuse, sur une base essentiellement politique.
Si la situation s'envenime, les discours religieux peuvent encore l'approfondir, mais
quelques gestes sérieux de l'Europe ou des Etats-Unis, allant dans un sens politique plus
juste – en Palestine, notamment –, pourraient faire bouger ce paysage très
mouvant. Le choc des civilisations n'aura pas lieu, pour 0au moins deux raisons. D'abord,
parce qu'il y a toujours plusieurs « Occidents ». Pendant la guerre en Irak, Jacques
Chirac, Gerhard Schroeder, et ces millions de gens qui ont manifesté contre la guerre,
ont montré qu'il n'y avait pas « une » position monolithique occidentale. D'autre part,
la mondialisation est une réalité pour toutes les populations du monde musulman, y
compris les plus islamistes. L'Internet, notamment, joue un rôle de plus en plus
important. Tous consomment de la modernité. Les gens comparent et voient comment on vit
en Occident, les classes moyennes veulent s'exprimer. Nous vivons bien dans un seul et
même monde.
(1) Lire Critique du discours religieux, de Nasr Abou Zeid Sindbad (éd. Actes Sud, 1999).
(2) Un islam à vocation libératrice, de Mahmoud Mohamed Taha (éd. L'Harmattan, 2002).
Propos recueillis par Thierry Leclère
Les dates-clés de l'affaire
Juillet-août 2005
L'écrivain danois Kåre Bluitgen, auteur d'un livre pour enfants sur le Coran et Mahomet,
ne trouve pas de dessinateurs osant illustrer son ouvrage. Le quotidien conservateur
Jyllands-Posten, le plus fort tirage du Danemark, s'adresse à une association de
dessinateurs, leur demandant de "dessiner Mahomet comme ils le voient".
30 septembre
Jyllands-Posten publie douze caricatures sous le titre "Les visages de Mahomet".
Dans l'article, on peut lire « La société moderne et séculière est rejetée par
quelques musulmans […]. Ils exigent [sur la religion, NDLR] une position
particulière […]. Ce n'est pas conciliable avec une démocratie séculière et la
liberté d'expression, où il faut être prêt à se faire mépriser, tourner en
dérision, ridiculiser. »
14 octobre
Plusieurs milliers de musulmans manifestent à Copenhague.
2 décembre
Au Pakistan, un groupuscule met à prix la tête des dessinateurs. Puis plusieurs
délégations musulmanes danoises se rendent au Moyen-Orient pour mobiliser Etats et
institutions arabes. Elles montrent les douze dessins, les mélangeant avec d'autres,
très injurieux vis-à-vis de l'islam.
29 décembre
Les ministres des Affaires étrangères arabes condamnent les caricatures et le silence du
gouvernement danois.
5 janvier
Le Danemark et la Ligue arabe décident de mettre fin à la controverse.
10 janvier
Magazinet, un petit magazine chrétien norvégien, qui avait déjà publié les dessins de
son confrère danois, les republie.
fin janvier
La Norvège, mais pas le Danemark, appelle ses diplomates à exprimer leurs regrets. Les
jours suivants, protestations du Koweït, du Yémen, de la Syrie, de Bahreïn, de la
Libye. Le quotidien danois présente ses excuses, et le magazine norvégien, ses «
regrets ».
1er février
Plusieurs journaux européens dont, à Paris, France-Soir, publient simultanément les
caricatures. Le propriétaire du journal licencie le directeur de la publication.
4 février
En Syrie, les ambassades du Danemark et de la Norvège sont incendiées. Les rédacteurs
en chef de deux journaux jordaniens (Shihane et al-Mehwar) sont arrêtés pour avoir
publié les caricatures.
5 février
A Beyrouth, des manifestants sunnites incendient le consulat du Danemark dans le quartier
chrétien, ravivant la tension entre communautés. A Bagdad, le ministre irakien des
Transports annonce le gel de tous les contrats avec le Danemark et la Norvège.
7 février
Téhéran annonce la suspension de tous les liens économiques avec le Danemark.
8 février
Charlie Hebdo explose ses records de vente (400 000 exemplaires) en publiant un numéro
incluant les douze dessins. Chirac « condamne toutes les provocations manifestes
susceptibles d'attiser dangereusement les passions ». Le quotidien iranien Hamshahri, le
plus fort tirage de Téhéran, annonce le lancement d'un « concours international de
dessins sur l'Holocauste ». En Afghanistan, onze personnes auraient été tuées lors des
récentes manifestations.
10 février
54 % des Français considèrent que les médias ont eu tort de publier les caricatures,
d'après un sondage CSA/La Croix.
Télérama n° 2927 - 14 février 2006
Entretien avec alain Finkielkraut :
Ilan : la barbarie à visage antisémite ?

Esther Benbassa
Directrice de recherche au Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe moderne
pour le CNRS, Esther Benbassa enseigne l'histoire du judaïsme moderne à l'université
Paris-IV-Sorbonne.
Elle est l'auteur, entre autres, de La République face à ses minorités,
publié aux éditions fayard en 2004. Son dernier ouvrage, Juifs et musulmans : une
histoire partagée, est à paraître le 6 mars 2006.
"Ce serait peut-être prématuré de ramener tout à l'antisémitisme, qu'il y ait
eu des préjugés, c'est certain. Nous ne connaissons pas la fin de l'enquête, nous
n'avons que quelques indices, et ma peur est que l'on communautarise cette mort terrible
de ce jeune homme.
Cet assassinat, la barbarie commise par ces désœuvrés nous interpellent tous, pas
seulement en tant que juifs mais en tant qu'êtres humains, parce que le crime est quelque
chose qui interpelle toute notre société. Il y a vraiment un problème qui se pose à
notre société et il faudrait que l'on cherche les moyens d'endiguer cette sorte de
barbarie et tous les racismes. Ma peur est que cette affaire se communautarise, que l'on
"remonte" les communautés entre elles et que l'on arrive à une impasse."
Bernard Kouchner
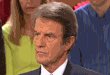
Co-fondateur de Médecins sans frontières et représentant spécial du secrétaire
général des Nations Unies au Kosovo de 1999 à 2001, Bernard Kouchner a été ministre
de la Santé et l'Action humanitaire.
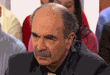 "Ce n'est pas seulement parce que l'on va leur
donner des moyens que tout va changer. Il y a des faits objectifs qui sont la haine de
l'autre (...) Il ne faut pas relâcher sa vigilance, il ne faut pas attendre le prochain
acte antisémite ou raciste en général pour se manifester et dire qu'il y en a marre,
que ce pays est une caricature quand il fait cela, et ce n'est pas la peine d'évoquer
'l'intégration républicaine', car ces deux mots ne suffisent pas, ou 'le pays des Droits
de l'homme', parce que c'est trois mots ne suffisent pas pour que cela cesse." "Ce n'est pas seulement parce que l'on va leur
donner des moyens que tout va changer. Il y a des faits objectifs qui sont la haine de
l'autre (...) Il ne faut pas relâcher sa vigilance, il ne faut pas attendre le prochain
acte antisémite ou raciste en général pour se manifester et dire qu'il y en a marre,
que ce pays est une caricature quand il fait cela, et ce n'est pas la peine d'évoquer
'l'intégration républicaine', car ces deux mots ne suffisent pas, ou 'le pays des Droits
de l'homme', parce que c'est trois mots ne suffisent pas pour que cela cesse."
Michel Wieviorka
Sociologue, docteur d'Etat ès lettres et sciences humaines, Michel Wieviorka est
directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et directeur du
Centre d'analyse et d'intervention sociologiques (EHESS/CNRS).
Avec Georges Balandier, il co-dirige la revue Cahiers internationaux de sociologie
et a dirigé la collection "Voix et regards" aux éditions Balland. Ses
recherches portent sur la notion de conflit, le terrorisme et la violence, sur le racisme,
sur les mouvements sociaux ainsi que sur les phénomènes de différence culturelle.
"Il y a toutes sortes de racismes dans la société française et le problème
n'est pas que l'on s'indigne trop lorsqu'il y a un acte antisémite ; le problème est que
l'on ne s'indigne pas assez lorsqu'il y a des actes racistes qui visent d'autres
catégories "
Guillaume Weill-Raynal
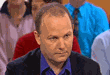
Avocat au barreau de Paris, Guillaume Weill-Raynal est l'auteur d'Une haine
imaginaire, publié aux éditions Armand Colin, 2005.
"On est face à un crime atroce, un fait divers hors norme. Mais face à ce crime
hors norme, on relance de façon artificielle la polémique sur l'antisémitisme, au motif
qu'il y aurait eu dans les motivations des criminels d'éventuels motivations ou clichés
qui seraient peut-être antisémites ou judéophobes. Pardonnez-moi, le gang de Youssouf
Fofana, c'est dix personnes qui ne sont pas ni représentatives de la vie en banlieue ni
représentatives de l'antisémitisme national."
Samy Ghozlan

Ancien commissaire de police, Samy Ghozlan est président du Bureau national de
vigilance contre l'antisémitisme.
"Pour nous, la France n'est pas antisémite. Les banlieues ne sont pas
antisémites. Il y a certains antisémites dans certains coins, mais ce n'est pas du tout
le même antisémitisme que la France a connu. Ce n'est pas du tout ça (...)
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, au départ, tout au départ, une
incitation sans discernement à la solidarité palestinienne qui a pris ces populations et
à qui on a inculqué une haine d'Israël mais qu'ils ont reçu comme une haine des
juifs."
Abd al Malik

Leader du groupe de rap New African Poets (NAP), Abd al Malik est auteur de Qu'Allah
bénisse la France, paru chez Albin Michel en mars 2004.
"En réalité, il s'agit, à un moment donné, de faire un vrai travail
pédagogique, un vrai travail de fond, d'aider les associations locales, de faire en sorte
que l'on se retrouve dans une configuration où les gens puissent avoir les moyens
intellectuels de ne pas penser de cette manière et finalement, par extension, de ne pas
agir selon les clichés, par exemple : 'Les juifs ont de l'argent' (...)
Les clichés que l'on entend dans ces quartiers ne sont pas les seuls. Il y a d'autres
clichés qui sont véhiculés dans les quartiers 'riches'. A un moment, il est important
de relativiser, de faire la part des choses et de se dire quels moyens on se donne pour
que la situation change effectivement, concrètement sur le terrain."
Ripostes : Le 26/02/2006
Bernard Perret est polytechnicien, économiste , membre du Laboratoire de sociologie du
changement des institutions. Il s'intéresse particulièrement aux mutation du travail et
aux politiques d'évaluation. Il a publié notament L'Avenir du travail (éd du Seuil,
1998), L'Evaluation des politiques publiques (éd. La Découverte, 2001), De l aSociété
comme monde commun (éd. Desclée de Brouwer, 2003).
Que révèle le contrat première embauche ?
Vingt-trois pour cent des moins de 25 ans au chômage. De stages gratuits en CDD, les
jeunes ont bien du mal à accéder à l’emploi stable, et à l’emploi tout
court. Avec le CPE (contrat première embauche), qui permet aux entreprises de licencier
tout nouvel entrant pendant deux ans, le gouvernement affirme ouvrir une piste
prometteuse. Il se targue de 280 000 emplois créés grâce à un contrat similaire
adopté en septembre dernier, le CNE (contrat nouvelle embauche), qui ne concernait que
les entreprises de vingt salariés au plus. A l’Assemblée nationale comme dans la
rue, l’opposition dénonce une politique qui précarise l’ensemble des
salariés, faisant peu à peu de ce qui était la règle – le CDI – une
exception. Mais pour l’économiste Bernard Perret, cette précarisation ne concerne
toujours qu’une même fraction, de plus en plus menacée, de la population
française.
Télérama : Comment expliquez-vous la mobilisation autour du contrat première embauche
alors que l’adoption à l’automne du contrat nouvelle embauche n’avait pas
suscité de telles vagues ?
Bernard Perret : Le CNE concernait l’embauche dans les entreprises de vingt salariés
au plus qui offrent majoritairement des emplois peu qualifiés. Le fait qu’il
n’y ait pas eu à l’époque de grandes protestations illustre un non-dit :
depuis des années, dans la société française, les mesures de
flexibilité sont supportées par les moins qualifiés, et notamment les plus
jeunes. Ces derniers jours, si la mobilisation se fait plus forte, c’est que le CPE
concerne tous les moins de 26 ans, y compris les jeunes diplômés, les enfants des
classes moyennes. On pourrait voir un côté positif à ce contrat : tous les jeunes sont
désormais logés à la même enseigne.
Télérama : Mais la précarité épargne toujours de larges couches de salariés ?
Bernard Perret : Des blocs entiers de la population veulent bien du changement
économique, mais refusent d’en subir les conséquences : ce sont essentiellement les
employés des grandes entreprises et ceux du secteur public. Ils bénéficient
d’emplois garantis, d’avancement à l’ancienneté, et retardent autant que
possible toute évolution qui leur serait défavorable. Et ils ont du pouvoir ! Voyez le
nombre de députés et de ministres issus de la fonction publique. Du coup, la
flexibilité en France se développe de manière hypocrite : elle pèse essentiellement
sur les travailleurs les moins qualifiés et les petites entreprises. Les 35
heures ont renforcé le phénomène : dans les administrations et les grandes entreprises,
les salariés ont obtenu des jours de congé supplémentaires. Dans les petites
entreprises, ni salaires élevés, ni avantages sociaux, ni formations…
Télérama : Un certain nombre de jeunes se disent : « Le CPE, c’est mieux que rien.
»
Bernard Perret : Mais il ne résout rien ! On reste dans la logique qui consiste à faire
peser le poids de la flexibilité sur une catégorie particulière de travailleurs plutôt
qu’à revoir l’ensemble de notre contrat social. Depuis vingt-cinq ans, face au
chômage, on procède par dérogations, création d’emplois atypiques, « emplois
aidés » dans le secteur marchand, « contrats emploi solidarité » dans le secteur non
marchand. A quoi il faut ajouter les contrats d’insertion et les stages, dont
l’abus a été dénoncé par le récent mouvement des stagiaires. Des contrats
dérogatoires de ce style, il y en a eu des dizaines. Cela aboutit à un système lourd,
illisible et surtout inefficace.
Télérama : Ces mesures sont pourtant présentées par les hommes politiques comme des
formules magiques…
Bernard Perret : L’emploi est le domaine des effets de manche et des fausses
trouvailles. La première honnêteté consisterait à reconnaître qu’il ne va pas y
avoir de croissance forte, donc de création massive d’emplois, même si les départs
en retraite vont améliorer un peu la situation. La gauche et la droite sont
complices. Chacune jouant à défaire ce que l’autre a fait, elles ne travaillent pas
sérieusement à inventer un nouveau compromis social. Cela aboutit au
pire : une société très flexible, inégalitaire et opaque.
Nous ne pourrons avancer que si nous travaillons à résoudre la contradiction suivante :
d’un côté, des entreprises qui veulent de la fluidité car elles opèrent dans un
monde économique instable, sur des marchés qui peuvent évoluer très vite ; de
l’autre, des salariés qui demandent de la stabilité car, pour avoir un appartement,
une vie « normale », il faut des revenus stables. Comment définir un compromis viable,
un nouveau modèle ? C’est la vraie question. Or, jusque dans nos comportements
individuels, nous ne l’abordons pas franchement. Comme consommateurs, par exemple,
nous voulons pouvoir changer d’opérateur de téléphonie, nous nous précipitons sur
les pantalons chinois à 3 euros, etc. Et nous voulons croire que ce mode de consommation
est sans effet sur l’organisation du monde !
Télérama : C’est un peu la poule et l’œuf. Les salariés vont vous
répondre que s’ils achètent le moins cher possible c’est parce qu’ils
sont de plus en plus précaires et mal payés.
Bernard Perret : Oui, mais il faut mesurer les conséquences de nos actions. Chacun
d’entre nous, en tant que consommateur, bénéficie de l’intensification de la
concurrence – que l’on pense à la révolution des télécommunications –
sans se soucier des contraintes qu’elle induit sur les travailleurs qui fabriquent ce
qu’il achète.
Télérama : Les Danois, eux, ont travaillé la question du compromis social. Leur fameuse
« flexi-sécurité », qui laisse les employeurs libres d’embaucher et de licencier,
mais qui accompagne par un vrai suivi social le parcours des salariés, est-elle une voie
à explorer ?
Bernard Perret : C’est un système tout de même assez autoritaire, il faut le dire.
Si vous êtes cuisinier et que seule la menuiserie embauche, on va vous demander de vous
reconvertir, sans état d’âme, et vite. Reste que le Danemark dispose de structures
sociales et politiques que nous n’avons pas, du moins pour l’instant, pour
lutter contre les effets négatifs de la mondialisation : des salariés syndiqués à 80
%, des partenaires sociaux qui ont l’habitude d’agir et de travailler ensemble,
de négocier. Le modèle danois a le mérite de fixer les règles du compromis : une
grande flexibilité, oui, mais assortie d’une garantie de continuité de droits
sociaux et de revenus. En France, les propositions ne manquent pas sur la manière de «
sécuriser » les parcours professionnels. La CGT, par exemple, a repris l’idée
d’une « sécurité sociale professionnelle ». Mais les syndicats sont minoritaires
et divisés.
Télérama : Est-ce pour cela qu’on ne peut construire un autre modèle social ?
Bernard Perret : Le profil des responsables syndicaux, issus des métiers les plus
qualifiés et surtout de la fonction publique, les pousse à défendre les points de vue
des classes moyennes, des détenteurs d’un emploi stable. Quand ils protestent contre
la flexibilité, c’est ce monde bien garanti qu’ils défendent. Les employés à
temps partiel, les ouvriers devenus précaires ? Personne ne les représente. Le plus
grand service à rendre à la société française serait donc de lui faire comprendre
comment elle est « fabriquée », si j’ose dire : avec ce corporatisme qui la fonde
et organise la protection des plus protégés et d’eux seuls. Comme un cercle
vicieux.
Télérama : Quelle évolution possible ?
Bernard Perret : Une flexibilité négociée, avec des médiations : vous pouvez être
viré du jour au lendemain, mais pas sans concertation. Il y a dans l’entreprise des
instances de négociation, qui peuvent examiner les dossiers et protéger les salariés
contre l’arbitraire. Il faut reconnaître aux Anglo-Saxons un mérite : ils croient
aux vertus éthiques de leur système. Ils sont convaincus que le marché, la concurrence,
c’est juste, parce que tout le monde a sa chance, et la responsabilité individuelle
est encouragée par l’éducation. En France, on présente les changements
économiques comme une fatalité que les pauvres doivent accepter pour que les riches
puissent continuer à vivre tranquilles. C’est insupportable. Il faut sortir de ce
libéralisme honteux et défensif pour affronter collectivement la contradiction entre un
système économique que nous ne pouvons plus rejeter et notre idéal de vie en société
!
Propos recueillis par Dominique Louise Pélegrin
Télérama n° 2926 - 7 février 2006
Ouverture
par Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris.
En créant, il y a plus d’un siècle, les Conférences de Carême, le Bienheureux F.
Ozanam, Mgr de Quelen et l’Abbé Lacordaire répondaient à un besoin de leur temps :
rappeler les fondamentaux de la doctrine chrétienne. Ils le firent dans le style et avec
les moyens de leur époque, pour une société qui reprenait progressivement des allures
chrétiennes, mais dans un climat de grandes tensions sociales et dans une grande
ignorance des enseignements de l’Église. Pour les catholiques cultivés,
l’urgence était de pouvoir se réapproprier les bases doctrinales de leur foi et
d’en devenir les défenseurs dans un contexte jugé agressif ou, en tout cas,
polémique.
Depuis ce temps, la nécessité pour l’Église de réfléchir les grandes
expériences de l’humanité ne s’est pas estompée et les Conférences de
Notre-Dame ont continué de remplir leur fonction. Mais, alors que depuis deux siècles au
moins l’Église s’affronte dans notre pays avec d’autres approches de la
compréhension de l’humanité et étant donnée la profonde sécularisation de la
culture qui nous façonne, le Cardinal Lustiger a souhaité que la rencontre de la foi et
de la raison humaine trouve son expression dans le cadre de ces conférences. C’est
ainsi que, depuis l’an dernier, elles cherchent à provoquer et à diffuser le
dialogue de la conception chrétienne de l’homme avec d’autres expressions
d’humanisme croyant ou athée.
Pendant ces dimanches, vous allez entendre des interventions à deux voix. Elles
s’efforcent d’être l’écho du dialogue qu’ont entretenu les
intervenants pour les préparer. Non pas un match dont sortirait nécessairement vainqueur
un détenteur de la vérité, mais une rencontre dans laquelle deux personnes de
conviction tentent de s’ouvrir mutuellement un chemin d’accès vers leur part de
la vérité humaine. Ce dialogue rassemble des personnes animées par le souci de
progresser vers la vérité. Si elle n’est pas conçue pour fournir
l’exhortation de Carême que le chrétien trouvera dans sa paroisse, chaque «
conférence » veut être ainsi un stimulant pour nous encourager à rencontrer les hommes
et les femmes de notre temps, pas seulement dans leurs réalisations exceptionnelles ou la
banalité de leur quotidien, ni en dénonçant les travers bien connus de notre société,
mais surtout pour entendre comment ils comprennent la dignité de l’existence humaine
dans le cours des jours à travers leurs itinéraires personnels
Partir de l’exclamation du païen Pilate, rapportée par l’évangile de Jean :
« Voici l’homme ! » et considérer les grandes expériences humaines, telles que :
« Être différent », « Devenir », « Souffrir », « Mourir », « Espérer » et «
Vivre », c’est toucher à la racine même de la dignité humaine. La foi chrétienne
nous dit quelque chose sur ces sujets, mais elle n’est pas la seule : tous les hommes
de toutes convictions sont acculés à faire face à ces situations et à les réfléchir.
On reproche souvent à l’Église de ne pas savoir se faire entendre et comprendre des
hommes de notre temps. On pourrait sans doute lui reprocher, à plus juste titre, de ne
pas assez écouter les hommes pour pouvoir leur parler utilement. Cet impératif
d’attention bienveillante aux efforts de nos contemporains pour comprendre notre
monde et leurs activités en son sein est sans nul doute la condition première de toute
évangélisation, car il est déjà une bonne nouvelle en lui-même. En votre nom à tous,
vous qui êtes ici présents et vous qui nous suivez sur France Culture, Radio Notre-Dame
et KTO, je veux déjà remercier celles et ceux qui ont accepté de courir le risque de la
rencontre et du dialogue et je cède immédiatement la parole à M. Axel Kahn et à M.
Jean Vanier.
Aux frontières de l’altérité
Axel Kahn
L’homme seul n’existe pas car il ne serait alors pas pleinement humain. Etre
social, d’une incroyable sensibilité à l’empreinte mentale laissée par ses
contacts avec autrui, ce n’est qu’intégré à une société humaine engendrant
sa culture propre qu’il peut profiter des potentialités cognitives que lui
confèrent ses gènes,. Nombreux sont les exemples d’enfants sauvages, esseulés
depuis leur plus jeune âge dans un environnement animal, qui témoignent de cette
évidence : sans les autres, l’individu ne peut pas être lui et devenir le sujet de
sa propre vie.
Nécessité et évidence de l’Autre
Sans l’autre, sans son influence édificatrice de mon esprit, je ne suis presque rien
et n’ai sans doute pas accès à la conscience de moi. Sans moi, l’autre est tel
que je serais sans lui. L’humanisation d’Homo sapiens passe par cette
auto-construction de soi qui exige le contact avec l’autre, la reconnaissance de sa
singularité. Puisque je n’ai pu me construire et me connaître que grâce à lui,
j’en déduis qu’il en est de même dans son cas, que je lui suis nécessaire
autant qu’il l’est pour moi. Ainsi, les conditions d’exercice par
l’homme de la plénitude de ses moyens mentaux le conduisent de façon inéluctable
à la perception de l’énigme de l’altérité.
Enigme puisque cet autre grâce auquel je me suis édifié et qui a eu besoin de moi pour
faire de même n’est clairement pas moi. D’ailleurs, eut-il été possible que
j’accède à la conscience de moi en ne commerçant qu’avec moi-même, avec mon
image ou mon double de chair, en imaginant que je puisse me reproduire par clonage ? Sans
doute pas, car toute relation enrichissante exige la différence, l’apport mutuel
permettant aux deux protagonistes du dialogue d’enrichir l’un et l’autre
leur entendement singulier et franchir ainsi une étape d’une progression continue.
Il est bien sûr possible de progresser par un exercice de pensée solitaire, mais
seulement lorsqu’on en a acquis la capacité. Un homme façonné par son contact avec
ses semblables dans une société de culture a la capacité, en une certaine mesure, de
dialoguer avec une image mentale de l’autre, c’est-à-dire de soupeser des
points de vue différents. Si jamais n’a pu se développer l’hypothèse
d’une pensée différente, l’échange et le dialogue avec autrui (ou
l’idée qu’on en a) sont impossibles et l’esprit se réduit à une enceinte
close où ne peut résonner, s’atténuant peu à peu, que l’écho de soi-même.
Ainsi n’ai-je pu émerger de moi pour m’observer et me connaître que grâce au
feu d’un esprit différent que j’ai contribué moi-même à développer et à
entretenir. Il en va comme dans un âtre où une bûche isolée, même incandescente,
engendre quelques fumées mais pas de flammes, à moins qu’elle ne se trouve soumise
à la chaleur d’autres bûches à son contact, qui s’enflamment elles aussi.
L’ambivalence du rapport à autrui demeure irréductible. En effet, considérons deux
êtres, ou plus. Leur interaction les a fait ce qu’ils sont, et leur a permis tout à
la fois d’en prendre conscience et de reconnaître les influences humaines qui les
ont révélé à eux-mêmes. Pour autant, l’altérité de l’autre, condition
nécessaire à l’édification mutuelle des personnes, est absolue et définitive.
Ceux dont je dépends tant, dont je suis conduit à reconnaître le rôle essentiel dans
mon avènement à la qualité de sujet, je ne puis néanmoins les connaître. Extérieurs
à moi, je n’aurais jamais la capacité de les appréhender dans leur authenticité
et dans leur totalité. Eux-mêmes sont bien sûr dans la même situation
d’impuissance en ce qui me concerne. Toute notre vie, nous ressentirons néanmoins la
nécessité d’observer le reflet de nous-mêmes dans ce miroir déformant aux
propriétés étranges que constitue autrui. Son indifférence à notre égard nous rendra
fou et nous nous perdrons en supputations quant à ce qu’il pense de nous, ce
qu’il imagine que nous pensons nous-même. Une grande partie de nos pensées, de nos
efforts auront pour but d’influencer, de manipuler cette appréhension par
l’autre de notre réalité, sans jamais aucune certitude d’y parvenir. Nous
sommes vis-à-vis de l’autre comme un être cherchant la confirmation de son
existence à travers l’observation de son reflet dans les yeux et l’esprit de
l’entourage, miroir infidèle mais irremplaçable. Nous nous épuisons à tenter de
remodeler notre image réfléchie selon l’idéal de ce que nous aimerions être, sans
jamais maîtriser complètement les propriétés bizarres de l’esprit d’autrui
qui nous reflète.
L’étranger
Lorsque la distance s’accroît avec l’autre, il devient étrange. Extérieur au
groupe dont la culture m’a forgé, nous n’avons jamais eu l’occasion de
nous construite l’un l’autre, de nous apprivoiser. Notre différence excède à
ce point ce qui me sépare des miens, que j’ai peine à me reconnaître en lui, et
cela est sans doute réciproque. Son visage, parfois, ses vêtements et ses habitudes, les
mets et les boissons qu’il affectionne, les pensées qui l’habitent, les
symboles auxquels il se réfère constituent autant d’obstacles à ce que nous soyons
le miroir, même déformant, l’un de l’autre, à ce que s’enchevêtrent nos
idées et que communient nos émotions. C’est un étranger, il m’est
indifférent ou m’apparaît menaçant, ce qui engendre dans l’un et l’autre
cas une sourde hostilité entre nous. Le mépris, le sentiment de son insignifiance au
regard d’autrui constituent des agressions psychologiques d’une incroyable
violence ; chacun reposant sur l’autre pour s’instituer dans son humanité, je
suis l’ennemi de qui je méprise ou néglige. S’il m’apparaît constituer
une menace pour ce qui m’importe, moi, les miens ou mes valeurs, c’est lui qui
devient mon ennemi. De l’étrangeté à l’indifférence et à l’hostilité,
ce sont tous les ressorts psychologiques des exclusions et des racismes que nous venons de
passer en revue. Il suffira qu’ils entrent en résonance avec un mal-être social, un
fanatisme nationaliste, idéologique ou religieux pour qu’ils débouchent sur de
sanglants conflits ou l’immolation des boucs émissaires.
Et pourtant, quelle richesse dans l’étranger, d’autant plus précieuse
qu’elle nous est inconnue et difficile d’accès. Il est impossible de douter
qu’il s’est construit lui aussi dans sa culture propre, selon les principes
universels de la co-édification intersubjective au sein d’une société humaine. Il
a gravi, comme nous, les niveaux de conscience et d’entendement le menant à un
univers symbolique cohérent, avec ses concepts et ses références, mais plus ou moins
différent du nôtre. Il a, en d’autres termes, exploré une autre contrée du monde
des idées que nous, contrée à laquelle nous n’aurions jamais eu accès, dont
peut-être nous n’aurions jamais eu connaissance. Rien ne permet de supposer que
l’univers psychique de l’étranger soit moins performant, moins créatif, moins
bouleversant que celui qui fonde la culture des miens, celle qui, en interaction avec mes
propres particularités, m’a fait ce que je suis et ce que je pense.
En d’autres termes, un continent inconnu de l’esprit m’est dévoilé, que
je pourrais connaître, dont l’exploration élargira mon horizon intellectuel, me
fera faire l’expérience d’émotions insoupçonnées, m’enrichira toujours
en tant que maître responsable et conscient de ma vie. L’étranger me tend la main,
il me propose de découvrir ses trésors, je l’initierai aux nôtres. Nous ferons
tous deux, si nous avons pu nous ouvrir l’un à l’autre, curieux de notre
différence, des progrès inouïs dans l’appréhension de nous-mêmes et du monde.
L’histoire témoigne de la fécondité de l’hybridation et des dangers de
l’endogamie culturelles.
L’Egypte ancienne échange avec le monde assyrien et mésopotamien, les Phéniciens
s’enrichissent de leurs influences réciproques et leurs interactions avec le monde
grec laissent des traces profondes chez les uns et les autres qui par
l’intermédiaire initial des Etrusques sont à l’origine de la culture romaine,
et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps si le processus n’est pas interrompu
par un phénomène de globalisation symbolique aussi bien qu’économique. Ramener
toutes les valeurs à leur dimension marchande à l’échelle de la planète possède,
en effet, un puissant pouvoir d’homogénéisation nuisant à la fécondité des
échanges puisque c’est de la confrontation des différences que naissent
l’idée et l’enfant nouveaux. La réaction à une telle évolution vers un
schéma standard de pensée à l’échelle de la planète prend souvent la forme
d’un repli communautaire en deçà de frontières psychiques que l’on
s’ingénie à rendre aussi protectrices, c’est-à-dire aussi étanches que
possible. L’étranger redevient alors inconnaissable, indifférent ou
menaçant…. Le racisme est de retour.
La différence radicale de la personne handicapée
Naître, vivre et mourir, telle est la sempiternelle litanie de tout destin. Entre les
deux termes, l’épanouissement de la vie est sévèrement contraint par les limites
de la nature, posant à l’homme la question de la liberté.
Personne n’est libre de faire tout ce qu’il voudrait. Malgré notre désir de
nous mêler aux oies sauvages dans le ciel, d’accompagner les dauphins dans leurs
plongées profondes, de demeurer, toujours, jeunes, beaux et actifs, nous ne le pouvons
pas. C’est pourquoi l’homme a inventé les ballons et les avions, les appareils
de plongée et les sous-marins, les ordinateurs, les robots et les prothèses, et
qu’il dépense tant d’énergie à contrecarrer les manifestations du
vieillissement.
Que dire, alors, de tous ceux qui sont bien plus limités dans la réalisation de leurs
désirs que ne l’est le commun des mortels. Il ne s’agit plus ici de voler, mais
simplement de se mouvoir, d’appréhender le monde qui nous entoure malgré des
organes des sens défaillants, d’être acteur de sa vie malgré des retards ou des
désordres mentaux plus ou moins importants. Dans certains cas, la douleur de chaque
instant alourdit encore le fardeau d’être vivant.
D’un point de vue médical, la prévention du handicap est un devoir qui relève de
la raison d’être de la médecine : éviter que la sphère des possibilités
naturelles de l’homme ne soit limitée par des processus appelés, dès lors,
pathologiques. Lorsque la personne affectée par un handicap est née, elle est cependant
à l’évidence, une personne à part entière, jouissant de la plénitude de ses
droits et fondée à attende de la société l’aide spécifique dont elle a besoin.
Il s’agit pour des nations riches et développées telles que la nôtre, telle que
l’Europe dans son ensemble, de mobiliser leurs moyens techniques et financiers, leurs
citoyens, pour permettre à leurs enfants marquées par le sort de rétablir autant
qu’il est possible leur autonomie de décision et d’action.
A quoi serviraient les fruits de nos efforts, de notre travail, les biens que nous créons
ou acquerrons, s’ils n’étaient pas aussi des outils de la solidarité envers
qui le requiert ? et qui plus que les personnes handicapées ?
Admettre la légitimité d’une prévention du handicap n’est en rien
contradictoire avec la reconnaissance de la dignité des personnes handicapées. A
l’inverse, noter combien la présence d’enfants handicapés dans une classe peut
constituer une circonstance enrichissante, profondément humanisante pour tous leurs
camarades ; être ébloui par la tendresse réciproque entre des parents et leur fils ou
leur fille souffrant d’un handicap plus ou moins sévère, se trouver comme irradié
par ce sentiment lumineux de bonté et d’amour, ne conduit pas à une vision naïve
du handicap vu comme une chance, voire une bénédiction. S’il n’est pas
toujours synonyme de malheur, le handicap est au moins une entrave, une épreuve imposée.
La surmonter peut conduite à la révélation de la richesse de l’esprit humain,
constituer un hymne à la volonté par laquelle il s’exprime, mais s’efforcer de
la prévenir n’est pas illégitime.
Il apparaît en effet juste de tenter, lorsque cela est possible, d’éviter que des
obstacles indus n’entravent l’expression des potentialités humaines. Cette
opinion, sans doute consensuelle, devrait déboucher sur des actions concrètes : par des
mesures de santé publique, d’hygiène, de pharmacovigilance, tout faire pour
diminuer la prévalence des désordres congénitaux à l’origine des handicaps
constitutionnels, pour mener une politique efficace d’éducation à la santé et de
prévention des risques de nature à réduire la fréquence des maladies et des accidents
générateurs de handicap.
Lorsque le mal est fait, que la personne est là, avec son handicap, il s’agit alors
de l’aider, elle et sa famille, à surmonter autant qu’il se peut les
difficultés et les obstacles qui se présentent, à tout le moins d’y faire face.
On est loin du compte, en particulier en France, ou malgré les lois et les efforts de
mobilisation menés par diverses associations, les aides restent trop chichement comptées
et les établissement spécialisés dans la prise en charge des enfants, et surtout des
adultes concernés, demeurent notoirement insuffisants. Pour s’en convaincre, il
suffit d’observer dans les provinces belges, limitrophes de notre pays, la proportion
de jeunes français dans les institutions recevant des enfants et des adolescents
souffrant de handicaps mentaux sévères.
Indépendamment des sacrifices nécessaires à l’accomplissement de notre devoir
envers nos concitoyens en difficulté, il convient déjà de les accueillir. Or,
c’est dans le regard des gens « normaux » que, souvent, se manifeste d’abord
le rejet.
Il existe un continuum allant de l’altérité identitaire à la différence radicale
: nos frères, les nôtres, les étrangers, et ceux que nous ressentons de la gène à
dénommer tant ils s’écartent des canons de l’humanité affichés par notre
société. Le héros des temps modernes, celui auquel il convient de s’identifier,
est jeune, beau et performant. Or, il existe des personnes qui apparaissent bien vite
vieilles et usées, nous agressent par leurs difformités et s’avèrent, en général
improductives.
Ce sont différentes formes de retards mentaux sévères, ou bien des désordres du corps
confinant à la monstruosité, l’Elephant Man du film de David Lynch, les monstres de
cirque du film Freaks de Tod Browning. Dans cette œuvre cinématographique
exceptionnelle, les êtres « de la monstrueuse parade » - pour reprendre son titre
français - se vengent de la plus cruelle manière du mépris dont l’un d’entre
eux a été la victime. Ils s’en prennent à la normalité et à la beauté du couple
qui a refusé de les voir comme des membres de la communauté humaine. Ce n’est
qu’un film, cependant, et toux ceux que notre regard exclut n’ont le plus
souvent aucun moyen de nous en demander raison.
Quelle place pour le nain, le géant, l’homme tronc ou l’homme-éléphant de
Lynch dont on ne cesse de tirer profit en les exhibant dans des foires ? Et, pire encore,
pour cet enfant apeuré et douloureux, au visage marqué, figé, dépourvu de tout moyen
de s’imposer. Incapable de produire et de rapporter, il ne vaut que par la valeur
qu’on lui reconnaît. Il existe, certes, mais pour personne, pas même pour lui, à
moins qu’on ne l’accueille.
Mais pourquoi l’accueillir ? Parce qu’il est enfant de Dieu, notre frère, pour
les croyants. Mais pour les autres ? Parce que le peuple français s’y est engagé à
travers divers textes de lois depuis 1975, au moins lorsque la volonté de la mère
informée de l’état du fœtus avant la naissance a été que le bébé vienne au
monde. Ce respect de la liberté de la femme, en accord avec son conjoint, fût de la part
des parlementaires français la reconnaissance qu’elle est impliquée au premier chef
par la décision à prendre, et que personne ne peut se substituer à elle pour
déterminer ce qu’il convient de faire.
Cependant, cette liberté plie aujourd’hui sous les coups redoublés d’un
eugénisme normatif inculquant à chacun l’idée selon laquelle la naissance
d’enfants de qualité altérée est un déni du progrès des techniques médicales
qui permettent de l’éviter. Les tribunaux ont plusieurs fois statué en ce sens :
des enfants lourdement handicapés ne pouvaient être indemnisés de leur handicap
qu’à la condition d’être nés « par erreur », leur mère n’ayant pu
l’éviter du fait d’une erreur de diagnostic prénatal. En revanche, s’ils
ont été voulus en connaissance de cause, droit que la loi reconnaît bien sûr à la
femme, ou bien si leur handicap résulte d’un aléa imprévisible et indétectable,
alors ils n’auront rien. De toute façon quelle que soit la loi, et son respect, elle
ne suffit pas à adoucir les cœurs. Reposons donc la question, pourquoi les
accueillir, au moins quand ils sont là, ces enfants si fragiles, par delà la référence
à la loi divine ou à celle des hommes ? Parce que c’est un devoir qu’il est
difficile à un être responsable de méconnaître et, le cas échéant, aussi une source
possible de bonheur.
Ce petit d’homme dépend de nous pour accéder au bien-être, ressentir du plaisir,
connaître des joies. Nous ne pouvons douter qu’il le peut, comme, hélas, qu’il
est aussi vulnérable à la douleur et à la terreur, toutes émotions dont la valeur
positive ou négative nous est familière. Comment, en conscience, se savoir responsable
du sort de cet enfant qui procède de la communauté humaine, de cette personne, et lui
imposer des douleurs et des malheurs dont nous avons éprouvé la rudesse ? Le devoir sans
satisfaction est cependant bien fragile mais la menace en est-elle si grande ? Ecoutons
ceux qui se sont affrontés à ce type de situation, par vocation ou parce que la vie
l’a commandé. A la condition express que l’aide nécessaire soit apportée, que
la contrainte matérielle de tous les instants et l’angoisse du lendemain
n’aboutissent pas à une totale insensibilité émotionnelle, au rejet d’une
épreuve insupportable, quel prodige que le sourire confiant de l’enfant apaisé, que
ce regard qui s’éclaire de l’amour donné et des merveilles qu’il peut
accomplir.
L’effort consenti librement pour donner tout le bonheur possible à qui ne peut ni le
demander, ni le conquérir, recèle une source possible d’ineffable joie. En absence
du soutien indispensable, matériel et psychologique, des structures adaptées, en
particulier aux cas les plus sévères, ce peut être là, à l’inverse, le facteur
déclenchant d’un malheur terrifiant auquel personne ne résistera, ni le sujet
affecté, ni sa famille, ni son entourage.
La voie lucide, responsable, généreuse et par conséquent humaine, qu’il revient à
notre société d’emprunter repose au total sur des principes clairs. Prévenir le
handicap autant qu’il est possible. Informer les familles, les écouter, discuter
avec elles. Leur faire confiance, ne pas se substituer à elles pour déterminer ce
qu’il convient de faire dans les cas limites, ceux des troubles et des malformations
les plus graves, les aider à assumer leur choix. Respecter tous les droits des personnes
handicapées, les faire bénéficier d’une solidarité collective qui leur est due.
Mobiliser tous les moyens nécessaires à leur accueil digne et chaleureux, à leur
épanouissement maximal, à leur insertion naturelle au sein de la cité, quand cela se
peut. Sinon, créer les conditions pour que, malgré tout, puisse se produire le prodige
du regard aimant libéré par lequel une mère, un père manifestent toute la dignité du
lien à leur enfant.
L’autre au sortir de la vie
Plus encore que le mythe de l’immortalité, c’est celui de l’éternelle
jeunesse qui fait rêver. A défaut d’éternité, la plupart des humains se
satisferaient de vivre jeune tout au long de leur existence, même si celle-ci doit être
de durée limitée. A l’inverse, un vieillissement continu que rien
n’interromprait jamais serait une malédiction. La mort apparaîtrait alors des plus
désirables. De tout temps les poètes ont chanté la beauté et les plaisirs de la
jeunesse, les misères de la vieillesse. Encore celles-ci étaient-elles jadis en partie
atténuées par l’intégration des anciens au tissu familial, la réputation de
sagesse dont ils jouissaient, le respect qu’on leur portait. Ce sont ces « lots de
consolation » que semblent avoir perdus nos vieux d’aujourd’hui. Le monde
appartient, je l’ai déjà rappelé, aux personnes jeunes, belles, actives et
productives. Les sujets âgés, déjà dépourvus d’avenir, sont aussi de plus en
plus dépossédés d’une raison d’être au présent.
Si la mort est un échec, la vieillesse est vécue comme un désastre, qu’il faut
masquer, lui aussi. D’abord, tout mettre en œuvre pour en cacher les stigmates
sur le corps : l’hygiène de vie, les onguents, les teintures, les soins, les
implants, les prothèses, la chirurgie sont successivement mis en œuvre pour y
pourvoir. Puis, lorsque la peau parcheminée, les cheveux rares, les chairs flasques, la
démarche hésitante, la vue basse, l’audition dégradée, les mains tremblantes et
la voix chevrotante ne peuvent plus être dissimulés, c’est le vieillard que
l’on retranche de la cité, que l’on enferme dans sa chambre, à l’hospice
ou à la maison de retraite : il s’agit d’épargner ce spectacle déprimant aux
citoyens actifs, et donc pleinement vivants. Il se dit même de plus en plus que la
vieillesse est une déchéance qu’il serait légitime d’éviter en reconnaissant
à chacun le droit de mourir « dans la dignité », c’est-à-dire avant que
d’être vieux. Notre société aspire à la fois à l’immortalité des êtres
jeunes et à l’euthanasie des grands vieillards, deux manières d’exorciser les
défaillances de la médecine triomphante, la sénescence et la mort.
Des moyens considérables ont de ce fait été mobilisés pour des ans réparer
l’irréparable outrage. Grâce à l’hygiène, aux cosmétiques et à la
médecine, de grands succès ont déjà été remportés contre le vieillissement ; les
sexagénaires, jadis ancêtres cacochymes, sont souvent de nos jours des citoyens actifs
et fringants. Grâce à l’ingéniosité des biologistes de la reproduction, les
femmes peuvent mettre des enfants au monde à cet âge. Il n’empêche, vieillir, plus
lentement que jadis, et mourir, en moyenne, de plus en plus vieux, restent des invariants
de la condition humaine. L’augmentation de la longévité et la réduction
concomitante de la natalité aboutissent même à l’accroissement de la proportion
des personnes âgées : la collectivité, hantée par l’image de la jeunesse,
vieillit, cela contribuant à ceci. Le déni de cette réalité la conduit à privilégier
un modèle de plus en plus inadapté à ce qu’elle sera. L’assise des
bénéficiaires risque donc d’en être de plus en plus réduite, malgré les
promesses alléguées de la génétique et des cellules souches. La médecine et la
biologie ne seront pas à elles seules suffisantes pour surmonter ce problème : il y
faudra aussi de la lucidité, celle d’accepter l’humanité telle qu’elle
devient, riche de la coexistence entre souvent quatre générations solidaires.
Si chacune d’entre elles, en particulier celle des aînés, perçoit dans le regard
des autres la justification de son existence, de la considération pour le rôle
qu’elle joue dans la cohérence du tissu humain, alors l’essentiel sera
préservé. Chaque âge se verra reconnu son anneau électif d’épanouissement,
chacun enlacé comme dans le symbole olympique, plus près du début ou plus près de la
fin.
Au total, tout témoigne de ce que l’individu n’existe que par l’autre, en
fonction de l’autre dont le pouvoir tient à son unicité, à sa différence avec
tous les êtres qu’il contribue à édifier autant qu’il est façonné par eux.
La différence est féconde et, pour qui en prend conscience, l’altérité radicale
est richesse. A ce titre, l’indifférence ou le rejet sont amputations.
Une transformation par la personne
différente
Jean Vanier
Merci, Professeur Kahn, pour votre exposé si profondément humain. Je me sens en parfait
accord avec ce que vous dites de l’altérité : nous nous construisons à travers
notre relation avec l’autre. Cette construction qui nous amène à grandir en
humanité est parfois très difficile. La relation peut nous faire peur, car l’autre
est différent. L’étranger m’enrichit quand il y a une base de confiance
mutuelle, mais comme vous le dites, il peut aussi devenir l’ennemi à abattre pour ne
pas être abattu moi-même.
J’ai rencontré il y a peu de temps une assistante à l’Arche qui m’a
confié qu’elle avait eu peur de la relation, car ses parents étaient toujours en
conflit. Elle a décidé, jeune alors de consacrer toutes ses énergies au succès et de
fermer son cœur à toute relation. Elle a réussi dans ses études et sa vie
professionnelle. À l’âge de trente ans cependant elle a senti un malaise en elle ;
elle s’est rendu compte qu’elle portait un masque. Puis, un jour elle est
entrée dans une communauté de l’Arche. Elle a découvert la relation qui libère et
qui ouvre le cœur.
La question est comment transformer nos énergies tendues vers le succès personnel et le
désir de gagner plus d’argent et de pouvoir, en des énergies qui nous ouvrent aux
autres, spécialement aux personnes les plus faibles de notre grande famille humaine.
Je suis touché de ce que vous dites des enfants ayant un handicap qui peuvent devenir
source de joie pour leurs parents et source d’enrichissement et d’humanisation
pour les élèves d’une classe. C’est ce que nous découvrons dans nos
communautés de l’Arche et de Foi et Lumière.
En 1979 dans l’un de nos foyers de l’Arche à Trosly, nous avons accueilli
Françoise. Elle avait 46 ans et souffrait de lourds handicaps mentaux. Elle avait peu
d’autonomie : elle ne parlait pas, ne pouvait pas manger seule et marchait avec
beaucoup de difficultés. Aujourd’hui elle a 74 ans ; elle est devenue aveugle et ne
quitte que rarement son lit ; elle manifeste sa joie ou ses difficultés et ses angoisses
par de petits cris. Ceux qui vivent avec elle dans le foyer l’aiment beaucoup et
l’appellent « notre petite mamie ». Ils cherchent à comprendre ses cris.
Françoise est la joie de son foyer. Dans sa grande pauvreté, elle humanise ceux qui
l’entourent et qui sont si attentifs à tous ses besoins. Leur relation avec elle
semble les transformer.
Quand un de mes amis, un homme d’affaire parisien, a su que sa femme avait la maladie
d’Alzeihmer, il n’a pas voulu la mettre dans une institution. Il a décidé de
la garder chez eux. Il lui donne le bain, la nourrit, lui prodigue tous les soins dont
elle a besoin. Il m’a dit : « je suis devenu plus humain. »
Quelle est cette œuvre d’humanisation qui se réalise quand nous ouvrons notre
cœur aux plus faibles ?
Nous sommes aujourd’hui dans une culture qui met à l’honneur
l’individualisme et la jeunesse éternelle : la beauté du corps, le succès, le
pouvoir et l’autonomie. La lutte pour le succès personnel tend à durcir les
cœurs et à enfermer les gens sur eux-mêmes. Elle incite au mépris des faibles mais
aussi de ceux qui sont différents.
L’écart entre les personnes en bonne santé et celles qui ont un handicap est un
signe de l’écart grandissant dans nos sociétés et dans le monde entre riches et
pauvres, forts et faibles, puissants et impuissants. Un mur épais semble les séparer.
Parfois ceux qui sont du côté des riches cherchent à accroître leurs richesses et
s’enferment dans la recherche du pouvoir et du confort, dans l’élitisme et
l’autosatisfaction. Ils ont beaucoup de mal à entendre le cri des faibles et des
pauvres. Ce cri les dérange. Ils vont donner de l’argent pour de « bonnes causes
», ou apporter leur appui à des causes parfois politisées pour éviter des troubles. De
l’autre côté, les personnes marginales, elles, sont souvent en colère ou
enfermées dans des formes de dépression et d’angoisse. Elles ont perdu confiance
non seulement dans ceux qui ont le pouvoir mais aussi en elles-mêmes ; elles ont du mal
à trouver les attitudes justes et des mots pour dialoguer. Dans son livre « Attente de
Dieu », Simone Weil parle de cette souffrance des faibles en face du pouvoir. Leur
langage est souvent celui de la violence. Mettre le feu à des voitures leur semble
parfois la seule façon d’exprimer le feu de leur angoisse et de leur souffrance.
Une culture qui n’honore que la beauté physique, l’autonomie, l’excellence
et la liberté individuelle, tend à mépriser et à éliminer les faibles. N’est-ce
pas la raison pour laquelle une très grande majorité des femmes qui savent qu’elles
portent dans leur sein un enfant atteint d’une trisomie 21 décident le plus souvent
d’avorter. Souvent elles y sont acculées. Elles n’imaginent pas le bonheur que
leur enfant pourrait leur procurer, s’il y avait les services nécessaires pour
l’accueillir et l’aider à développer tout son potentiel, et si elles étaient
entourées d’un réseau d’amis. Les lois en faveur de l’insertion des
personnes atteintes d’un handicap sont bonnes mais il faut aller plus loin. Le
différent et le faible sont en quête d’une vraie reconnaissance d’amitié,
d’un accueil du cœur. A cette condition seulement ils pourront déployer les
dons qui jaillissent de leur faiblesse. Mais la peur du différent demeure.
Notre communauté de l’Arche à Trosly accueille régulièrement des jeunes des
lycées environs. Ils viennent pour découvrir les personnes ayant un handicap mental. À
la fin de leur visite dans les foyers et les ateliers, nous demandons à chacun
d’écrire ses impressions. Tous sans exception disent qu’ils avaient peur de
rencontrer les personnes atteintes d’un handicap. Mais leur visite d’une
journée a changé leurs cœurs ; ils ont découvert la beauté et la simplicité des
personnes ayant un handicap.
Ma vie à l’Arche depuis plus de 40 ans et ma connaissance des parents des personnes
avec un handicap dans le cadre de Foi et Lumière, m’ont fait découvrir un monde de
souffrances parfois intolérables. Je n’ignore pas combien il est difficile
d’accueillir des personnes différentes. En même temps j’ai pu constater
qu’à travers la souffrance, la vie grandit et circule. L’effort de
l’accueil, l’aide des professionnels et l’engagement de chacun dans un
réseau d’amis amènent à une célébration de la vie
Partout dans le monde, sur tous les continents les personnes démunies crient pour être
reconnues et soutenues. Pouvons-nous continuer à nous enfermer dans notre confort et
notre classe sociale en oubliant le cri des pauvres et des faibles. Est-ce en fuyant la
réalité de la souffrance humaine que nous devenons plus humains ? Le refus de rencontrer
le différent et le faible conduit souvent au mépris du faible et au durcissement du
cœur et puis au désir de les supprimer. Le danger d’eugénisme demeure dans
toutes les cultures, souvent pour des motifs économiques.
Vous l’avez bien dit, Monsieur le Professeur, la rencontre de personnes venant de
différentes cultures est un enrichissement. J’ose affirmer que ces rencontres
permettent non seulement un enrichissement mais une transformation du cœur. Nos
sociétés ne peuvent devenir vraiment humaines que si nous ouvrons nos cœurs à ceux
qui sont différents, si nous œuvrons ensemble pour la justice envers les plus
faibles et si nous cessons les rivalités entre puissants qui conduisent aux conflits et
à la guerre. C’est seulement alors que nous retrouverons le vrai sens de la vie.
Pour cela, il faut créer à tous les niveaux des conditions pour que naissent des
rencontres et des dialogues faits de confiance mutuelle. C’est seulement à cette
condition que peut naître un sens nouveau de la vie et une véritable espérance de paix
dans nos pays et dans le monde.
Dans « Le Petit Prince », le renard dit : « l’essentiel est invisible pour les
yeux. On ne voit bien qu’avec le cœur »… La rencontre qui implique une
écoute vraie, une tendresse et un respect profond, change nos cœurs, nous ouvre et
nous transforme. Un bénévole de l’association « Aux captifs la Libération »,
m’a confié combien il avait été changé en écoutant les souffrances et la vie
horrible des hommes et des femmes pris dans la prostitution au Bois de Boulogne. Dans leur
livre « Quand l’exclu devient l’élu », Michel et Colette Collard nous disent
comment ils ont été transformés par de vraies rencontres faites de présence et
d’écoute avec des hommes et des femmes de la rue dont ils partagent la vie.
Nous ouvrir à celui qui est dans la misère, écouter son histoire et le comprendre, tout
cela éveille des forces profondes dans notre cœur humain. Ce sont les forces de
l’amour et de la compassion. Aimer n’est pas juste une émotion. Aimer implique
une véritable sagesse humaine, une compétence et une intelligence du cœur. Aimer
c’est percer les murs du découragement et du manque de confiance en soi qui habitent
le cœur du pauvre, pour lui révéler sa beauté, sa valeur et l’aider à
retrouver confiance en lui-même. Aimer, c’est créer des liens de fidélité, se
réjouir de l’existence de l’autre dans toute sa faiblesse et sa différence ;
c’est voir la personne derrière le handicap, derrière la différence.
Nous découvrons alors que le plus faible – qui peut être aussi une personne âgée,
malade, sans travail, accidentée, quelqu’un se sent seul et abandonné – est
celui qui peut guérir l’endurcissement de nos cœurs, si nous acceptons
d’entrer en relation avec lui. Il nous permet de retrouver notre propre unité
intérieure. Il nous aide à accueillir ce qui est faible et vulnérable en nous-mêmes.
C’est à ce moment-là que nous devenons vraiment libres, libres d’être ce que
nous sommes : riche de nos dons, de nos faiblesses et même de notre mortalité. Libres de
ne pas nous laisser contrôler par nos peurs et nos préjugés ni par nos compulsions de
pouvoir : libres de ne pas nous laisser enfermer derrière les murs sécurisants de notre
culture qui favorise les forts. Libres d’aimer chaque personne comme elle est.
Permettez-moi de me tourner au delà de la sagesse humaine vers la sagesse de
l’Évangile. Je m’adresse alors à vous qui, dans cette cathédrale de Notre
Dame, êtes disciples de Jésus.
Le Verbe qui s’est fait chair, Jésus, était souverainement libre. Il a traversé
les murs qui enferment chaque culture, pour aller à la rencontre de la personne en
elle-même, la plus faible, la plus rejetée, la plus éloignée de Dieu. Il a aimé
chacune et l’a libérée pour aimer à son tour chaque personne, quelles que soient
ses faiblesses, sa religion, sa culture, ses capacités ou ses incapacités. Son message
est un message d’amour.
Luc dans l’Évangile montre Jésus qui regarde la ville de Jérusalem et pleure sur
elle, en disant « si seulement tu avais compris toi aussi, le message de paix ! Mais non.
Il est demeuré caché à tes yeux. » (Lc 19,41)
Tout le désir de Jésus est de nous rassembler tous dans l’unité : « Aimez vos
ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent, soyez compatissants comme mon Père
est compatissant. Pardonnez. » (Lc 6,27.36) « Quand tu donnes un grand repas, invite des
pauvres, des estropiés, des infirmes et des aveugles … et tu seras béni. » (Lc
13,13) Jésus raconte la parabole de Lazare et l’homme riche et celle du Bon
Samaritain, qui s’arrête auprès de l’homme roué de coups et il nous dit «
faites de même ». Jésus nous appelle à accueillir lui-même dans le pauvre et le
faible : « Tout ce que tu fais aux plus petits des miens, c’est à moi que tu le
fais. » (Mt 25)
Nous, qui sommes disciples de Jésus, qu’avons-nous fait de ce message d’amour
et de paix ? Nous savons que c’est difficile d’aimer ceux qui sont différents ;
nous sommes conscients des murs de peur qui protègent nos cœurs et nos groupes.
Comment nous libérer de ces enfermements ? Jésus nous promet de nous envoyer une force
nouvelle, un souffle nouveau, le Paraclet, l’Esprit de Vérité. L’Esprit Saint
Lui-même transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Cela nous demande
d’entreprendre pour notre part tout un travail intérieur, de chercher à être
libéré des semences de haines, du mépris et des préjugés cachés en nous-mêmes et
d’oser prendre le risque de rencontrer ceux qui nous font peur.
Qu’avons-nous fait de ce message de Jésus ? Qu’est-ce que je fais, moi, de ce
message de paix ? Viens, Seigneur Jésus, viens ! Dans notre monde divisé et déchiré,
fais de nous des artisans de paix et d’unité !
Jean Vanier L’Arche 60350 Trosly-Breuil
La modernité et après ?
Egalité, laïcité, foi inébranlable en l’individu et en la science… la
modernité est née avec la pensée des Lumières, au XVIIIe siècle. Que reste-t-il de
cet héritage aujourd’hui et quelles sont ses limites pour appréhender le monde
contemporain ? Entretien avec Edgar Morin et éclairages de Gilles Lipovetsky, sociologue,
de Didier Sicard, président du Comité d’éthique, et de l’artiste Olivier Py.
Moderne », un mot qui veut tout dire ! Un attrape-tout à géométrie variable, qui
qualifie aussi bien la branchitude la plus superficielle que les droits de l’homme.
Moderne se prétend le management des entreprises, qui réduit les métiers à des
fonctions, moderne se dit une démocratie imposée par les armes, réfractaires à la
modernité seraient les jeunes qui brûlent les voitures, les électeurs qui votent non à
l’Europe, etc. Bref, on se paye de mots. Tantôt épouvantail, tantôt étendard, la
« modernité » désigne à la fois la « perte des repères » – que nous
déplorons – et l’idéal de la civilisation occidentale – que les autres
refusent. S’empoigner sur le dos de ce concept mou, où nous sentons confusément se
jouer quelque chose de notre identité, est bien le signe des temps lourds et des ciels
bas.
Mais de quoi parlons-nous exactement ? Si nous reprenons la terminologie des historiens,
les temps modernes commencent en gros avec la chute de Constantinople, en 1453. Si nous
cherchons une définition, on dira que la « modernité » est un mouvement
d’émancipation, entamé à la Renaissance, qui s’énonce et se synthétise au
XVIIIe siècle en Europe avec les Lumières : Rousseau, Voltaire, Diderot… mais aussi
l’Anglais Adam Smith, l’« inventeur » de l’économie, et le philosophe
Emmanuel Kant en Prusse, et tant d’autres. Au centre de leur pensée, une rupture :
celle du temporel et du spirituel, le gouvernement des hommes devant leur revenir et non
plus à Dieu. L’individu n’est plus « sous tutelle », ni de sa naissance, ni
de forces magiques, ni des traditions. Le monde, n’étant pas dessein divin, est
connaissable, l’univers déchiffrable par les seules voies de la raison et de la
science. Les citoyens sont égaux en droits, l’homme est partout le même, le
bien-être de l’humanité, et non plus le salut de l’âme, devient le but de
toute action humaine. L’avenir est à construire devant nous et non dans les recettes
de la tradition à appliquer. Voilà le credo. Théorique.
Après, ça se complique ! La Révolution, qui mène finalement à l’établissement
durable de la république, passe aussi par la Terreur. Le culte de la raison, qui fait
avancer la science, a produit aussi les pensées instrumentales à l’œuvre dans
les camps d’extermination du XXe siècle. L’universalisme a justifié conquêtes
et colonisations, les libertés de l’individu, creusé la solitude du consommateur,
la révolution industrielle, fabriqué du travail à la chaîne... Au nom des Lumières,
que d’obscurité ! L’ère moderne est ainsi une histoire en crise, c’est sa
nature. Elle n’est que conflits, tensions, retournements, déchirements des
certitudes par les doutes. Une histoire d’élans brisés. L’homme moderne
n’est pas un homme tranquille. Il faut s’y faire !
L’héritage des Lumières, qu’explore une exposition à la Bibliothèque
nationale de France et sur lequel Télérama propose un numéro hors-série ce mois-ci,
est donc à revoir comme un éternel problème d’actualité, et non à brandir comme
un catéchisme de valeurs immuables devenues traditions – ce serait adopter la
démarche régressive des intégristes de tout poil. « Qu’est-ce qu’être
moderne ? » ne se pose pas aujourd’hui dans les mêmes termes qu’au XVIIIe
siècle. Le mot « moderne » est devenu imparfait pour suivre les bouleversements de tous
ordres intervenus au XXe siècle, depuis ses grandes barbaries jusqu’au
développement ultrarapide des technologies. On a cherché d’autres mots pour dire
ces changements de civilisation. Jean-François Lyotard, dans les années 70, a lancé le
« post-modernisme », qui, prenant acte de la faillite des « grands récits
idéologiques », invite au relativisme généralisé, à l’expression des
subjectivités, à la jouissance de l’éphémère, au recyclage plutôt qu’à la
recherche du nouveau.
Mais peu nous importent ici les étiquettes pour constater que nous sommes devenus des
modernes pas dupes de la modernité, tentés de renouer le fil avec l’ancien,
déniaisés des utopies avec nos besoins d’espoir en panne. Qu’est-ce
qu’être moderne, alors, si ce n’est, à défaut de croire au progrès, essayer
de vivre avec son temps ? Ni contre, ni pour, ni sans, juste avec. Il ne s’agit pas
de suivre le mouvement, encore moins de se réfugier dans le regret de mythiques âges
d’or. Il s’agit seulement de vouloir comprendre le présent, de se donner le
choix « d’acquiescer ou de résister », comme disait Rousseau. Si nous « revenons
» aux Lumières, c’est peut-être pour cette seule qualité : leur esprit critique.
Qu’est-ce qu’être moderne ? Nous avons posé la question au sociologue Gilles
Lipovetsky, fin observateur des paradoxes de l’individualisme, au médecin Didier
Sicard, qui, en tant que président du Comité consultatif national d’éthique, a
pensé les limites du progrès, au dramaturge et metteur en scène Olivier Py, qui
s’interroge sur le sens de la création contemporaine. Enfin, il nous fallait
entendre un authentique « homme des Lumières » : c’est chose faite avec Edgar
Morin.
A lire
Les Lumières, des idées pour demain, hors-série de Télérama (116 pages, 7,50 euros)
Catherine Portevin
“L’aspect euphorique des Lumières est en
crise”

Penseur de la complexité du réel et chercheur de la pluralité des
hommes, Edgar Morin se définit comme un « braconnier des savoirs ». Esprit universel,
il revisite les valeurs du XVIIIe siècle et en appelle à la fraternité.
Télérama : Quelle place accordez-vous aujourd’hui à l’héritage des Lumières
?
Edgar Morin : On l’invoque aujourd’hui en réaction à la montée d’un
obscurantisme, essentiellement religieux, comportant des régressions fanatiques. Ceux qui
plaident pour un retour aux Lumières se réfèrent à une source lumineuse qui est esprit
d’ouverture et de tolérance. Je revendique, évidemment, cet héritage, mais je
crois qu’il faut aller au-delà des Lumières. Au-delà signifie à la fois conserver
et dépasser. Il faut par exemple accepter l’idée que notre raison ne peut pas tout
illuminer, que l’esprit humain a des limites. Dans les Lumières, il y a trop de
lumière. En réalité, la lumière suppose de l’ombre autour, du mystère, voire de
l’inexplicable. Il faut concevoir qu’il n’y a pas de raison pure, mais une
dialogique incessante entre le rationnel et l’affectif – c’est déjà ce
qu’évoquait Rousseau. A la rationalité critique qui s’est développée à
l’époque des Lumières, il faudrait ajouter une rationalité autocritique elle-même
née aux débuts des temps modernes avec Montaigne, mais toujours minoritaire.
Télérama : Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise ces temps modernes ?
Edgar Morin :Il est impossible de définir la « modernité » par un maître mot. Sur le
plan des idées, elle commence à la Renaissance avec la redécouverte de
l’Antiquité grecque et d’une philosophie qui n’est plus la servante de la
religion. La modernité, c’est l’ouverture des esprits à tous les savoirs,
l’essor de la science, celui de la technique. Le conflit entre la foi et la raison,
typiquement moderne, trouve son centre dans l’œuvre de Pascal au XVIIe siècle.
Historiquement, la modernité est à la fois productrice et produit de l’ère
planétaire, qui commence avec les grands voyages autour du monde et la conquête des
Amériques. La modernité naît en fait de la conjonction de plusieurs dimensions, non
seulement intellectuelles et idéologiques, mais aussi politiques (la constitution des
nations modernes), économiques (l’essor du capitalisme et des villes), sociales (le
développement de la bourgeoisie puis du prolétariat), techniques (la révolution
industrielle). C’est en même temps la laïcisation des esprits et des Etats. Les
Lumières ont joué évidemment un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces voies
ouvertes à la Renaissance. Il faut maintenant revoir cet héritage en tenant compte de ce
qu’il a produit et de ce que nous affrontons aujourd’hui.
Télérama : Qu’est-ce qui à vos yeux est le plus brisé dans cet héritage ?
Edgar Morin : Ce qui est vraiment brisé, mais n’apparaît pas encore de façon
vraiment consciente, est l’assurance d’une rationalité close,
c’est-à-dire la prétention de l’Occident à incarner seul la raison tandis
qu’ailleurs tout ne serait que superstitions, erreurs et illusions. La rationalité
souffre d’une maladie infantile qu’on peut appeler la « rationalisation », qui
conduit à élaborer un système tout à fait logique mais fondé sur des bases limitées
ou erronées. Ainsi, nous avons cru – et ce jusqu’au XXe siècle – que les
peuples dits « primitifs » étaient enfermés dans le mythe et la pensée magique. Or,
leurs techniques, notamment de chasse, leur connaissance des vertus des plantes nous
montrent une rationalité qui coïncide avec leurs mythes. Toutes les sociétés, dont la
nôtre, comportent une part rationnelle et une part mythologique. Les Lumières
elles-mêmes ont mythifié la Raison et le Progrès.
Télérama : La raison séparée de la foi, c’est pourtant une idée essentielle pour
la séparation de l’Etat et des Eglises, pour la démocratie...
Edgar Morin : Bien sûr ! Et il est vrai que dans l’Europe occidentale s’est
développé l’humanisme moderne, comportant les principes de démocratie, de
tolérance, de droits des hommes, plus tard de droits des femmes. Ce sur quoi
j’insiste, c’est que cette Europe, foyer des idées émancipatrices dont les
colonisés eux-mêmes s’empareront pour réclamer leurs droits à
l’indépendance et à la reconnaissance de leur pleine humanité (on le voit bien
aujourd’hui dans les revendications des descendants d’esclaves), a été aussi
le foyer de la domination la plus longue et la plus dure sur le monde, qui commence au
XVIe siècle et ne s’achève qu’à la fin du XXe siècle.
Télérama : Plus généralement, n’est-ce pas notre foi dans le progrès qui est
mise à mal ?
Edgar Morin : En tout cas, le progrès conçu comme une nécessité historique
inéluctable. Ce progrès-là est mort et c’est une idée clé de la modernité qui
s’effondre. Désormais, le nouveau n’est plus nécessairement meilleur que
l’ancien, ni même bon en soi, et même, dans certains cas, on constate qu’on ne
peut plus faire du nouveau. La philosophie de la modernité, telle qu’elle est bien
exprimée par Descartes, donne à la science la mission de faire de l’homme le «
maître et possesseur de la nature », idée reprise par Buffon au siècle des Lumières,
puis par Marx. Cette croyance dans la maîtrise de la nature est devenue absurde
puisqu’on sait qu’elle conduit à la dégradation de la biosphère, qui
elle-même se répercute sur les vies humaines et menace le destin de l’humanité.
Autrement dit, l’aspect euphorique des Lumières est en crise.
Télérama : Et maintenant, que fait-on de cette crise du progrès ? Un « no future » ?
Edgar Morin : Le progrès comme certitude est mort, mais le progrès comme possibilité
demeure. On peut croire à un progrès possible en le sachant réversible, et il doit
être toujours régénéré. En Europe, la torture a été supprimée au XIXe siècle
– pour les Européens, bien sûr, pas pour les autres ! ; au XXe siècle, elle a
réapparu dans tous les pays d’Europe. Prenons la démocratie. La France, qui a
proclamé d’une façon grandiose la démocratie, est tombée dans une dictature de
salut public, puis il y a eu le bonapartisme, l’Empire, la Restauration... La
démocratie est une régime fragile et difficile. Elle n’est pas que la loi de la
majorité, elle comporte aussi le respect des minorités.
Télérama : Comment alors concilier progrès et précaution ?
Edgar Morin : Le principe de précaution est nouveau pour nous et nous ne savons pas bien
le situer encore par rapport à cet optimisme conquérant auquel nous n’avons pas
encore vraiment renoncé. Je pense à une formule de Périclès : « Nous autres
Athéniens, nous unissons la hardiesse et la prudence alors que les autres sont soit
téméraires, soit couards. » Il faut unir le principe de précaution à un principe
d’audace et il n’y a pas de formule magique pour cela. Je suis en tout cas
persuadé que si le vaisseau spatial Terre continue d’être emporté par ses quatre
moteurs sans pilote – la science, la technique, l’économie, le profit –,
nous allons vers de multiples catastrophes. Pour conserver l’humanité, il faut la
révolutionner et, ici, la précaution est dans la transformation. Un monde est en train
de mourir mais ne meurt pas, et un monde veut naître mais n’arrive pas à naître.
Télérama : Sommes-nous des modernes fatigués de l’être ?
Edgar Morin : La modernité est toujours conflictuelle, faite de continuités et de
ruptures. Elle est complexe et ambivalente. Les expressions « postmodernité » et «
modernité tardive » expriment chacune un aspect de notre situation, mais les
transformations en cours ne nous permettent pas encore de définir le nouveau visage de
notre époque. Nous voyons bien que les grands principes unificateurs modernes (la
technique, l’économie mondialisée, la communication...) fabriquent de
l’uniformité plus que de l’unité. L’universalisation de la civilisation
occidentale suscite des adhésions matérielles (techniques, économiques...) en même
temps que des rejets profonds dans plusieurs pays du monde, qui, pour sauvegarder leur
identité et dans la perte de l’espoir d’un avenir nouveau, se referment en des
régressions religieuses ou culturelles. Or, si nous voulons échapper à
l’alternative funeste entre unité et diversité, il nous faut penser que
l’unité humaine comporte de la diversité et que la diversité humaine comporte de
l’unité.
Télérama : Parmi les hommes des Lumières, duquel vous sentez-vous le plus proche ?
Edgar Morin : Je ne peux pas choisir Voltaire contre Rousseau ou Rousseau contre Diderot.
Je ne suis satisfait qu’en les embrassant tous. Mais, en fait, je me sens plus proche
de l’esprit de la Renaissance. J’aime l’esprit polyvalent de Léonard de
Vinci, qui était peintre, ingénieur, inventeur. Aujourd’hui, on dit que ce
n’est plus possible car les savoirs se sont multipliés, affinés, cloisonnés
jusqu’à découper la réalité en petits morceaux. Moi qui aime me définir comme un
« braconnier des savoirs », je milite pour une pensée qui relie, c’est-à-dire
complexe. Une phrase de Pascal, que j’aime particulièrement, est pour moi la clé :
« Toute chose étant médiate et immédiate, causée et causante, je tiens impossible de
connaître la partie si je ne connais le tout, ni de connaître le tout si je ne
connaissais les parties. » Et, au-delà de la connaissance, reste le pari de Pascal sur
ce en quoi l’on croit. Je ne parie pas comme lui sur l’existence de Dieu, mais
sur la fraternité humaine.
Télérama : Mais, pour se sentir frères, il faut avoir une mère ou un père commun. Si
le père n’est ni Dieu, ni le roi, ni la nation, quel est-il ?
Edgar Morin : Ce n’est pas par hasard que j’ai intitulé un de mes livres :
Terre-patrie. La Terre est la matrice dont nous sommes issus. L’humanité planétaire
est désormais liée par une communauté de destin. L’ultime mondialisation a créé
les infrastructures d’une éventuelle « société-monde », mais elle empêche cette
société-monde d’advenir.
Télérama : Dans « Liberté, Egalité, Fraternité », c’est souvent la fraternité
qu’on oublie...
Edgar Morin : La liberté, on peut l’instituer. L’égalité, on peut
l’imposer. Mais la fraternité, non. Elle ne peut venir que d’un sentiment vécu
de solidarité et de responsabilité. Et pourtant, la fraternité est ce qui fait tenir le
triptyque. La liberté seule tue l’égalité ; l’égalité imposée en principe
unique tue la liberté. Seule la fraternité permet de maintenir la liberté tout en
luttant contre les inégalités. Le problème est que la modernité a provoqué la
destruction de toutes les solidarités traditionnelles – la grande famille, la petite
famille, le village – et nous n’en avons pas vraiment créé de nouvelles, sinon
bureaucratiques comme la Sécurité sociale. Le développement de l’individualisme
est très positif pour l’autonomie et la responsabilité personnelle, mais il
s’accompagne d’un accroissement de l’égoïsme et de l’égocentrisme.
Et pourtant, la solidarité se manifeste (mais seulement de façon provisoire) lors
d’un grand désastre collectif (je pense à la mobilisation pour les victimes du
tsunami, du tremblement de terre de Mexico...). Nous avons soif, dans notre esprit, dans
notre âme, dans notre corps, d’une autre façon de vivre. La potentialité de
fraternité sommeille en nous. Comment la réveiller ? C’est une autre histoire...
Propos recueillis par Véronique Brocard et Catherine Portevin
Edgar Morin vient de publier Culture et barbarie européennes (éd. Bayard, 96 p., 13,80
€) et Ethique, dernier des six volumes de La Méthode, son œuvre majeure (éd.
du Seuil, 240 p., 20 €).
Télérama n° 2929 - 2 mars 2006

Né en 1913 à Basse-Pointe, Aimé Césaire a été pendant un demi-siècle maire de
Fort-de-France et député de la Martinique.
“Nègre je resterai”
Aimé Césaire qui sut toujours entremêler devoir poétique et art politique demeure à
92 ans la voix de toutes les victimes du colonialisme, le chantre de la négritude et de
sa terre tant aimée, la Martinique. Combat qu’il définit ainsi : liberté,
égalité, identité. Rencontre à Fort-de-France.
Tous les jours, le même rituel. Le coup de Klaxon du chauffeur. La voiture qui entre dans
la cour de l’ancien hôtel de ville de Fort-de-France, aujourd’hui écrin coquet
du théâtre municipal. Et puis, la secrétaire d’Aimé Césaire, qui guide les pas
hésitants du vieil homme, bras dessus, bras dessous, jusqu’à sa table de travail. A
92 ans, l’ancien maire et député de Fort-de-France a conservé son bureau, comme un
ultime honneur. Dans ce refuge encombré de cadeaux et de souvenirs divers (des statuettes
africaines, un maillot du footballeur Lilian Thuram accroché au mur dans un
sous-verre…), Aimé Césaire accueille ses visiteurs sans rendez-vous et sans
protocole. Comme un Saint Louis des tropiques tenant audience, il reçoit des
célébrités de la planète qui ont fait parfois des milliers de kilomètres pour
rencontrer l’un des derniers grands mythes de la littérature du XXe siècle. Il y a
aussi – surtout – des anonymes, comme ce couple de métropolitains, venu tôt ce
matin pour une dédicace. Et aussi des Martiniquais modestes, jeunes ou vieux admirateurs
de « papa Césaire », qui attendent patiemment dans l’antichambre. « Ce sont des
amis. Ils me parlent de leurs problèmes… dit en nous accueillant l’écrivain,
des problèmes auxquels je n’ai moi-même pas de réponse ! »
L’écrivain arbore son éternel costume-cravate impeccable, à l’élégance
surannée. Derrière ses grandes lunettes rondes et dorées, pointent, comme deux billes
rondes, des yeux soucieux qui scrutent avec difficulté la silhouette du visiteur. Sous le
cheveu ras et neigeux, la peau anthracite de son visage est tendue comme un cuir, et
rajeunit le poète de dix ou quinze ans. Face à ses hôtes arrivant pétris
d’admiration, les bras chargés de compliments, le malicieux vieillard a mis au point
une technique assez efficace, l’esquive, qu’on dirait empruntée au compère
lapin, le héros rusé des contes créoles… Le journaliste intrépide ou ingénu
veut-il brasser une fois encore le siècle avec le grand homme, confronter son œuvre
et sa vie à l’histoire de la Martinique, de la France, du monde ? « Monsieur, votre
projet m’épouvante ! » lance-t-il chaque fois avec autant de malice que de
courtoisie.
Pour déjouer ce piège affectueux, il est temps d’avouer une botte secrète : notre
compagnon de voyage, Daniel Maximin, nous sert de guide ce matin-là. Ami et confident
d’Aimé Césaire, Daniel Maximin est non seulement un connaisseur hors pair de
l’œuvre de son maître, mais poète et romancier lui-même : il vient de publier
Les Fruits du cyclone (éd. du Seuil), une « géopoétique » de la Caraïbe, réflexion
érudite sur l’identité antillaise. Né en Guadeloupe, il y a cinquante-neuf ans,
Daniel Maximin a d’ailleurs trouvé l’une des plus justes définitions des
Antilles françaises, filles de quatre cents ans d’esclavage et de colonisation : «
tellement de blessures, en si peu de géographie ».
« Très bonne formule. Je la retiens ! » goûte Aimé Césaire, qui exècre «
l’exotisme » de carte postale dont sa Martinique, entre plages et cocotiers, est si
souvent parée. « Exotisme ? c’est le mot français. Mais pour moi, mon pays
n’est pas “exo”, “en dehors de”… C’est
l’intérieur que je cherche ! » s’exclame le poète, qui, d’André Breton
à André Malraux, a toujours pris soin de dessiller les yeux de ses visiteurs, leur
faisant apercevoir « le grand phénomène humain » martiniquais, au-delà de
l’exubérance végétale et de la « splendeur solaire » de son île : « La
Martinique paraît belle, sereine, même joyeuse… mais il y a, au fond, une
inquiétude, une douleur, que pour ma part je considère comme la nostalgie de quelque
chose. J’ai voulu trouver la nature de cette nostalgie, et tout mon effort politique
a été de prendre ça en compte. Autrement dit, j’ai toujours été hanté par
l’idée d’une identité antillaise… Il y a une civilisation française
autour de laquelle nous ne nous retrouvons pas pleinement. Elle n’a pas été faite
pour nous. Liberté ? Oui. Egalité ? A peu près. Fraternité ? Difficile à réaliser.
Mais il y a un mot qui est oublié : le mot identité. »
« Un nègre de la campagne », dit affectueusement Daniel Maximin pour définir son vieil
ami. Les racines d’Aimé Césaire, né à Basse-Pointe, dans le nord de l’île,
plongent effectivement dans la verte campagne des petites gens, des sans-grade. Une mère
couturière, un père petit fonctionnaire. Dans cette famille modeste, où
l’éducation a toujours été considérée comme une valeur sacrée, c’est «
maman Nini », la grand-mère d’Aimé, une maîtresse femme, qui lui apprend à lire.
Quand la famille Césaire s’installe à Fort-de-France, Aimé a une dizaine
d’années. Plus tard, au lycée Victor-Schœlcher, où il accumule les prix de
français, de latin et d’anglais, il se sent déjà à l’étroit dans cette
société coloniale corsetée, seul et mal à l’aise dans cette petite France où les
maîtres blancs et mulâtres sont racistes et arrogants : « Un monde de petits-bourgeois
qui m’a beaucoup irrité, se souvient encore aujourd’hui l’écrivain. Un
monde qui n’avait en réalité qu’une idée : l’européanisation. Ce
qu’ils appellent l’assimilation... »
Sa révolte, il va la baptiser « négritude ». Ce néologisme, inventé dès les années
30, dans la revue L’Etudiant noir, est en fait une création collective élaborée
avec ses deux compagnons d’études, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor et le
Guyanais Léon Gontran Damas. La négritude, qui a été souvent mal comprise, n’a
jamais été une idéologie. Pas même une célébration d’un mythique retour aux
sources africaines. Ce n’est pas l’Afrique que cherchait Césaire : il a attendu
1961 pour en fouler le sol et il y est retourné peu souvent. Non, la négritude de
Césaire n’est rien d’autre qu’une plongée en lui-même. Une exploration
de sa peau noire, de son « moi profond » et de la culture de ses ancêtres.
Cette quête ne s’est pas faite sans douleur, comme en témoigne
l’extraordinaire Cahier d’un retour au pays natal (éd. Présence africaine), ce
monument de 65 pages. L’œuvre fondatrice du poète. Aimé Césaire a une
vingtaine d’années quand il écrit ce sublime cri de révolte, poème lyrique contre
les « larbins de l’ordre et les hannetons de l’espérance ». Le jeune
boursier, l’enfant des colonies projeté dans le Paris des lettres, au lycée
Louis-le-Grand puis à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, hurle sa
soif de justice et de dignité : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont
point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du
désespoir. » Mais, chez le jeune et impétueux Césaire, jamais de haine envers les «
Blancs ». Seulement un refus obstiné de l’assimilation, ce venin qui dissout la
personnalité : « J’ai senti très vite que je n’étais pas un Européen, que
je n’étais pas non plus un Français, mais que j’étais un nègre. C’est
tout. Ce n’est pas plus compliqué que ça » (1).
Nègre né dans une « calebasse », dans une Martinique-confetti, au milieu de
l’océan : l’histoire et la géographie lui ont vite fait comprendre qu’il
allait grandir du côté des vaincus. « Nous ramassions des injures pour en faire des
diamants », disait magnifiquement René Ménil, le cofondateur avec Césaire de la revue
culturelle Tropiques. Une publication iconoclaste qui brillait dans la nuit noire des
années 40, dans la Martinique de l’amiral Robert, le « Pétain des Antilles ».
Comment s’étonner qu’au sortir de la guerre le poète réponde alors à
l’appel de la politique ? Quand ses amis communistes le sollicitent pour briguer la
mairie de Fort-de-France, Aimé Césaire se souvient de ses racines populaires : «
J’avais une dette. […] J’ai donné mon nom un peu comme l’intellectuel
qui aujourd’hui signe une pétition pour le peuple kurde » (2). Elu « par hasard
», le professeur de français hérite d’une ville sans égouts, entourée de
bidonvilles sans eau potable et sans électricité. Ce qu’il ne savait pas,
c’est qu’il restera… cinquante-six ans maire de cette ville et
quarante-sept ans député, jusqu’en 1993. Cela a donné forme, pour le meilleur et
pour le pire, au « césairisme » : un mélange de gestion sociale, de distribution de
prébendes et d’emplois municipaux. Mais de cette trajectoire singulière, on
n’oubliera pas non plus la rupture prophétique, dès 1956, avec le Parti communiste
français, dans lequel il ne se reconnaît plus. L’homme n’est pas prêt à
changer sa peau noire contre un masque blanc. « Nègre fondamental » il restera.
Statufié de son vivant, Césaire ? Certes, il l’est. Et l’universitaire
Françoise Vergès a bien raison de prôner « une lecture ni nostalgique ni idolâtre »
de son œuvre (3). Dans les années 90, les enfants terribles de Césaire, Patrick
Chamoiseau et surtout Raphaël Confiant, avec son essai au vitriol Aimé Césaire, une
traversée paradoxale du siècle (éd. Stock, 1993), se sont crus obligés de tuer le
père, peut-être pour mieux exister sous l’ombre tutélaire. Leur attaque en règle
de la négritude – remplacée par le concept de « créolité » et de métissage
– était, il est vrai, loin d’être stérile. Césaire, qui ne veut pas
entretenir la polémique, a peut-être deviné là, en creux, le plus bel hommage. Celui
d’être toujours vivant pour les jeunes générations, alors qu’il n’a pas
publié depuis de très longues années : « J’écris très peu, je suis très
fatigué. J’ai, en plus, la difficulté de lire », nous confie à regret le poète,
qui soutient difficilement une longue conversation. Césaire, Fanon, Glissant, Chamoiseau,
Confiant… Incroyable marmite de talents que cette petite Martinique de 400 000
habitants !
Aimé Césaire traverse ainsi le crépuscule de sa vie tel un monstre sacré, entré de
son vivant dans la grande histoire. Dégagé des responsabilités, il sait aussi
redescendre dans l’arène quand il le faut, pour remettre les pendules à
l’heure. Et avec quelle force ! En décembre dernier, avec un calme olympien, il a
cloué le bec à Nicolas Sarkozy et aux tenants de la loi de février 2005 sur la «
colonisation positive ». En refusant de recevoir le ministre de l’Intérieur, le
poète a grandement aidé la fronde qui montait : le président de la République a dû
finalement capituler et revenir, dans le dos du Parlement, sur cette loi qui prétendait
dire comment enseigner l’histoire. Colonisation positive ? Lisez ce qu’écrivait
Aimé Césaire en… 1955 dans son fameux Discours sur le colonialisme (éd. Présence
africaine), malheureusement toujours d’actualité : « On me parle de progrès, de
“réalisations”, de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus
d’eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures
piétinées, d’institutions minées, de terres confisquées, de religions
assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d’extraordinaires
possibilités supprimées… » Et ceci, encore : « Il faudrait d’abord étudier
comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l’abrutir, au
sens propre du mot, à le dégrader […] et montrer que chaque fois qu’il y a au
Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu’en France on accepte, un
Malgache supplicié et qu’en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation
qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s’opère, une gangrène
qui s’installe […], il y a le poison instillé dans les veines de l’Europe,
et le progrès lent, mais sûr, de l’ensauvagement. »
Tribun ou poète, Aimé Césaire n’a jamais voulu choisir. Ses pamphlets sont parfois
poétiques, ses poèmes souvent politiques. La cohérence, il faut la chercher dans le
parcours de cet homme. Inébranlable dans ses convictions. Eruptif, comme les volcans
qu’il aime tant. Explosif, comme la montagne Pelée de son île natale. Explosion,
c’est d’ailleurs le mot qu’il a souvent employé pour dire poésie : « Le
monde dans lequel nous vivons est un monde menteur. Mais il y a un être en nous qui est
là, il faut le trouver, le chercher, et lui permettre de s’exprimer. C’est la
poésie qui m’a permis ça. Je ne sais pas exactement ce que je pense, et d’un
coup c’est le poème qui me le révèle. Elle est là, l’explosion… »
On l’imagine fort et indéracinable comme un banian, le chêne des Antilles. Aimé
Césaire esquisse un sourire. Il se verrait plutôt aujourd’hui en « laminaire »,
cette algue ballottée sous l’eau mais, surtout, accrochée fidèlement à son
rocher, « et que rien ne peut enlever ». Césaire, le laminaire ? Voilà qui tranche
avec le « nègre de la campagne » qui a toujours tourné le dos à la mer, apeuré par
la vague menaçante de l’Atlantique qui ravage la côte et noie les hommes.
« La complexité humaine… » soupire le maître, qui, maudissant ses maux de tête,
met fin en douceur à l’entretien, en s’excusant. Dans le grand escalier
tournant du théâtre, le laminaire disparaît, à pas lents, arc-bouté à la rambarde de
l’escalier, repoussant la main de sa secrétaire venue lui prêter assistance.
Poésie : Moi, laminaire, éd. du Seuil, 1982 et La Poésie, éd. du Seuil, 2006.
Théâtre : La Tragédie du roi Christophe, 1963 et Et les chiens se taisaient, 1956, éd.
Présence africaine.
Aimé Césaire, chanté avec talent par Gérard Pitiot, au milieu d’autres poésies
afro-caribéennes : Chants pirogue, Productions spéciales.
Manifestation
La francophonie peut donner le pire comme le meilleur : des sommets de chefs d’Etat
au service de cette idée politique pas toujours très claire ou des manifestations qui
font vivre magnifiquement la diversité des cultures francophones. Jusqu’en octobre,
Francofffonies (avec trois f comme « fortississimo ») sera le creuset de dizaines de
rencontres et de spectacles, à commencer par la forte présence d’écrivains
francophones au Salon du livre, à Paris, du 17 au 22 mars. Francofffonies, manifestation
placée sous la houlette des pouvoirs publics, et notamment de l’Association
française d’action artistique (Afaa), célébrera aussi le centenaire de la
naissance de Léopold Sédar Senghor, le grand compagnon en négritude d’Aimé
Césaire.
Calendrier complet de la manifestation sur le site des francofffonies
Thierry Leclère
(envoyé spécial à Fort-de-France)
(1) Aimé Césaire, rencontre avec un nègre fondamental, de Patrice Louis, éd. Arléa,
2004.
(2) Le Nouvel Observateur, 1er février 2001.
(3) Nègre je suis, nègre je resterai,entretiens avec Françoise Vergès, éd. Albin
Michel, 2005.
Télérama n° 2931 - 15 mars 2006
Que révèle le contrat première embauche ?

Vingt-trois pour cent des moins de 25 ans au chômage. De stages gratuits en CDD, les
jeunes ont bien du mal à accéder à l’emploi stable, et à l’emploi tout
court. Avec le CPE (contrat première embauche), qui permet aux entreprises de licencier
tout nouvel entrant pendant deux ans, le gouvernement affirme ouvrir une piste
prometteuse. Il se targue de 280 000 emplois créés grâce à un contrat similaire
adopté en septembre dernier, le CNE (contrat nouvelle embauche), qui ne concernait que
les entreprises de vingt salariés au plus. A l’Assemblée nationale comme dans la
rue, l’opposition dénonce une politique qui précarise l’ensemble des
salariés, faisant peu à peu de ce qui était la règle – le CDI – une
exception. Mais pour l’économiste Bernard Perret, cette précarisation ne concerne
toujours qu’une même fraction, de plus en plus menacée, de la population
française.
Télérama : Comment expliquez-vous la mobilisation autour du contrat première embauche
alors que l’adoption à l’automne du contrat nouvelle embauche n’avait pas
suscité de telles vagues ?
Bernard Perret : Le CNE concernait l’embauche dans les entreprises de vingt salariés
au plus qui offrent majoritairement des emplois peu qualifiés. Le fait qu’il
n’y ait pas eu à l’époque de grandes protestations illustre un non-dit :
depuis des années, dans la société française, les mesures de flexibilité sont
supportées par les moins qualifiés, et notamment les plus jeunes. Ces derniers jours, si
la mobilisation se fait plus forte, c’est que le CPE concerne tous les moins de 26
ans, y compris les jeunes diplômés, les enfants des classes moyennes. On pourrait voir
un côté positif à ce contrat : tous les jeunes sont désormais logés à la même
enseigne.
Télérama : Mais la précarité épargne toujours de larges couches de salariés ?
Bernard Perret : Des blocs entiers de la population veulent bien du changement
économique, mais refusent d’en subir les conséquences : ce sont essentiellement les
employés des grandes entreprises et ceux du secteur public. Ils bénéficient
d’emplois garantis, d’avancement à l’ancienneté, et retardent autant que
possible toute évolution qui leur serait défavorable. Et ils ont du pouvoir ! Voyez le
nombre de députés et de ministres issus de la fonction publique. Du coup, la
flexibilité en France se développe de manière hypocrite : elle pèse essentiellement
sur les travailleurs les moins qualifiés et les petites entreprises. Les 35 heures ont
renforcé le phénomène : dans les administrations et les grandes entreprises, les
salariés ont obtenu des jours de congé supplémentaires. Dans les petites entreprises,
ni salaires élevés, ni avantages sociaux, ni formations…
Télérama : Un certain nombre de jeunes se disent : « Le CPE, c’est mieux que rien.
»
Bernard Perret : Mais il ne résout rien ! On reste dans la logique qui consiste à faire
peser le poids de la flexibilité sur une catégorie particulière de travailleurs plutôt
qu’à revoir l’ensemble de notre contrat social. Depuis vingt-cinq ans, face au
chômage, on procède par dérogations, création d’emplois atypiques, « emplois
aidés » dans le secteur marchand, « contrats emploi solidarité » dans le secteur non
marchand. A quoi il faut ajouter les contrats d’insertion et les stages, dont
l’abus a été dénoncé par le récent mouvement des stagiaires. Des contrats
dérogatoires de ce style, il y en a eu des dizaines. Cela aboutit à un système lourd,
illisible et surtout inefficace.
Télérama : Ces mesures sont pourtant présentées par les hommes politiques comme des
formules magiques…
Bernard Perret : L’emploi est le domaine des effets de manche et des fausses
trouvailles. La première honnêteté consisterait à reconnaître qu’il ne va pas y
avoir de croissance forte, donc de création massive d’emplois, même si les départs
en retraite vont améliorer un peu la situation. La gauche et la droite sont complices.
Chacune jouant à défaire ce que l’autre a fait, elles ne travaillent pas
sérieusement à inventer un nouveau compromis social. Cela aboutit au pire : une
société très flexible, inégalitaire et opaque.
Nous ne pourrons avancer que si nous travaillons à résoudre la contradiction suivante :
d’un côté, des entreprises qui veulent de la fluidité car elles opèrent dans un
monde économique instable, sur des marchés qui peuvent évoluer très vite ; de
l’autre, des salariés qui demandent de la stabilité car, pour avoir un appartement,
une vie « normale », il faut des revenus stables. Comment définir un compromis viable,
un nouveau modèle ? C’est la vraie question. Or, jusque dans nos comportements
individuels, nous ne l’abordons pas franchement. Comme consommateurs, par exemple,
nous voulons pouvoir changer d’opérateur de téléphonie, nous nous précipitons sur
les pantalons chinois à 3 euros, etc. Et nous voulons croire que ce mode de consommation
est sans effet sur l’organisation du monde !
Télérama : C’est un peu la poule et l’œuf. Les salariés vont vous
répondre que s’ils achètent le moins cher possible c’est parce qu’ils
sont de plus en plus précaires et mal payés.
Bernard Perret : Oui, mais il faut mesurer les conséquences de nos actions. Chacun
d’entre nous, en tant que consommateur, bénéficie de l’intensification de la
concurrence – que l’on pense à la révolution des télécommunications –
sans se soucier des contraintes qu’elle induit sur les travailleurs qui fabriquent ce
qu’il achète.
Télérama : Les Danois, eux, ont travaillé la question du compromis social. Leur fameuse
« flexi-sécurité », qui laisse les employeurs libres d’embaucher et de licencier,
mais qui accompagne par un vrai suivi social le parcours des salariés, est-elle une voie
à explorer ?
Bernard Perret : C’est un système tout de même assez autoritaire, il faut le dire.
Si vous êtes cuisinier et que seule la menuiserie embauche, on va vous demander de vous
reconvertir, sans état d’âme, et vite. Reste que le Danemark dispose de structures
sociales et politiques que nous n’avons pas, du moins pour l’instant, pour
lutter contre les effets négatifs de la mondialisation : des salariés syndiqués à 80
%, des partenaires sociaux qui ont l’habitude d’agir et de travailler ensemble,
de négocier. Le modèle danois a le mérite de fixer les règles du compromis : une
grande flexibilité, oui, mais assortie d’une garantie de continuité de droits
sociaux et de revenus. En France, les propositions ne manquent pas sur la manière de «
sécuriser » les parcours professionnels. La CGT, par exemple, a repris l’idée
d’une « sécurité sociale professionnelle ». Mais les syndicats sont minoritaires
et divisés.
Télérama : Est-ce pour cela qu’on ne peut construire un autre modèle social ?
Bernard Perret : Le profil des responsables syndicaux, issus des métiers les plus
qualifiés et surtout de la fonction publique, les pousse à défendre les points de vue
des classes moyennes, des détenteurs d’un emploi stable. Quand ils protestent contre
la flexibilité, c’est ce monde bien garanti qu’ils défendent. Les employés à
temps partiel, les ouvriers devenus précaires ? Personne ne les représente. Le plus
grand service à rendre à la société française serait donc de lui faire comprendre
comment elle est « fabriquée », si j’ose dire : avec ce corporatisme qui la fonde
et organise la protection des plus protégés et d’eux seuls. Comme un cercle
vicieux.
Télérama : Quelle évolution possible ?
Bernard Perret : Une flexibilité négociée, avec des médiations : vous pouvez être
viré du jour au lendemain, mais pas sans concertation. Il y a dans l’entreprise des
instances de négociation, qui peuvent examiner les dossiers et protéger les salariés
contre l’arbitraire. Il faut reconnaître aux Anglo-Saxons un mérite : ils croient
aux vertus éthiques de leur système. Ils sont convaincus que le marché, la concurrence,
c’est juste, parce que tout le monde a sa chance, et la responsabilité individuelle
est encouragée par l’éducation. En France, on présente les changements
économiques comme une fatalité que les pauvres doivent accepter pour que les riches
puissent continuer à vivre tranquilles. C’est insupportable. Il faut sortir de ce
libéralisme honteux et défensif pour affronter collectivement la contradiction entre un
système économique que nous ne pouvons plus rejeter et notre idéal de vie en société
!
Propos recueillis par Dominique Louise Pélegrin
Télérama n° 2926 - 7 février 2006
Quelle discrimination positive à la
française ?
Thomas Piketty*
(Article paru dans le Monde daté du 21 février 2006)
Tout le monde en convient : la société française doit inventer de nouvelles
politiques permettant de faire progresser concrètement l’égalité des chances,
" l’égalité des possibles " pour reprendre l’expression d’Eric
Maurin, notamment en matière scolaire. L’élévation générale des niveaux
d’éducation a suscité des frustrations à la mesure des espoirs placés en elle.
Les inégalités de parcours et de réussite scolaire se sont simplement translatées vers
le haut, quand elles ne se sont pas accrues – encore que ce point tende à être
exagéré aujourd’hui : le paradis perdu de l’ascenseur social tournant à plein
régime n’a jamais existé, pas plus que celui de l’emploi à vie. Simplement,
les inégalités sont devenues moins lisibles. Autrefois, l’inégalité était brute
: certains devaient commencer à travailler à 14 ou 16 ans pour gagner leur vie, alors
que d’autres avaient la chance de pouvoir poursuivre leurs études. Aujourd’hui,
chacun peut ou croit pouvoir accéder à une formation longue, mais des inégalités plus
subtiles reviennent en cours de route (entre filières générales et professionnelles des
lycées, à l’intérieur des filières du supérieur…), et ceux qui ratent le
bon embranchement et qui connaissent le plus fort chômage à la sortie sont souvent les
mêmes qui travaillaient tôt autrefois – l’emploi en moins. Toutes les
sociétés connaissent le même défi : à partir du moment où un certain niveau de
formation de base s’est universalisé, l’enjeu est d’aller plus loin, et
d’inventer des politiques permettant à ceux font face à un fort handicap initial de
connaître les mêmes chances de réussite scolaire et professionnelle que les autres.
Qu’on le veuille ou non, le débat sur la discrimination positive – terme
générique imprécis par lequel on désigne le plus souvent les politiques visant à
donner plus de moyens de réussir à ceux qui en ont le moins – s’est imposé en
France. Ce terme de " discrimination positive " est en soi problématique, car
il tend à orienter le débat français vers des solutions américaines, qui ne sont pas
les seules. Certes, personne ne propose d’appliquer en France les dispositifs
d’admission préférentielle de certaines catégories ethniques dans les
universités, sur lesquels s’est construite la discrimination positive
outre-atlantique. Ces références ethniques ne peuvent avoir leur place que dans la
réalité américaine, où pour des raisons historiques évidentes la question sociale
s’est structurée autour de la question raciale. Il est cependant frappant de *
Thomas Piketty est économiste, directeur d’études à l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages,
notamment : Les hauts revenus en France : inégalités et redistribution (1901-1998),
Grasset, 2001.
Quelle discrimination positive à la française ? constater à quel point le débat
français se focalise sur le même type de mécanisme d’admission préférentielle
dans les filières sélectives du supérieur, à la façon de ce que fait Sciences-Po pour
les lycéens issus de ZEP depuis quelques années, ou de la classe préparatoire
réservée aux lycéens de ZEP qui ouvrira à Henri-IV à la rentrée 2006 – à la
différence notable près que les catégories bénéficiant d’une admission
préférentielle sont ici définies sur une base territoriale et non ethnique. Ces
dispositifs susciteront les mêmes débats qu’outre-atlantique : ils permettent de
donner une chance à des jeunes découragés et qui n’auraient jamais osé candidater
dans ces filières, mais dans le même temps ceux qui auraient pu être admis de toute
façon risquent de souffrir du regard qui sera porté sur eux à la suite de leur
admission hors norme. En l’espèce, il est probable que les effets positifs
l’emportent : augmenter le nombre de lycéens de ZEP suivant avec succès ces
filières élitistes (actuellement infinitésimal) pourrait avoir un impact psychologique
important. Mais si de tels dispositifs étaient étendus à des effectifs autres que
symboliques, puis généralisés, ces débats ressurgiraient assurément. Sauf
précisément à inventer de nouvelles formes de discrimination positive à la française,
exploitant la principale différence qui sépare catégories ethniques (ou sociales,
d’ailleurs) et catégories résidentielles : on peut changer de résidence, pas
d’origine ethnique (ni sociale). D’où la proposition ingénieuse formulée par
Patrick Weil1 d’admettre en classes préparatoires les7 à 8% des élèves les
meilleurs de chaque lycée, en particulier ceux de ZEP. Cela pourrait avoir un effet fort
sur la mixité sociale (beaucoup de parents calculateurs voudraient alors mettre leurs
enfants en ZEP), qui pourrait contrebalancer largement les effets pervers habituels.
Il reste que de telles politiques ne permettent pas de corriger les retards scolaires
déjà considérables accumulés à l’adolescence. Lors des tests de compétences
passés à l’entrée en CP, avant même d’avoir commencé leur vie scolaire, les
enfants d’ouvriers obtiennent en moyenne des scores plus de 10 points inférieurs à
ceux des enfants de cadres, soit pratiquement l’équivalent d’un écart-type, ce
qui est considérable. Et si l’inégalité apparaît plus faible au niveau des notes
obtenues au baccalauréat (6 points, à peine plus de la moitié d’un écart-type),
c’est tout simplement parce que les enfants d’ouvriers ont déjà largement
disparu en cours de route : ils forment 38,9% des enfants à l’entrée en CP, et
seulement 19,2% en terminale générale (les enfants de cadres passent eux de 19,2% à
29,7%). Pour lutter contre ce type radical d’inégalité des chances, il faut agir à
un âge très précoce, dès les premières classes du primaire, où se forment des
inégalités durables. Et contrairement à une idée reçue, il est faux d’affirmer
que rien de tangible ne peut venir des réductions ciblées de tailles de classe. De
telles politiques ont certes un petit côté " mécaniciste " qui les rendent
suspectes à beaucoup de fins penseurs du social – mais au moins ont-elles le mérite
d’appartenir à l’espace des politiques possibles. Le scepticisme qui les
entoure s’explique également par un biais statistique classique en matière
d’évaluation de politiques publiques, consistant à confondre corrélation et
causalité. Si l’on examine la corrélation brute entre taille de classe et réussite
scolaire, on constate qu’elle va dans le mauvais sens : les élèves placés dans des
classes plus petites ont plutôt tendance à avoir de moins bons résultats scolaires que
les autres ! Cela vient évidemment du fait que des classes plus réduites ont
précisément tendance à être allouées aux écoles plus défavorisées au départ,
handicap initial que le léger ciblage des moyens ne peut compenser. On peut certes
raisonner " toutes choses égales par ailleurs ", c’est-à-dire en
comparant des écoles ayant le même pourcentage d’ouvriers, appartenant au même
type d’agglomérations, etc. Mais cela n’est généralement pas suffisant, car
il existe souvent des caractéristiques non observables pour le chercheur mais connues des
acteurs locaux expliquant pourquoi deux écoles apparemment semblables ont obtenu des
tailles de classes différentes. On retrouve le même problème quand on cherche à
évaluer l’impact du nombre de policiers sur la délinquance : la corrélation va
dans le mauvais sens, y compris " toutes choses égales par ailleurs ", tout
simplement parce que l’on met généralement plus de policiers là où ça va mal. En
l’occurrence, des études exploitant les variations brutales du nombre de policiers
précédent des élections ont pu trouver un effet allant dans le " bon " sens :
la délinquance baisse, quoique assez modérément. 1 Patrick Weil, La République et sa
diversité. Immigration, intégration, discriminations, La République des Idées/Seuil,
2005.
Entretien avec Patrick Weil
Patrick Weil est directeur de recherche au CNRS (Centre d’histoire sociale du
20ème siècle, université de Paris1) Il a récemment publié La République et sa
diversité, Immigration, intégration, discriminations (Seuil/La République des Idées,
2005).
Comment jugez-vous les tentatives actuelles pour faciliter l’accès des élèves
des lycées les plus défavorisés à certains établissements d’excellence de
l’enseignement supérieur ? Ce sont des réponses expérimentales à un phénomène
de masse. Les dispositifs mis en place par les IEP de Paris, Aix et Lille, ou par
l’Essec, permettent aux meilleurs élèves de quelques lycées d’accéder à ces
établissements, mais ils ne concernent que 2 à 3% des lycées, alors que le phénomène
de la discrimination sociale et territoriale dans l’accès aux cycles les plus
sélectifs du supérieur touche une très grande quantité de jeunes. L’un des
aspects positifs de ces expériences, c’est qu’elles démontrent que des
élèves issus des lycées parmi les plus défavorisés s’en sortent bien une fois
qu’ils ont franchi le seuil de ces écoles. Elles ont, en outre, un effet dynamisant
sur leurs lycées d’origine. Mais si l’on veut que de telles expériences ne
deviennent pas l’alibi cosmétique d’une discrimination de masse persistante, il
faut à présent sortir de la phase expérimentale pour passer à des mesures plus
générales. Sinon, la majorité des lycées et des élèves qui ne bénéficient pas de
ces mesures se diront fort légitimement: " Pourquoi ne fait-on rien pour nous?
". Voyez-vous à l’étranger des dispositifs qui seraient transposables en
France ? Quatre Etats américains – le Texas, la Californie, la Floride et
l’Etat de Washington – ont mis en place des politiques visant à assurer une
plus grande justice sociale dans l’accès au Supérieur, tout en dépassant les
critères d’appartenance à une minorité ethnique, qui organisaient
traditionnellement les politiques d’affirmative action aux Etats-Unis. Au Texas,
depuis cinq ans, on permet aux 10% des meilleurs élèves de chaque lycée – les
mieux comme les moins bien situés – d’accéder à la première année des
universités publiques de l’Etat, dont l’Université du Texas qui est l’une
des meilleurs des Etats-Unis. Ce dispositif n’a pas d’impact négatif sur la
représentation des minorités dans ces effectifs, au contraire. Les lycées des zones
rurales traditionnellement délaissés sont ainsi équitablement représentés. Ajoutons
que 40% des places de première année dans ces universités restent réservées à
l’admission sur dossiers individuels.
Comment voyez-vous la version française d’une telle politique ?
On pourrait proposer que 7 à 8% des meilleurs élèves de chaque lycée de Métropole
et d’Outremer puissent se voir proposer d’accéder directement aux premières
années des cycles du supérieur qui sélectionnent à l’entrée (classes
préparatoires aux grandes écoles, IEP de province et de Paris, Dauphine). Si l’on
compte que certains de ces élèves préfèreraient malgré tout suivre une autre voie, on
peut imaginer que 50% des places disponibles seraient ainsi pourvues. Pour certains, cela
ne changeraient rigoureusement rien : les 8% les meilleurs d’Henri IV y entrent
déjà ! Mais cela changerait beaucoup pour les nombreux lycées qui n’envoient
jamais aucun de leurs élèves dans ces filières. Plus aucun lycéen ne pourrait se dire
: " Je n’ai aucune chance, parce que je suis dans un mauvais lycée ". La
dynamique positive que cela créerait dans chaque lycée pourrait également avoir un
effet vertueux sur les parents qui s’échinent aujourd’hui à contourner la
carte scolaire… Quelle discrimination positive à la française ?
Dans le cas des tailles de classes, on peut dépasser ces difficultés en exploitant
les discontinuités liées aux seuils d’ouverture et de fermeture de classes. Au
niveau du CE1, on constate par exemple que les écoles obtiennent généralement une
seconde classe au-delà de 30 élèves inscrits, si bien que la taille moyenne de classe
chute de façon importante dans les écoles comptant 32-33 enfants inscrits plutôt que
28-29. Or on observe que ces variations aléatoires des tailles de classe, conséquence
des hasards de la démographie locale, engendrent à l’entrée en CE2 des variations
parfaitement symétriques de la réussite aux tests de mathématiques. Il est
d’autant plus difficile d’expliquer ces résultats autrement que comme une
relation causale que ces variations n’existaient pas pour les mêmes élèves au
niveau des tests à l’entrée en CP. Si l’on décompose les résultats, on
constate également que les effets sont sensiblement plus importants pour les enfants
défavorisés. Les coefficients obtenus sont quantitativement importants : par exemple,
une réduction de la taille des classes à 17 élèves en CP et CE1 en ZEP (au lieu de 22
actuellement) permettrait de réduire de près de 45% l’inégalité en mathématiques
à l’entrée en CE2 entre écoles ZEP et hors ZEP. Aucune étude ne peut dire quel
serait l’impact à l’âge adulte, mais tout laisse à penser qu’il pourrait
être du même ordre. On notera que ces résultats ont été obtenus sans que des brigades
d’inspecteurs d’académie viennent donner de nouvelles instructions
pédagogiques aux enseignants lors des franchissements de seuils : contrairement à une
idée tenace en sciences de l’éducation, les instituteurs semblent tout à fait
capables de tirer eux-mêmes partie de classes plus réduites.
En appliquant la même méthode aux collèges et aux lycées, on obtient des effets
statistiquement significatifs, mais sensiblement moins importants. La suppression des
lycées classés en ZEP (qui sont d’ailleurs peu nombreux) n’aurait que des
conséquences marginales, de même qu’une réduction ciblée de 5 élèves par classe
: l’inégalité de réussite scolaire (notes au bac) entre lycées ZEP et hors ZEP
progresserait de 2% dans un cas, et diminuerait de 5% dans l’autre. Les marges de
manœuvre sont plus importantes au collège, où selon nos estimations les ZEP sous
leur forme actuelle permettent tout de même de réduire les inégalités de près de 10%,
et où une réduction supplémentaire de 5 élèves par classe permettrait une baisse
additionnelle de 28%. Mais c’est au niveau du primaire que le ciblage des moyens est
susceptible d’avoir les plus forts effets. Tout cela confirme qu’il est
préférable d’agir au plus jeune âge si l’on souhaite corriger les handicaps
initiaux, et que les inégalités sont plus difficiles à corriger pour les enfants plus
grands.
Que l’on ne s’y trompe pas : une telle politique représenterait des
redéploiements considérables de moyens. Si l’on souhaitait la mettre en œuvre
à moyens constants (le primaire est globalement bien doté en France), elle entraînerait
une légère hausse des effectifs hors ZEP, sans impact réal sur les enfants concernés,
mais qui ferait bondir les parents en question. Surtout, elle exigerait que l’on
explicite les moyens supplémentaires auxquels donne droit le classement en ZEP, ce qui
n’a jamais été fait, et que l’on se donne les moyens d’évaluer cette
politique, y compris la procédure de classement. Plus difficile à mettre en œuvre,
une telle politique aurait pourtant le mérite de dessiner une autre forme de
discrimination positive à la française, fondée sur l’allocation de réels moyens
supplémentaires aux territoires qui font face aux plus lourds handicaps.
Couplé avec des dispositifs ingénieux d’admission préférentielle dans le
supérieur, ce ciblage assumé des moyens au primaire permettrait de tenir les deux bouts
de la chaîne. D’autres politiques restent bien sûr à inventer. Mais après une
période d’échanges quasi-théologiques sur la notion même de discrimination
positive et sur le dilemme égalité/équité, il est plus que temps aujourd’hui que
le débat français entre dans un seconde phase, avec des discussions plus techniques et
plus précises sur le contenu même des politiques susceptibles d’être mises en
œuvre, ici et maintenant.
Réduire les inégalités de réussite scolaire dès le plus jeune âge
Agir sur la taille des classes en ZEP dans le primaire apparaît comme un moyen
efficace de réduire les inégalités de réussite scolaire. De petites variations de la
taille des classes ont en effet une incidence très significative sur les résultats des
élèves : une diminution de cinq élèves par classe conduirait ainsi à une réduction
de 45 % des inégalités de performance entre ZEP et non ZEP dans le primaire. Cette
politique serait cependant moins convaincante dans le secondaire, pour lequel il faut
imaginer d’autres solutions.
Des cités à la cité
Les banlieues secouent la République. Avec les violences urbaines d'octobre et novembre
2005, la France a redécouvert l'existence de ces "marges", de ces
"périphéries", de ce qu'on a longtemps refusé d'appeler des
"ghettos". Cinq mois après le déclenchement de la "crise des
banlieues" - 10 000 véhicules incendiés, des centaines de bâtiments publics
dégradés, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre - l'émotion est
retombée, rendant possible une réflexion plus apaisée sur les défaillances et les
réussites du modèle français. Tel était l'objectif du débat du Monde organisé lundi
20 mars au Théâtre du Rond-Point, dans le 8e arrondissement de Paris.
Cette crise n'a pas fini d'interpeller la société, mais l'impact de long terme sur
l'opinion publique reste néanmoins difficile à évaluer. L'élément le plus important
pourrait être le sentiment de "peur intense" des Français, relève Brice
Teinturier, directeur du département politique et opinion de TNS-Sofres. Et donc la
tentation du repli : "Nous vivons aujourd'hui dans une société où,
incontestablement, le sens du collectif a tendance à se déliter, à régresser. Un
slogan comme celui de la "France pour tous" (lancé par Jacques Chirac lors de
sa campagne pour la présidentielle de 1995) ferait de moins en moins florès.
Aujourd'hui, ce serait plutôt la "France de chacun", avec des groupes sociaux
qui se vivent de plus en plus séparés", explique ce spécialiste de l'opinion
publique.
La société française, plus individualiste que l'américaine, où le patriotisme sert de
ciment, se fragmente. L'école ne parvient pas à réduire les inégalités. Les
discriminations dans l'accès au logement ou à l'emploi sont considérables. Comment
s'étonner alors que les jeunes des banlieues, situés à la marge de la marge, se
révoltent ? Et usent de la violence physique contre la violence sociale subie au
quotidien ? "C'était une jacquerie, une révolte sociale, estime Claude Dilain,
maire (PS) de Clichy-sous-Bois, à propos des émeutes de novembre. Au moins, là, la
société française est interpellée et va cesser les tartufferies sur les
banlieues."
Une société profondément inégalitaire est instable, sous tension. L'ancien patron de
Renault, aujourd'hui président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité (Halde), Louis Schweitzer, rejoint l'élu de terrain sur ce constat.
"Tant qu'il y a de l'injustice, il y aura du désordre. Ce n'est pas la seule raison
de combattre l'injustice, mais l'ordre passe par la justice. Si ceux qui ont fait l'effort
d'avancer voient des portes fermées, je ne vois pas comment il n'y aura pas de
révoltes", explique-t-il.
Jacques Attali ne craint pas de dire les choses plus crûment encore. "Il faut
employer les mots qui conviennent : aujourd'hui, les problèmes portent sur les Noirs et
les musulmans, point. Je ne pense pas qu'il soit plus difficile d'être quoi que ce soit
d'autre que noir ou musulman." L'ancien conseiller spécial de François Mitterrand
affirme que la très faible représentation des Noirs et des musulmans parmi les
députés, les ministres, les préfets, les directeurs d'administration centrale paraîtra
"effroyable" dans quelques années. Comme l'absence de droit de vote pour les
femmes jusqu'en 1945.
A contre-courant du pessimisme ambiant, le sociologue Dominique Wolton veut voir une
preuve de vitalité dans la crise de l'automne. "Il existe une colère, une révolte,
une indignation. C'est important que les gens sachent dire "non"",
martèle-t-il. Et dans la "demande d'égalité" de la jeunesse française à
travers les violences urbaines et le refus du contrat première embauche (CPE), il voit un
encouragement. "On aurait pu avoir une partie de la jeunesse qui joue la rupture avec
la société. Cela n'a pas été le cas : ils demandent à être respectés et veulent un
minimum de justice", estime M. Wolton.
Mais une fois toutes ces carences soulignées, que faire ? Paradoxalement, commencer par
mettre en valeur les réussites de la banlieue afin de ne pas l'enfermer dans un statut de
victime. "Les habitants des quartiers un peu oubliés nous disaient : "Nous ne
comprenons pas pourquoi on ne parle que des échecs"", souligne la philosophe
Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l'intégration (HCI), créé en 1989 et
chargé de donner des avis au gouvernement.
Hinde Magada tient un discours similaire. Seule porte-parole directe des "jeunes de
banlieue", ayant reçu le prix Talents des cités, décerné par le Sénat, elle
démontre, par son itinéraire de "fille d'immigrée", "d'origine
marocaine", "musulmane", qu'il est possible de réussir. Titulaire d'un BTS
de commerce international, elle a dû faire des ménages, travailler en usine et dans un
centre d'appel avant de devenir secrétaire médicale. Elle a alors choisi de créer sa
propre entreprise, qui emploie aujourd'hui cinq salariés. "Avec une amie, on a mis
nos motivations en commun. Et la motivation, c'est le principal", explique Mme
Magada, âgée de 29 ans.
M. Attali souligne que la diversité est une ressource pour le pays. "Il y a toujours
plus de difficultés d'intégration quand il n'y a pas de croissance, quand il y a une
société qui se rabougrit, qui vieillit, qui regarde sur elle-même. A ce moment-là, les
places sont rares et donc chacun se défend en s'enfermant, en interdisant aux autres de
venir", concède-t-il. Mais il plaide pour une attitude complètement opposée :
considérer les minorités comme une richesse essentielle dans un contexte de
mondialisation. "Alors, tout devient possible", assure l'économiste, formant le
voeu d'un Bill Gates à la française venu de banlieue. "La France mourra,
disparaîtra comme nation si on ne sait pas exploiter ce formidable potentiel",
ajoute M. Attali.
Une attitude "positive", un discours de valorisation des banlieues ne suffiront
évidemment pas. Il faut aussi des moyens, une politique de soutien économique, social,
éducatif. Mais deux logiques s'opposent. Celle d'une rupture avec l'approche
républicaine traditionnelle. Patrick Lozès, président du Conseil représentatif des
associations noires (CRAN), dénonce ainsi la tendance à euphémiser la réalité et à
s'abriter derrière les "paravents de la République". M. Attali évoque, lui,
des "mesures radicales", notamment l'instauration d'une "discrimination
positive provisoire", mesure qui marquerait un "échec" mais qu'il juge
aujourd'hui indispensable.
De l'autre côté, Bariza Khiari, sénatrice (PS) de Paris, et Mme Kriegel défendent les
"outils de l'égalité républicaine". La philosophe défend les vertus de
l'action engagée par Jacques Chirac, auprès duquel elle est chargée de mission, avec
l'installation de la Halde, la création d'un musée de l'immigration, les
expérimentations autour du CV anonyme.". "En France, le problème n'est pas la
loi, mais la façon dont elle est appliquée", résume-t-elle.
Le travail reste immense. "J'ai entendu beaucoup de choses sur l'intégration, sur le
sacro-saint débat sur la discrimination positive, mais cela m'apparaît en décalage
total avec ce que vivent les habitants des quartiers", conclut, dépité, M. Dilain.
L'élu cite un jeune de sa commune : "On veut être des enfants de la République à
part entière et pas entièrement à part." Et rappelle que, bien plus que des moyens
financiers, les jeunes veulent du respect : "Ils ont soif de reconnaissance."
Chenva Tieu, administrateur du Club du XXIe siècle, promoteur de la diversité sociale et
ethnique, est plus sévère encore : "Les débats, c'est bien, mais, en attendant,
rien ne bouge."
Luc Bronner et Mustapha Kessous
In le Monde du 22/03/06

Express du 16/03/2006
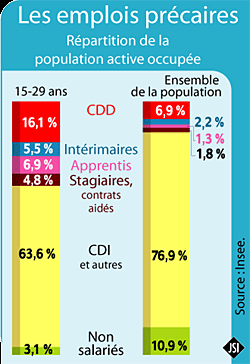
"La banlieue ne s'est
pas mobilisée"
propos recueillis par Jean-Sébastien Stehli
Christophe Bourseiller, écrivain (L'Aventure moderne, Flammarion), professeur à
Sciences po, spécialiste de l'extrême gauche, décrypte les manifestations étudiantes
Qui, aujourd'hui, contrôle le mouvement étudiant?
Comme chaque année, les organisations d'extrême gauche tentent de généraliser le
mouvement contestataire. C'est, en quelque sorte, leur fonction. Ces groupes jouent le
rôle d' "avant-garde", comme à la Sorbonne, où les anarchistes, des gens
proches du Black Bloc, ont rebaptisé l'amphi "Joëlle Aubron". On ressort le
drapeau à l'étoile noire, mais on ne peut pas dire que les groupes d'extrême gauche
contrôlent le mouvement étudiant.
Ce qui se passe dans les universités est-il comparable aux manifestations lycéennes
contre la réforme Fillon, en 2005?
D'un point de vue politique, oui. Chaque année, étudiants et lycéens répètent le
même rituel. Mais, en ce qui concerne la violence, le mouvement actuel n'a rien à voir
avec 2005. Aujourd'hui, il s'agit de violence politique classique, avec les autonomes, les
anarchistes. Contre la loi Fillon, il s'agissait d'une violence sociale, avec ratonnades
et vols de portables de la part de jeunes venus des cités. Aujourd'hui, la banlieue ne
s'est pas mobilisée.
Pourquoi?
D'abord parce que les jeunes des cités n'ont jamais eu une conscience sociale très
développée. L'année dernière, ils ont défilé uniquement pour piquer des portables.
C'est pourquoi l'extrême gauche les considère comme le lumpenprolétariat: elle estime
qu'ils pourraient à tout moment se retourner contre le mouvement. Cette année, la
première manifestation étudiante était lourdement protégée par un service d'ordre
syndical. Les jeunes des cités n'ont pas osé s'y frotter. Tant que le mouvement
étudiant est en liaison avec les centrales ouvrières, les cités ne s'en mêleront pas.
C'est le paradoxe: cette réforme les concerne, mais ils sont absents des protestations.
jeudi 23 mars 2006,
Manifestations anti-CPE
Poussée de violence
Eric Lecluyse, avec Reuters
Entre 220 000 et 450 000 étudiants et lycéens ont manifesté aujourd'hui. A Paris,
des centaines de casseurs ont incendié des voitures, pillé des magasins et dépouillé
des manifestants. Des affrontements sont également signalés à Rennes et en banlieue
parisienne
Selon les sources, entre 220 000 et 450 000 étudiants et lycéens ont manifesté
aujourd'hui dans toute la France pour réclamer le retrait du CPE, soit une mobilisation
un peu moins importante que jeudi 16 mars. Ils étaient entre 23 000 et 50 000 à Paris,
environ 16 000 à Toulon et Toulouse.
Une fois de plus, la violence a pris le pas sur les revendications. A Paris, des
centaines de "casseurs" ont incendié des voitures et pillé des magasins,
rapportent des témoins. Ils ont mis le feu à la porte d'un immeuble d'appartements haut
de six étages près de l'esplanade des Invalides, là où s'est achevé le défilé. Les
vitres d'au moins quatre magasins et d'une dizaine de voitures ont été brisées. La
police a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les voyous.
Vols de portables, attaque d'un camion de pompiers
Distincts des manifestants, ils sont apparus quasiment dès le départ du cortège, en
début d'après-midi, place d'Italie, et l'ont suivi en groupes très mobiles, jusqu'au
terme du parcours, sur l'esplanade des Invalides et alentour, là où les incidents les
plus graves se sont produits. "Ces jeunes ont dépouillé de nombreux lycéens,
volant notamment des portables, et jeté des pierres. Ils se sont attaqués à un camion
de pompiers", rapporte un photographe.
L'important service d'ordre policier encadrant le cortège des manifestants n'a
apparemment pas réussi à empêcher ces débordements. "Samedi, on était tous
ensemble, cette fois-ci il y a beaucoup de voyous qui sont là pour voler et
détruire", témoigne un manifestant de 22 ans.
Les heurts entre forces de l'ordre et "casseurs" sur l'esplanade des
Invalides ont pris fin peu après 18h30. Un ultime carré d'une centaine de manifestants
anti-CPE était cerné par les CRS au quai d'Orsay. Ils ont été repoussés sans
ménagement vers une rue voisine au moyen de gaz lacrymogènes. "Les casseurs, c'est
pas nous!", "Libérez nos camarades!" ont-ils scandé. Par ailleurs, une
vingtaine de skinheads se seraient heurtés aux "casseurs".
Affrontements à Rennes et en banlieue parisienne
A Rennes, bastion de la contestation, où certains étudiants et lycéens commencent à
revendiquer ouvertement le recours à la violence comme seul moyen de se faire entendre,
une occupation des Galeries Lafayette a dégénéré à l'issue de la manifestation, qui a
rassemblé entre 6000 et 12 000 personnes. Bilan : une porte en verre brisée et des
projectiles et fumigènes lancés dans le magasin. Le rassemblement a ensuite tourné à
l'affrontement entre 300 et 400 personnes et les CRS devant le siège de l'UMP, comme
jeudi dernier.
La banlieue parisienne n'est pas épargnée. Si la journée de protestation contre le
CPE a été "relativement calme" devant les lycées de Seine-et-Marne -
"seulement" quelques caillassages sur les forces de l'ordre à Montereau et
Champagne-sur-Seine, Savigny-sur-Orge (Essonne) a connu des incidents plus sérieux. Deux
voitures ont été retournées, une brûlée et une trentaine dégradées autour de la
gare de RER C. Des abribus et des cabines téléphonique ont également été détruits.
Dans la matinée, des incidents avaient déjà opposé les forces de l'ordre et au moins
une centaine de jeunes dans le centre de la ville.

Lettre à Dominique de Villepin par Noël Bouttier
Quel est votre dessein, monsieur le Premier ministre ? La question se pose très
sérieusement après la fin de non-recevoir que vous avez apportée au million de
manifestants hostiles au Contrat première embauche, lors des manifestations du 18 mars.
On va durcir la législation sur les stages et les CDD à répétition, dites-vous. Fort
bien, mais est-ce le sujet qui, depuis six semaines mobilise des dizaines de milliers de
jeunes ?
Il vous faut répondre, M. de Villepin, à la question : pourquoi maintenir à tout
prix ce CPE contesté par (presque) toutes les organisations de jeunes, l’ensemble
des syndicats, la gauche unie, l’UDF et même, discrètement, par certains de
l’UMP ? En bon juriste, vous allez invoquer le respect de la loi votée par la
représentation nationale. Certes, mais rappelez alors les conditions de l’adoption
de ce texte par la Chambre Haute. Le CPE est né par la grâce du 49-3, cet article fort
peu démocratique qui prive le législateur de toute capacité d’améliorer un texte.
L’aurait-il fait d’ailleurs que peut-être les clauses les plus choquantes de ce
contrat new look – comme la faculté de rompre à tout moment le contrat sans le
motiver – auraient été modifiées. Nous n’en saurons jamais rien puisque vous
avez décrété qu’assez de temps avait été perdu en de vaines discussions.
Chef d’un gouvernement qui a mis, après la bourrasque du non au référendum, le
cap sur l’emploi, vous allez invoquer le chômage des jeunes. Effectivement, il
gangrène ce pays ; tout le monde devrait être modeste en la matière. Pour autant,
croyez-vous qu’on peut réellement avancer si les forces du salariat – actuelles
ou futures – voient dans le CPE une régression sociale majeure, si tous les risques
semblent être réservés à une seule partie, celle qui, pour reprendre une terminologie
peu usitée sous les ors de la République , loue sa force de travail ? Comment convaincre
si on commence par contraindre ?
Monsieur de Villepin, dans une bataille comme celle contre le chômage, il importe de
savoir si vos armes sont les bonnes. Récemment, l’étude de deux économistes (1)
estimait à 70 000 le nombre d’emplois qui pourraient être effectivement créés en
2008 par le CNE, le grand frère du CPE pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Ils mettaient en garde contre l’effet couperet des deux ans, nombre
d’entreprises pouvant être tentées de ne pas transformer le CNE (ou CPE) en CDI.
Manifestement, ce dispositif ne pourra endiguer qu’à la marge le chômage des
jeunes. D’autres outils, mêlant la formation, la recherche, la fiscalité, etc.
existent, mais cela demande du temps. Et comme vous n’en avez pas, monsieur le
Premier ministre…
À ce stade de notre réflexion, une question, naïve, nous saisit : pourquoi justement
n’en avez-vous pas, de temps ? Serait-ce parce la situation de l’emploi est
préoccupante dans notre pays ? Raison de plus pour ne pas imposer une mesure qui aggrave
encore la précarité sans pouvoir prétendre s’attaquer aux racines du mal.
Serait-ce alors que pour exister dans la bataille présidentielle de 2007, il vous faut
agir, ou du moins donner cette impression ? Et surtout ne pas capituler, pour reprendre
votre vocabulaire favori. Ne vous dit-on pas que " tous les gouvernements qui ont
cédé à la rue ont toujours été sanctionnés au scrutin suivant (2) ? Il vaudrait
mieux ne pas trop écouter les jusqu’au-boutistes de votre camp. Avec cette logique
de l’enfermement et de l’aveuglement, le pays se prépare à des jours
difficiles ponctués de grèves et de violences. Monsieur de Villepin, si vous le
permettez, une dernière réflexion : on peut dissoudre une Assemblée – ou s’y
essayer ; on ne peut dissoudre le peuple.
1. Étude conduite par Stéphane Cahuc et Stéphane Carcillo.
2. Éditorial du Figaro du 20 mars.
JACQUES MARSEILLE, professeur d'histoire de l'économie
à la Sorbonne
Plus que la réforme, "la rupture est
consubstantielle à notre histoire"
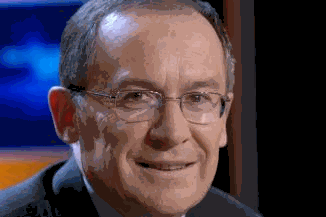
LE MONDE | 25.03.06 |
La France est-elle un pays impossible à
réformer ?
Oui. Ou en tout cas, c'est éminemment difficile.
J'ai cherché désespérément dans l'histoire les moments où la France avait été
capable de faire les grandes réformes qui allaient changer son destin, tranquillement,
par le dialogue, par le Parlement. Je n'en ai pas trouvé.
Jacques Marseille
Jacques Marseille est professeur d'histoire économique à Paris-I -Sorbonne, directeur
de l'Institut d'histoire économique et sociale et président de l'Association pour le
développement de l'histoire économique. Il vient de publier Du bon usage de la guerre
civile en France (Perrin, 172 p., 14 €).
[-] fermer
Pour vous, la France n'évolue que par ruptures successives ?
La rupture est consubstantielle à notre histoire. J'ai examiné nos grandes ruptures.
Il faut les guerres de religion pour passer du fanatisme religieux à une certaine forme
de tolérance. C'est avec la Fronde que les privilégiés ont dû se soumettre à une
certaine forme d'ordre. Après dix ans de révolutions, les contemporains auraient plutôt
misé sur Cambacérès, Mme de Staël ou Benjamin Constant. Ils n'auraient jamais cité
Bonaparte, qui incarnait la populace et qui allait pourtant, en l'espace d'un quinquennat,
créer le socle de granit de la France : le franc, le Code civil, les lycées,
l'université, le cadastre, les préfets. Lors de la révolution industrielle, la rupture
pour faire passer la France du protectionnisme exacerbé à l'ouverture et au
libre-échange est accomplie par Louis Napoléon Bonaparte, celui que les bien-pensants de
l'époque traitaient de "crétin".
Comment expliquez-vous cette résistance au mode de la réforme ?
La France est incapable de faire des diagnostics partagés. Je provoque mes étudiants
en leur disant que chaque matin, quand il se rase, Dominique de Villepin n'a qu'une seule
idée en tête, précariser la jeunesse française, et que les patrons français n'ont
qu'une seule obsession, licencier sans motif ceux qu'ils ont embauchés l'avant-veille.
Avec de tels présupposés et une telle incapacité à négocier, il ne peut qu'y avoir
des "guerres civiles" en France. La vraie question qui se pose aux jeunes n'est
pas : est-ce que le gouvernement ultralibéral cherche à les précariser ?, mais comment,
avec une croissance comparable à celle de ses voisins, la France crée si peu d'emplois
et exclut du monde du travail les seniors et les juniors.
Ensuite, la France n'a pas réellement fait le choix de son régime politique :
avons-nous un régime parlementaire ou présidentiel ? Les démocraties qui fonctionnent
ont soit l'un soit l'autre. Dans les pays d'Europe du Nord, il existe deux grands partis,
l'un, social-démocrate, qui, contrairement au Parti socialiste français, a fait le choix
de l'économie de marché, et un parti chrétien-démocrate. Il existe deux chefs de
parti, qui n'ont pas fait l'ENA et sont souvent issus du mouvement syndical. Ils ne font
pas partie de l'"élite", au sens où on l'entend en France. Ils ont des
programmes divergents, plus ou moins social ou libéral ; lorsqu'ils gagnent les
élections, ils deviennent premier ministre et sont réélus une ou deux fois. Au bout de
dix ou douze ans, on change de génération.
Dans un régime présidentiel comme aux Etats-Unis, le président est obligé de
négocier avec le Congrès et ne peut rester à la Maison Blanche plus de huit ans.
Après, c'est fini. Jimmy Carter et Bill Clinton donnent bien des conférences, mais ils
sont écartés du jeu politique. En France, nous n'avons pas choisi. L'UMP soutient à
peine le gouvernement et le Parlement n'a en fait aucun pouvoir. Les dirigeants font de la
politique à vie et sont coupés du monde. Valéry Giscard d'Estaing fête ses cinquante
ans de vie politique ; François Mitterrand est mort un an après avoir quitté l'Elysée
après cinquante ans de vie politique. Jacques Chirac n'a fait lui que quarante-trois ans,
et Lionel Jospin risque de se représenter.
Et les syndicats ?
Le syndicalisme en France est faible et divisé, alors qu'il est uni et représente les
deux tiers de la population active dans les autres démocraties. Les corps intermédiaires
n'existent pas : la Révolution française les a tous brisés pour établir une relation
directe entre l'Etat et le citoyen. Il est donc assez logique que ce soit la rue qui ait
pris la place du Parlement en France, d'autant plus que la moitié des Français ne
participent pas à la vie politique : 20 % à 30 % ne votent pas, 15 % votent pour
l'extrême droite et 10 % pour l'extrême gauche. C'est ce que j'appelle des Français
"inutiles", qui ne participent pas à la vie politique du pays, sauf sous la
forme de la contestation. La France est ainsi devenue le modèle de l'absence de réelle
démocratie, en tout cas d'une réelle incapacité à la discussion, à la réforme ou au
compromis.
Les choses vont-elles assez mal aujourd'hui pour qu'il y ait rupture ?
Les Français ont très souvent cette expression lorsque vous les interrogez :
"Ça va péter." S'ils le disent, c'est que cela va assez mal pour qu'il y ait
rupture. L'histoire nous offre trois scénarios.
Le premier - auquel je crois de moins en moins - est celui de l'accommodement,
c'est-à-dire celui de la non-rupture, de la lente agonie. C'est l'exemple de la IIIe
République. La Commune, qui est la plus terrifiante des guerres civiles, ne débouche sur
rien. Adoptée à une voix près, la IIIe République est une alliance mi-chèvre mi-chou
entre les orléanistes et les républicains les plus opportunistes. Elle prend un grand
retard sur le plan social. Il faut plus de vingt ans entre le moment où on dépose la loi
sur les accidents du travail et son vote, en 1898, pour reconnaître la responsabilité
des employeurs en cas d'accident. Pendant ce temps, l'Etat-providence naît rapidement
dans l'Allemagne ultra-conservatrice de Bismarck. La France, très ouverte sur le monde,
se replie sur elle-même et rate la première mondialisation. Elle sait creuser des
tranchées, mais pas construire des blindés. Pendant l'entre-deux-guerres, elle
s'accommode de la menace allemande avec Munich et Vichy.
La plus longue de nos Républiques débouche ainsi sur une triste agonie. La deuxième
en longueur, c'est la Ve République, qui connaît de nouveau un accommodement : une
France pour laquelle la mondialisation est l'horreur absolue, l'Europe une menace, et qui
veut rétablir la ligne Maginot pour se protéger du plombier polonais. Cette coalition
hétéroclite qui dit non au monde, ou vit dans un monde imaginaire qui fait de plus en
plus sourire les étrangers, a paradoxalement pour grand rassembleur Jacques Chirac. Il
est l'anti-Charles de Gaulle des années 1940.
L'agonie de la Ve République, dont "l'esprit" est en fait bonapartiste,
commence lorsque François Mitterrand accepte la cohabitation. La Ve République a
beaucoup de défauts, si celui qui en est à la tête trahit ainsi son esprit. Si le
peuple désavoue le président, il doit se démettre, comme l'avait fait Charles de Gaulle
en 1969 et comme aurait dû le faire M. Chirac après la dissolution manquée de 1997 et
le référendum perdu de 2005.
Quels sont les autres scénarios ?
Le deuxième scénario est celui de la "rupture-trahison". Notre histoire en
offre deux superbes. La plus belle est celle de De Gaulle, qui arrive au pouvoir en 1958
avec une opinion qui croit que, comme elle, il est pour l'Algérie française, alors qu'il
est persuadé qu'il faut s'en débarrasser. Pour faire cette rupture-trahison, il faut un
charisme très fort, beaucoup d'autorité et de cynisme. Un cynisme porté par un grand
dessein. La deuxième est celle de François Mitterrand, qui se fait élire en 1981 sur le
thème de la rupture avec le capitalisme, et qui opère peu après la conversion de la
France au "réel", c'est-à-dire à l'économie de marché.
Le troisième scénario est celui de la rupture-élan, qui consiste à accepter la
modernité. Cela s'est produit avec Louis XIV après la Fronde, Henri IV à l'issue des
guerres de religion, Bonaparte en 1799, puis avec Napoléon III en 1851. Au XXe siècle,
la France connaît une rupture-affirmation avec le de Gaulle de la Résistance et de la
Libération. A l'époque, les bastilles sont à prendre. Et de Gaulle réalise finalement
le programme des "communards", qui est à la fois patriotique et social.
Vos hypothèses tablent toutes sur l'homme providentiel ?
C'est ce qui apparaît dans notre histoire, je n'y peux rien. On peut y trouver des
causes historiques, notamment dans la faiblesse du lien syndicat - social-démocratie. La
France n'a pas fait son deuil de la monarchie, alors qu'elle se croit révolutionnaire.
Elle se pense l'héritière de la Révolution et affirme au monde qu'elle est le modèle
à suivre en matière de démocratie, alors qu'elle ne l'est pas réellement.
Sur le CPE, quelle issue vous paraît la plus probable ?
La guerre d'aujourd'hui, c'est celle du courage contre l'égoïsme. Pour la première
fois, les Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ces enfants vont
devoir financer la retraite et la santé de leurs parents, leur propre retraite, et
rembourser la dette publique, qui ne cesse de grossir. Un système de répartition où
l'on vit trente ans après son départ en retraite, cela ne peut pas fonctionner sans
réelle remise en question. J'ai ainsi calculé qu'avec mon espérance de vie je toucherai
plus en retraite que l'ensemble de mes revenus d'activité ! Aux frais, bien évidemment,
de la génération suivante, qui devra supporter ce poids. Le service de la dette
représente l'équivalent de l'impôt sur le revenu. L'autre jour, Bercy a révélé que
la dette n'était pas de 65,6 % du PIB, mais de 66,4 %. 0,6 % de PIB en plus, c'est 10
milliards d'euros, deux fois le budget du ministère de la justice, quatre fois celui de
la culture, quatre fois l'ISF.
Assiste-t-on à une rébellion de la classe moyenne, dont le niveau de vie s'érode ?
Effectivement, les classes moyennes souffrent. Elles ont dit non au référendum
européen, pour la première fois. Leur idéologie, c'est l'ascenseur social. A partir du
moment où elles pensent qu'il est en panne, cela devient très grave. Il y a bien deux
France, une France exposée et une France abritée, mais notre lecture des grilles
sociales habituelles ne fonctionne plus. Les ouvriers et employés "protégés"
votent socialiste, tandis que ceux qui sont "exposés" votent Le Pen ou
s'abstiennent.
On est à la veille de la rupture. La rupture élan, pour moi, ce serait affirmer que
le monde existe et que la France ne peut pas se couper de ce monde. Mais on ne peut
exclure une rupture socialiste, qui risquerait d'être, une nouvelle fois, une
rupture-trahison. Ce serait celle d'un parti qui arrive au pouvoir grâce aux voix des
"protégés" et qui s'adapte ensuite au "réel". Car il sera obligé
de le faire.
Propos recueillis par Sylvie Kauffmann et Arnaud Leparmentier Dessin Gianpaolo Pagni
La révolte annoncée des banlieues,
inquiétude et espoir
Dominique Vidal, Michel Warschawski
et Leila Shahid
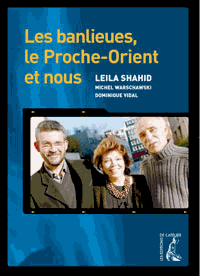 Ce dernier dialogue a lieu fin novembre 2005. Le 27 octobre, deux
adolescents, Zyed Benna et Buna Traoré, mouraient électrocutés dans un transformateur
électrique à Clichy-sous-Bois. Un troisième, Muhattin Altun, grièvement blessé,
indiquait que tous trois tentaient d’échapper à un énième contrôle de police. Ce
drame, suivi, le 30 octobre, du tir d’une grenade lacrymogène à quelques
centimètres de l’entrée de la mosquée Bilal de la ville, a déclenché dans plus
de 400 banlieues – sur fond de déclarations du ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy vécues comme de véritables provocations – un mouvement de révolte sans
précédent. Moins dans les formes qu’elle a empruntées – y compris une
violence de jeunes adolescents, qu’ils ont retournée notamment contre les
équipements collectifs de leurs propres quartiers – que dans son ampleur et sa
durée, tandis qu’une loi de 1955, datant de la guerre d’Algérie et instaurant
l’état d’urgence, était réactivée par l’Assemblée nationale. Les
alertes des acteurs de terrain comme des chercheurs, pourtant, ne manquaient pas quant aux
discriminations sociales, économiques, culturelles, mémorielles, qui traversent la
société française et que subissent ces banlieues, et sur lesquelles vous avez eu
l’occasion de revenir à plusieurs reprises. Palestinienne, Israélien, Français :
à l’appui des deux ans et demi de votre aventure, quel regard portez-vous finalement
sur cette actualité et sur ce qu’elle dit ? Ce dernier dialogue a lieu fin novembre 2005. Le 27 octobre, deux
adolescents, Zyed Benna et Buna Traoré, mouraient électrocutés dans un transformateur
électrique à Clichy-sous-Bois. Un troisième, Muhattin Altun, grièvement blessé,
indiquait que tous trois tentaient d’échapper à un énième contrôle de police. Ce
drame, suivi, le 30 octobre, du tir d’une grenade lacrymogène à quelques
centimètres de l’entrée de la mosquée Bilal de la ville, a déclenché dans plus
de 400 banlieues – sur fond de déclarations du ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy vécues comme de véritables provocations – un mouvement de révolte sans
précédent. Moins dans les formes qu’elle a empruntées – y compris une
violence de jeunes adolescents, qu’ils ont retournée notamment contre les
équipements collectifs de leurs propres quartiers – que dans son ampleur et sa
durée, tandis qu’une loi de 1955, datant de la guerre d’Algérie et instaurant
l’état d’urgence, était réactivée par l’Assemblée nationale. Les
alertes des acteurs de terrain comme des chercheurs, pourtant, ne manquaient pas quant aux
discriminations sociales, économiques, culturelles, mémorielles, qui traversent la
société française et que subissent ces banlieues, et sur lesquelles vous avez eu
l’occasion de revenir à plusieurs reprises. Palestinienne, Israélien, Français :
à l’appui des deux ans et demi de votre aventure, quel regard portez-vous finalement
sur cette actualité et sur ce qu’elle dit ?
Leila SHAHID – Ce qui m’a surprise, c’est précisément la surprise
manifestée par une partie de la société devant ces événements. Lorsque ont éclaté
ce que l’on a appelé les émeutes, j’étais à Bruxelles, pour prendre mes
nouvelles fonctions en Belgique et auprès de l’Union européenne. Mais j’ai eu
l’occasion de regarder la première émission de télévision, de plusieurs heures,
consacrée à cette explosion des banlieues, à laquelle participaient à la fois des
hommes politiques, des rappeurs, des sociologues... et enrichie de divers reportages. Or,
quelle était la question récurrente des journalistes ? Ils n’avaient de cesse de
demander : " Est-ce que vous comprenez ? " Comme si ces événements
surgissaient de façon tout à fait imprévisible dans un ciel serein, étant de ce fait
parfaitement incompréhensibles à l’honnête homme. Cette surprise et cette
incompréhension-là sont symptomatiques de quelque chose qui ne fonctionne pas bien en
France, d’une rupture de relations entre les médias, les instances politiques et les
milieux populaires et même lorsqu’ils font l’effort de prendre le temps
d’enquêter, les médias dévoilent en fait un état d’aveuglement sur la
réalité sociale.
Une question d’un jeune de la cité de l’Ariane, à Nice, m’avait
particulièrement frappée lors de nos débats : " Nous aussi, nous avons un mur ;
l’avez-vous vu ? " ; lorsque je lui ai répondu par la négative, il a repris :
" C’est normal, il nous sépare du centre-ville, mais il est transparent,
invisible. " La surprise exprimée dans la société ou dans certains médias ou au
cours de cette émission, c’est précisément la confirmation de ce mur. Celui
d’une ségrégation spatiale, entre villes et banlieues, entre banlieues riches et
banlieues pauvres, d’une ségrégation économique et sociale, d’une
ségrégation politique aussi, qui s’est traduite concrètement par le fait
qu’immédiatement, ce sont les " étrangers " qui ont été mis en
accusation.
" Une révolte populaire "
C’est le démenti le plus cinglant à l’interprétation donnée de la
révolte des banlieues par le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy – et,
avec lui, par une bonne partie des médias : le rapport de la direction centrale des
Renseignements généraux (RG), daté du 23 novembre 2005, dont Le Parisien a publié des
extraits le 7 décembre suivant.
" La France, estiment les RG, a connu une forme d’insurrection non
organisée, avec l’émergence dans le temps et l’espace d’une révolte
populaire des cités, sans leader et sans proposition de programme ". Les policiers
affirment qu’" aucune manipulation n’a été décelée permettant
d’accréditer la thèse d’un soulèvement généralisé et organisé ". Les
islamistes, en particulier, n’ont joué " aucun rôle dans le déclenchement des
violences et dans leur expansion " : ils auraient, au contraire, eu " tout
intérêt à un retour rapide au calme pour éviter les amalgames ". L’extrême
gauche, de son côté, " n’a pas vu venir le coup et fulmine de ne pas avoir
été à l’origine d’un tel mouvement ".
Concernant la nature du mouvement, les RG précisent : " Les jeunes des cités
étaient habités d’un fort sentiment identitaire ne reposant pas uniquement sur leur
origine ethnique ou géographique, mais sur leur condition sociale d’exclus de la
société française. " Le rapport ajoute toutefois : " Les jeunes des quartiers
sensibles se sentent pénalisés par leur pauvreté, la couleur de leur peau et leurs
noms. Ceux qui ont saccagé les cités avaient en commun l’absence de perspectives et
d’investissement par le travail dans la société française. (...) Tout s’est
passé comme si la confiance envers les institutions, mais aussi le secteur privé, source
de convoitises, d’emplois et d’intégration économique avait été perdue.
"
Redoutant la transformation des cités en " ghettos urbains à caractère ethnique
", les RG estiment le bras de la police " indispensable " mais "
insuffisant " et concluent : " Il est à craindre que tout nouvel incident
fortuit (décès d’un jeune) provoque une nouvelle flambée de violences
généralisées. "
Mais la ségrégation existe aussi dans la lecture même de cette actualité.
Lorsqu’un événement se produit en ville, nul n’en interroge le caractère
compréhensible ou non. Dès qu’il a lieu en banlieue, si. Cette crise était
pourtant prévisible. Combien de chercheurs ou d’observateurs sonnaient l’alarme
ces dernières années, mais demeuraient eux aussi absents, invisibles, passés sous
silence, dans le débat médiatique. Soudain, on leur a ouvert les plateaux de
télévision.
Entre les années 1970, au cours desquelles j’ai découvert les banlieues
françaises, et les années 2000, la société a évolué vers cette ségrégation. Je
n’ai pas pour habitude d’intervenir sur le terrain de la politique française.
Mais j’aime trop la France pour garder cette fois le silence. Or, j’ai observé
dans la plupart des discours des responsables politiques, avec lesquels je peux
m’identifier en tant que citoyenne, un total décalage avec ce que porte comme défi
sociologique, politique, historique, la colère exprimée en banlieues.
J’ai entendu ce mouvement historique de révolte avant tout comme un cri de
douleur et non de rejet ou de haine. Cri de douleur de ceux que l’on n’entend
pas et que l’on ne veut pas entendre. De toutes les voix que j’ai entendues,
celle que j’ai trouvée la plus authentique, la plus belle, la plus simple,
c’est celle des rappeurs, qui apparaissent comme les plus beaux commentateurs de ce
qui se passe en banlieues. Ce qui est le cas depuis plusieurs années déjà. Cela
m’a beaucoup réconciliée avec la culture, qui doit interpréter la réalité... Les
rappeurs sont en quelque sorte l’expression artistique de ce mouvement, avec une
grande richesse d’improvisation formelle, ils cassent le rythme, font de la
provocation justement pour susciter une réaction. Si certains de leurs textes, que je
qualifierais de poétiques, ont été condamnés ou censurés, c’est précisément
parce qu’on n’a pas voulu comprendre l’appel : " Aimez-nous parce
qu’on veut vous aimer. "
Ces événements sont venus confirmer beaucoup d’observations que nous avions
faites au cours de notre tournée dans les banlieues. Il y a là quelque chose à la fois
de très profond et de très spontané de la part des plus rejetés du système
économique, du système de production, du système éducatif. Et cela n’a rien à
voir avec des stratégies d’organisations politiques, de mouvements islamistes ou
d’associations.
Tandis que des journalistes nous demandaient si nous voulions " importer le
conflit israélo-palestinien dans les banlieues ", nous avons expliqué au contraire
pourquoi il nous semblait si important d’aller à la rencontre de citoyens ayant le
sentiment de ne pouvoir, eux, venir de l’autre côté du mur transparent. Nous avons
tenu à aller leur dire, ensemble, la réalité d’un conflit, l’existence de
deux sociétés, la résistance de la société palestinienne pour demeurer une société
saine, la diversité de la société israélienne, l’importance de l’existence
des mouvements de paix. Quant à l’expression " Intifada des banlieues ",
employée à la " Une " de certains journaux, elle n’émane nullement de
ces jeunes qui, au contraire, veulent s’affirmer comme ce qu’ils sont,
c’est-à-dire comme des jeunes Français. Et ce n’est peut-être pas un hasard
si certains leur accolent ce vocable arabe, " Intifada ", ou ont promis des
" reconduites à la frontière ", les désignant dès lors comme étrangers à
la société française, ce que toutes les enquêtes contredisent.
Dominique VIDAL – Je partirais de la même remarque : si trois personnes,
évidemment parmi d’autres, n’ont pas été surprises par ces événements,
c’est nous trois. Ce que nous avons constaté depuis près de trois ans nous a
préparés à comprendre les raisons de cette révolte des banlieues. Il faut souligner
et, étant français, je serais coupable de ne pas le faire, les responsabilités du
ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. Son discours provocateur – "
nettoyer au Kärsher ", " se débarrasser de la racaille " – a ouvert
la voie à des comportements d’une partie de la police encore plus provocateurs que
d’habitude. On saura un jour comment deux jeunes sont morts à Clichy électrocutés
dans un transformateur, mais il semble, à en croire les fuites sur le rapport de
l’Inspection générale des services (IGS), que la hiérarchie policière avait été
informée que ces deux jeunes, en compagnie d’un troisième, y avaient pénétré. La
Justice dira ce qu’il en est. Bref, on ne peut exonérer Nicolas Sarkozy de sa
responsabilité – majeure – dans le déclenchement de cette affaire, qui plus
est dans une perspective purement politicienne. Et je crains qu’il n’ait agi en
fonction non de la situation des banlieues, mais de sa concurrence politique avec le
Premier ministre Dominique de Villepin d’un côté, et avec des leaders de la droite
extrême et de l’extrême droite Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen de
l’autre. Il tentait – et tente toujours, par une surenchère sécuritaire, de
s’imposer à droite. On pourrait dire qu’il a mis le feu pour mieux
l’éteindre et en tirer le profit politique. Y compris dans les banlieues, où les
victimes des émeutes risquent de se tourner vers ceux qui sauront leur parler
sécurité...
Mais tout de même, nous savons que, si ce détonateur a fonctionné, c’est
qu’il y avait une poudrière que nous avions eu l’occasion de découvrir sur le
terrain durant ces deux ans et demi. Ce cocktail explosif comportait trois composantes :
une crise sociale, une crise post-coloniale (ou de discriminations raciales, si l’on
préfère) et une crise de représentation politique.
Pour prendre la mesure de la crise sociale, il suffit de lire le dernier rapport de
l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS (1)), soit 752 quartiers
peuplés de plus de quatre millions d’habitants. Ceux-ci concentrent deux fois plus
de chômage, deux fois plus d’échec scolaire et deux fois moins
d’établissements dentaires ou de santé que la moyenne du territoire français ;
leur revenu fiscal moyen est de 40 % inférieur et la délinquance y est supérieure de 40
%. On se situe là dans une espèce de comble du comble de la ségrégation sociale.
Pour les jeunes issus de l’immigration, africaine ou maghrébine notamment, cette
crise sociale est renforcée par un ensemble de discriminations – ce que Karim
Bourtel (2) appelle le racisme non comme discours ou comme violence, mais comme système.
C’est ce qui explique pourquoi ces jeunes ne bénéficient pas d’un accès égal
au logement, à l’école, à l’emploi, à la santé, à la culture...
Troisième élément : l’absence, dans la plupart de ces quartiers, d’un
espace politico-associatif organisé au sein duquel ces jeunes puissent s’exprimer.
Faute d’un tel cadre d’action, ils n’ont pas entrevu d’autre choix
– et je ne le partage pas – que de brûler à la fois des symboles des
discriminations qu’ils subissent et de la consommation qui leur est interdite.
Attention : ce cocktail explosif ne s’est pas formé en quelques mois, mais sur la
longue durée. Comme le disait, en novembre 2004, la Cour des comptes, qui n’est pas
un groupuscule gauchiste, " cette situation de crise n’est pas le produit de
l’immigration. Elle est le résultat de la manière dont l’immigration a été
traitée (...) les pouvoirs publics sont confrontés à une situation qui s’est
créée progressivement au cours des récentes décennies (3) ".
Ce qui m’a beaucoup frappé dans les débats, une fois ces chiffres et ces
analyses présentés, c’est la difficulté à résoudre deux questions : celle de
l’issue et celle du mouvement social capable de porter cette solution.
Concernant l’issue, la vraie question est : va-t-on résoudre le mal-être des
banlieues par la promotion d’une petite élite – une sorte de " beurgeoisie
" – à laquelle on demandera, en échange des avantages proposés, de maintenir
l’ordre dans les " communautés ", ou bien par la promotion de la masse des
jeunes de ces banlieues, et notamment ceux issus des immigrations africaine ou
maghrébine.
Soyons clairs : je ne crois pas qu’il faille mépriser les petites avancées. Je
déteste l’expression " discrimination positive ", qui résulte
d’ailleurs d’une erreur – intentionnelle ? – de traduction : en
américain, cela s’appelle positive action, affirmative action. Ainsi, par exemple,
il me semble très positif que quelque deux cents jeunes soient entrés à l’Institut
d’études politiques de Paris par le biais d’une convention passée avec des
lycées de zones d’éducation prioritaires (ZEP). Et il serait bon que ce système
puisse s’étendre à toutes les grandes écoles françaises. Mais cela, en tout état
de cause, n’assurerait que la promotion de quelques centaines de jeunes, alors
qu’il s’agit d’en promouvoir des centaines... de milliers !
Dans cette révolte des banlieues, on a touché du doigt l’incapacité des
responsables politiques, de la gauche – officielle – comme de la droite,
d’entrer dans ce débat. Pour une raison simple : contrairement aux conflits sociaux,
qui peuvent être surmontés par la médiation des syndicats, voire par des compromis
entre syndicats, patronat et État, la question des banlieues ne se résoudra que par des
réformes radicales et coûteuses. Il s’agit de casser la ghettoïsation, donc
d’imposer la mixité sociale, notamment en construisant 20 % au moins de logements
sociaux dans toutes les villes, comme l’exige la loi Solidarité et renouveau urbain
(SRU), qu’un grand nombre de villes refusent d’appliquer, préférant payer des
amendes. Il s’agit aussi d’impulser une nouvelle politique de l’emploi, de
l’école, de la santé, de la culture... Bref, il s’agit de rompre avec les
politiques néo-libérales voulues par le Fonds monétaire international (FMI), la
commission de Bruxelles, mais aussi nos gouvernements de droite et – avec des
différences, mais à la marge – de gauche. Un tel débat est exclu pour une grande
partie des appareils politiques français.
La seconde chose qu’a révélée au grand jour la révolte des banlieues, et que
nous avons vécue parfois à travers la difficulté à mettre sur pied tous ces débats et
ces rencontres, c’est le désert politique, syndical et associatif en leur sein.
Jamais cette révolte, je le répète, n’aurait eu les caractéristiques qu’elle
a eues, c’est-à-dire des milliers de jeunes brûlant des voitures, des écoles et
des magasins, si la gauche n’avait déserté ces banlieues (4). Non pas
volontairement, mais en liaison avec le départ progressif de " Français de souche
" pouvant accéder ailleurs à un autre habitat, souvent en l’achetant.
Même le Parti communiste n’a pas échappé au phénomène. Il a sans doute
conservé des bastions dans les banlieues, mais ceux-ci s’avèrent souvent plus
institutionnels que militants. Même s’il faut reconnaître les efforts déployés
par les militants communistes pour maintenir le lien entre les populations en général et
les jeunes de ces quartiers. Quant au mouvement altermondialiste, il n’a pas pris
racine dans ces banlieues : il demeure un mouvement de centres-ville, un mouvement
intellectuel et de classes moyennes plus qu’un mouvement ouvrier et a fortiori de ces
banlieues. Mais la révélation pour ceux qui ne s’y intéressaient que de loin,
c’est qu’aucun des mouvements issus de l’immigration et notamment de la
marche pour l’égalité de 1983 n’a comme chacun l’a d’ailleurs
reconnu, " touché sa bille " : pas plus les mouvements du type du "
Collectif des musulmans de France " proche de Tariq Ramadan, que le Mouvement de
l’immigration et des banlieues (MIB), les " Motivés " de Toulouse ou
encore de nouveaux venus comme les " Indigènes de la République "...
Or, il est évident qu’il s’agit là d’une question clé. Si le
mouvement de ces jeunes ne parvient pas à se structurer, à se donner une autonomie
réelle grâce à laquelle il pourrait former ses propres cadres et élaborer ses propres
objectifs, mais en même temps à bâtir des ponts comme, pour notre part, nous avons
essayé de le faire, entre ces mouvements et l’ensemble du mouvement populaire, alors
je ne sais pas où nous irons. La révolte des banlieues ne se résume pas à ceux qui
brûlent des voitures ; nous avons rencontré d’autres jeunes, qui veulent apprendre,
discuter, comprendre, construire et donc lutter. Ce vivier de jeunes, qui désirent et
souvent savent prendre des initiatives diverses, multiples, a besoin à la fois
d’autonomie et d’alliances.
Leila SHAHID – Dans le Nord, à Roubaix, à Tourcoing, à Mons-en-Bareuil, dans le
Sud, dans les quartiers Nord de Marseille et ailleurs, nous avons eu la chance de
participer à de vraies rencontres, et je garde en mémoire des visages, des plaisirs
réels. J’ai pu aussi constater avec satisfaction que le fait d’aller vers eux
contribuait à produire des idées, des pratiques, des rêves réalisables, des concerts,
des livres, avec le sentiment de réhabilitation de leur dignité. On a pu mesurer combien
la seule identification avec la Palestine, c’est la réhabilitation de la dignité,
du respect, et le désir de coexistence dans la différence.
La tentative de présenter leur révolte, née ce 27 octobre à Clichy-sous-Bois, comme
une révolte de cités arabo-musulmanes contre la civilisation française, comme la
manifestation du " clash de civilisations " que certains appellent de leurs
vœux, a fait long feu. Après deux ans et demi, dans l’une des villes où nous
avons participé à un débat avec quelque 600 personnes, Michel et moi avons été
surpris d’être chaudement félicités pour nos propos, tandis qu’en revanche
les mêmes personnes – " françaises de souche ", dans l’assistance,
affirmaient ne pas comprendre pourquoi Dominique, pour sa part, intervenait sur la
réalité des discriminations en France, de l’échec scolaire, du chômage, en citant
les chiffres officiels et les travaux de recherche les plus sérieux sur ces questions.
Une telle réaction était très significative de la difficulté de certains milieux à
reconnaître la réalité sociale, économique et politique des banlieues. Or, Dominique
concluait ainsi ses interventions : nous pensons qu’il n’y a pas d’issue
sans alliance entre le mouvement social progressiste des jeunes des villes avec les jeunes
des cités. En tant que citoyens militants, nous considérons comme un devoir d’y
contribuer. Tout cela apparaît évident au grand jour aujourd’hui, après la
révolte des banlieues.
Un tel trio était important aussi pour un militant israélien et une militante
palestinienne considérant que la France est aussi un exemple de pratiques politiques.
Nous ne sommes pas deux citoyens étrangers arrivant dans une bulle : je pense que la
France représente aussi une terre de pratiques citoyennes, républicaines, laïques. Elle
est héritière non pas seulement d’un jargon égocentrique, mais aussi d’un
passé historique fort de ses solidarités. Aussi, sommes-nous de ceux qui pensent
qu’il faut participer à cette alliance et la construire ensemble.
Michel WARSCHAWSKI – Pour rebondir, je commencerai par la conclusion que je me
suis permis d’exprimer à l’occasion d’un colloque d’historiens, à
Blois, sur le modèle français vu de l’extérieur : ce modèle, dans lequel ma
génération encore a grandi, n’existe plus. Si l’on compare ce modèle
intégrateur français au modèle multiculturel que l’on décrit souvent en France
comme un modèle ségrégationniste, on constate pourtant que la ségrégation sévit en
France aussi. Guerre des modèles ? Je ne crois pas que la question se pose en ces termes.
Mais il faut bien revenir en revanche sur ce qu’indique la surprise manifestée par
ceux qui ne perçoivent pas la réalité de ces ségrégations, et dont parle Leila, pour
réfléchir au profond défi actuel.
La surprise est typique d’une situation où l’" intégration " ne
fonctionne pas, c’est-à-dire où se forment des murs dans la société et où, dès
lors que l’on propose de regarder de l’autre côté, se manifestent malaise et
incompréhension. Comme si l’on pouvait se suffire de voir de son propre côté du
mur, à l’intérieur de sa tribu, en développant éventuellement des idées
généreuses concernant l’autre côté, mais sans jamais connaître ceux qui y vivent
ni ce qui s’y joue. L’autre n’est plus un sujet, il devient au mieux
l’objet d’une analyse, peut-être d’une empathie, voire d’une
condescendance.
Lorsque a éclaté l’Intifada, la société israélienne a été surprise. Mais
elle ne l’a pas été qu’à cette occasion. Elle l’a été aussi, dans les
années 1960, face au mouvement des Panthères noires (5) en Israël ; ou lorsque le Shass
(6) a obtenu quatre mandats. Première surprise, la découverte de l’existence du
Shass ; deuxième stupéfaction, le doublement de ses mandats, quatre ans plus tard,
lorsqu’il a obtenu huit sièges a la Knesset, le Parlement israélien ; troisième
enfin, lorsque, quatre ans plus tard encore, il triple ses voix. Cet ébahissement,
manifesté dès lors qu’un tel mouvement apparaît sur la scène, constitue le
symptôme d’une méconnaissance de ce qui se passe à l’intérieur même de la
société, dans les villes pauvres, celles du sud d’Israël en particulier. Ce qui a
manqué, ce ne sont pas les outils de compréhension, mais la volonté de voir et de
sortir de la connaissance de sa seule tribu.
Dans une telle perspective, les explications passent forcément par des discours sur la
culture de l’autre, son " essence " supposée, son être ; ici, en France,
on dira " c’est l’islam ", ou bien " c’est la polygamie
". Dans une société véritablement intégrée, on ne peut être surpris. On peut
être d’accord ou non, exprimer une harmonie ou un rejet, mais pas la surprise. Dès
lors, quel est le risque ? Celui de rejeter les principes du pacte républicain lui-même
au nom de son dysfonctionnement, d’entrer, d’un point de vue institutionnel,
dans un modèle multi-ethnique à l’anglo-saxonne, chaque " groupe " étant
assigné à rester dans l’entre-soi, ou bien se projeter vers un horizon de "
clash des civilisations ".
Ce qui se joue dans les banlieues ne relève pas que d’une question sociale. Ce
refus de voir l’" apartheid social " et l’" apartheid culturel
" indique combien la question post-coloniale et identitaire est une dimension
française à laquelle la gauche n’est pas encore préparée. Or, on ne peut faire
l’impasse de cette dimension. Et pourtant, nous faisons face à une difficulté
intellectuelle, politique, de la gauche française à admettre qu’à la question
sociale se mêle la question post-coloniale.
Je ne reconnais pas du tout dans les brûleurs de voitures les jeunes que nous avons
rencontrés. Je ne précise pas cela pour émettre un jugement. Mais nous avons dialogué
avec des cadres, au moins potentiels, des jeunes qui réfléchissent à ce qu’est et
à ce que pourrait être la citoyenneté dans la différence, à ce que pourrait être un
mouvement social intégrateur. Ces jeunes-là sont tout autant les banlieues. À
Marseille, par exemple, où il s’agit moins d’une banlieue que d’un
quartier dans la ville, les voitures n’ont pas brûlé, et il faut remarquer entre
autres que là, les jeunes sont organisés. Il y a donc un problème de visibilité et
d’invisibilité, dont je serais prêt à parier qu’elles sont inversement
proportionnelles aux réalités.
Ensuite, mais cela s’inscrit dans la même logique, se posent concrètement les
questions liées aux déserts politiques et à l’extériorité des pratiques comme
des discours de ceux qui ont pourtant su exprimer leur compréhension de la colère
manifestée dans ce mouvement, leur empathie avec les raisons de la colère des jeunes,
leur critique et leur condamnation de la politique du gouvernement, de la provocation, de
la répression, de l’état d’urgence... L’une des raisons d’être,
presque le drapeau que notre initiative a voulu porter, dans la continuité de la
neuvième mission de protection civile de l’Union juive française (UJFP) et de
l’Association des travailleurs maghrébins de France (AMFP) et du colloque organisé
par Joss Dray à Saint-Denis, c’est, je le répète une fois encore, le concept du
taayoush. Il est paradoxal de partir du conflit en Palestine, lequel est un conflit
militaire, violent, avec des tanks et des avions de chasse, qui a engendré plusieurs
milliers de morts, pour porter non le conflit, mais le taayoush. Pour dire " vous
êtes en manque terrible de taayoush ". Ce n’est pas une question subsidiaire,
mais le cœur de la question. Et pourtant, lorsque Leila Shahid est venue ainsi
débattre dans certaines villes, se sont créés dans les quartiers des liens qui, avant,
n’existaient pas, entre des municipalités et des groupes de jeunes en quête de
reconnaissance et de légitimité avec l’objectif de mener des actions, précisément
dans leurs quartiers, et pas forcément d’ailleurs pour la Palestine. Dire la
nécessité du taayoush semble en avance sur une réalité qui n’existe
malheureusement pas encore.
Je voudrais ajouter une réflexion sur un aspect secondaire par rapport à ces
événements, mais qui me semble important pour notre initiative : parmi tous les
équipements brûlés, on ne compte pas une seule synagogue. Cela ne nous surprend
évidemment pas pour ce qui nous concerne. Mais il faut souligner combien cela contredit
de façon catégorique les thèses ou la propagande – de ceux qui ont cherché à
établir un trait d’union entre banlieues et antisémitisme. Cela confirme au
contraire qu’on est face à une grande révolte, mais qu’elle ne relève en rien
du confessionnel et très spécifiquement n’a rien d’anti-juif. Dans un
quotidien israélien, Ha’aretz, Alain Finkelkraut (voir page 114) finit par évoquer
un " pogrom contre la République ", et affirme : " Lorsque l’on
s’attaque à la France, on s’attaque aux Juifs " ; en s’attaquant à
la civilisation, on s’attaque à la civilisation judéo-chrétienne (7). En
réalité, on le voit là : tout le mensonge entretenu durant quatre ans, selon lequel les
banlieues seraient gangrénées par l’antisémitisme, tombe. Ce discours va-t-il
être remplacé par un autre, le discours civilisationnel ?
Dominique VIDAL – Cela fait trois ans qu’au nom de l’" affaire du
voile ", on a divisé tout le mouvement ouvrier, syndical, démocratique, associatif.
Or, dans la première grande révolte des banlieues, il n’y a pas eu une once de
religieux, pas de rôle pour l’islam et encore moins pour les islamistes. Même les
tentatives de ces derniers pour rétablir le calme ont fait long feu, y compris cette
étrange fatwa anti-violences de l’Union des organisations islamiques de France
(UOIF) – ses responsables expliqueraient-ils la violence par l’islamité (8) ?
Bref, l’épouvantail islamiste est apparu dans sa réalité : une opération de
diversion politicienne. Quand ceux qui l’ont menée, à gauche comme à droite,
allant jusqu’à dénoncer une volonté d’" islamisation de l’Occident
", feront-ils leur autocritique ?
Leila SHAHID – Les questions liées au mode d’organisation des relations dans
la société et au rapport à la laïcité se posent aussi à propos de la Constitution
palestinienne. Quelles relations articuler, par exemple, entre les religions et
l’État ? Quelle place pour le droit, faut-il des tribunaux dépendant du religieux,
comment définir une laïcité s’adaptant à la réalité historique palestinienne,
à celle du monde arabe, et partant aux musulmans du XXe siècle ? Comment tenir compte
notamment des mouvements de réforme qui les ont marqués ? Il nous faut inventer des
formes de laïcité correspondant à ces réalités. Elles ne calqueraient pas forcément
sur laïcité française, mais elles pourraient apprendre énormément.
Michel WARSCHAWSKI – Ces questions se posent aussi, sous d’autres formes, à
la société israélienne. Comment définir une citoyenneté dans un État qui s’est
construit non seulement en référence à la religion mais aussi aux différentes
communautés nationales qui composent la société ? Il nous faut savoir appréhender ces
réalités, ces spécificités, ces évolutions, sans sombrer dans le particularisme. Il
est vraisemblable que la construction de l’Europe changera aussi les champs
d’appartenance multiples des citoyens qui la composent et leur perception
identitaire. Celle-ci sera à la fois nationale et élargie à des espaces plus vastes ;
elle comportera de nouvelles dynamiques qui devront tenir compte des communautés
extra-européennes et des élargissements à venir.
Je voudrais terminer en disant ici ce qui peut motiver notre optimisme. Nos deux ans et
demi de tournée, comme ce qui s’exprime avec force aujourd’hui, portent à
réfléchir à la suite. En dépit des sollicitations pour poursuivre cette aventure dans
d’autres villes et d’autres banlieues, il me semble qu’il faut imaginer une
autre étape. Et ce, non pas seulement parce que Leila est appelée à d’autres
fonctions comme ambassadrice de la Palestine à Bruxelles et auprès de l’Union
européenne. Mais pour d’autres raisons, de fond.
D’abord, parmi les animateurs de ces débats, nombre d’idées ont émergé
pour poursuivre autrement cette aventure et perpétuer un travail de transmission. Nos
amis lillois envisagent par exemple de mettre en réseau les expériences et
d’organiser d’autres formes de rencontres. Comme des tournées thématiques. Ils
envisagent d’inviter des femmes, israéliennes et palestiniennes, à parler avec les
femmes des quartiers lillois. Ce qui suppose un minimum de structure. Ensuite, parce que
la jeunesse ne peut que nous rendre optimistes. Qu’il continue à y avoir des prises
de paroles du même type, c’est-à-dire avec trois regards, semble important. Mais je
crois qu’il faut aujourd’hui rajeunir ces regards. Or, et c’est ce qui
motive mon optimisme, une nouvelle génération a émergé aussi en Palestine et en
Israël, comme le confirment, ici en France, les interventions extrêmement efficaces des
dirigeants de l’Union générale des étudiants palestiniens (GUPS) ou celles des
jeunes militants israéliens de Taayoush, ou encore de ceux que l’on nomme les "
anarchistes contre le mur ". Des jeunes, ici et là-bas, qui ne pratiquent pas la
langue de bois, mais s’inscrivent résolument dans leurs réalités spécifiques,
pour les transformer ensemble.
(1) Voir sa synthèse : www.ville.gouv.fr/pdf/editions/obse...
(2) Karim Bourtel et Dominique Vidal, Le Mal-être arabe, op. cit.
(3) www.ccomptes.fr/cour-des-comptes/pu...
(4) Lire, notamment, Olivier Masclet, La Gauche et les cités. Enquête sur un
rendez-vous manqué, Paris, La Dispute, 2003.
(5) Panthères noires : nom du mouvement de révolte de jeunes israéliens
d’origine orientale (marocaine en particulier), au début des années 1960, contre la
discrimination dont étaient – et sont toujours encore – victimes les
populations juives de culture arabe.
(6) Shass : parti religieux ultra-orthodoxe créé au début des années 1980 par
l’ancien grand rabbin sépharade d’Israël, Ovadia Yossef, pour créer des liens
entre l’électorat juif de culture arabe et son héritage culturel. Pour une forte
minorité de juifs orientaux, le Shass est devenu leur parti, sans qu’ils partagent
nécessairement la dimension religieuse de son idéologie.
(7) Haaretz, Tel-Aviv, 18 novembre 2005.
(8) Voir Le Monde, 7 novembre 2005.
 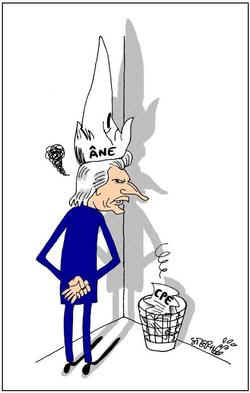
En France, le dialogue social doit-il
obligatoirement passer par un bras de fer ?
Le mécanisme semble bien réglé : on impose d’abord, on négocie après.
Entre-temps, chaque fois, la révolte est dans la rue. Qu’il s’agisse des
retraites, du « smic jeunes », ou aujourd’hui du CPE, les réformes sont
présentées par des ministres « droits dans leurs bottes », récoltant un refus tout
aussi radical, au prix d’une paralysie des universités, d’une mobilisation
coûteuse, sous les yeux réjouis des médias. L’affrontement plutôt que la
négociation, le passage en force plutôt que le compromis : le bras de fer en guise de
dialogue social serait-il une spécialité française ? Plus qu’un choix raisonné de
politique, il semble être un véritable réflexe. Au fil de plusieurs livres, le
sociologue Philippe d’Iribarne a étudié, en les comparant à d’autres cultures
politiques, les origines de ce particularisme. Il publie aujourd’hui
L’Etrangeté française, où il interroge l’avenir de notre modèle social aux
prises avec la mondialisation.
Télérama : En voyant les étudiants manifester et occuper les universités, tandis que
le gouvernement campe sur ses positions, quelles sont vos réflexions ?
Philippe d’Iribarne : Dans cette affaire, le Premier ministre joue une partition
traditionnelle : il se veut l’homme des Lumières qui va éclairer le peuple, lui
montrer qu’il est mal informé, qu’il a tort. De sa part, reculer ou négocier
serait se montrer électoraliste et démagogique. Seulement le contrat première embauche,
voulu comme un outil technique pour favoriser une meilleure fluidité de l’emploi,
est perçu sous un tout autre registre, celui de l’honneur : « Pourquoi
pourrions-nous être congédiés d’un claquement de doigts ? », « Pourquoi ne pas
nous traiter comme tout le monde ? », dénoncent les étudiants. La question qu’ils
posent est : qu’est-ce qui est digne ou pas ? C’est l’imaginaire de la
domesticité qui resurgit. Le thème de l’humiliation a été également très
présent lors des événements qui ont touché les banlieues cet automne.
Télérama : Cette logique de l’honneur est selon vous une spécificité française.
Pourquoi ?
Philippe d’Iribarne : En Allemagne, devant un conflit de ce genre, on va
immédiatement se mettre autour d’une table et travailler jusqu’à ce qu’on
trouve un compromis. Pour nous, le compromis est vil, pas très loin de la compromission :
ne parle-t-on pas de « consensus mou » ? On rêve d’une unanimité « naturelle »
sur des idées indiscutables tant elles sont pertinentes !
Cette différence de culture remonte à loin. L’Angleterre du XVIIIe siècle, par
exemple, est très inspirée par le philosophe Locke dans sa lutte contre le despotisme.
Au même moment, les penseurs de la Révolution française, en particulier Sieyès,
dénoncent les privilégiés, mais avec cette question : pour fabriquer de
l’égalité, faut-il supprimer tous les privilèges, ou faire en sorte que tout le
monde devienne privilégié ? La question perdure aujourd’hui. Nous plaidons pour
l’abolition des privilèges (en tant que citoyens, par exemple) et en même temps
nous aspirons à être tous privilégiés. Voyez par exemple les réactions lorsqu’on
propose l’apprentissage à 14 ans, ou la suppression du collège unique. Les citoyens
se dressent, parce qu’ils perçoivent ces mesures comme des atteintes à la conquête
d’avantages pour tous.
Télérama : En fait, c’est l’égalité qui structure notre imaginaire politique
?
Philippe d’Iribarne : Oui, et ce souci d’égalité symbolique est lié à notre
histoire, en particulier à la critique, à l’époque révolutionnaire, de tout lien
de subordination. Les Anglo-Saxons s’en sont sortis grâce, paradoxalement, à
l’idée de propriété : chacun est propriétaire de lui-même et de ses œuvres,
vendre son travail comme un artisan vend sa production n’est pas dégradant, au
contraire. Aux Etats-Unis, la distinction entre emplois précaires et emplois stables
n’est pas aussi nette qu’ici, et un travailleur peut parfois être « congédié
» brutalement sans qu’il se sente atteint au plus profond de sa dignité... même si
cette expérience n’a rien d’agréable. Chez nous, au contraire, le travail
risque toujours de devenir sujétion. Et dans le fait de se soumettre à autrui, il y a
quelque chose d’indigne. Les moines et les domestiques se sont ainsi trouvés exclus
du droit de vote au motif qu’ils n’avaient pas l’autonomie de pensée qui
fait le citoyen ! La Révolution a fait une lecture ravageuse de la situation de
subordination et, pendant tout le XIXe siècle, le statut même de salarié était sujet
à caution : le salarié étant subordonné, n’est-il pas au fond un larbin ?
Pour compenser ce doute, il a fallu construire un système où tout métier, même au bas
de l’échelle, est entouré de statuts, de reconnaissances écrites ou non, de
protections. C’est ce qui fait la dignité de chacun dans notre système.
Télérama : C’est ce qu’on appelle nos avantages acquis, que nous défendons et
dénonçons à la fois ?
Philippe d’Iribarne : Aujourd’hui, nous vivons une véritable tectonique des
plaques. Dans la première plaque, nous avons cette culture des statuts et des
protections, même si tous les métiers ne sont pas égaux de ce point de vue. Dans la
seconde progresse l’idée d’une régulation des places par le marché. Idée qui
ne fait pas problème pour les Anglo-Saxons : alors que nous percevons le marché comme
fondamentalement injuste, ils l’envisagent comme un juge de paix, qui rend ses
verdicts et détermine en toute impartialité les gagnants et les perdants. Dans une telle
logique, un perdant ne se pense pas comme un raté, il se dit qu’il traverse une
mauvaise passe et qu’il va rebondir, quitte à cumuler trois boulots de promeneur de
chiens… Ce sont deux logiques totalement contradictoires.
Le CPE, visant à flexibiliser l’emploi, va évidemment vers la logique du marché.
Pour la gauche socialiste, c’est insupportable, mais elle s’est mise dans une
contradiction dramatique en disant d’un côté que les individus doivent garder leurs
« avantages acquis », de l’autre que la mondialisation est une bonne chose. Or la
mondialisation conduit forcément à une marchandisation des personnes et à une
destruction de leurs protections. Alors comment concilier ces imaginaires ? A droite, on
dit que la concurrence est inévitable. A gauche, on s’en sort en disant : tous les
citoyens sont performants dans le domaine économique si on leur procure un bon niveau
d’enseignement.
Télérama : Et ailleurs, le choc entre ces deux logiques est-il moindre ?
Philippe d’Iribarne : Comme nous, les Allemands peinent à combiner trois exigences :
une économie très ouverte, des statuts forts (CDI, 35 heures, salaire minimum, etc.) et
un bas niveau de chômage. Actuellement, toutes les sociétés occidentales réussissent
à combiner deux de ces termes, pas trois. Les Anglo-Saxons obtiennent une économie
ouverte et un bas chômage, mais au prix d’une marchandisation des personnes et
d’un grand nombre de travailleurs pauvres. Les Danois, qu’on cite si souvent en
modèles, combinent société ouverte et bas chômage, au prix d’un dirigisme envers
les individus qui serait difficile à vivre pour les Français. En France, c’est
l’impensé qui nous amène dans l’impasse. Contre le discours un peu rigide de
la dignité, certains ont la tentation de faire table rase du passé et de dénigrer tout
notre système. Il vaudrait mieux comprendre nos contradictions et les dépasser.
Télérama : Comment ?
Philippe d’Iribarne : Je vois au moins deux directions. D’abord, renoncer à la
sacralisation du marché. En inscrivant le développement de la concurrence dans le
traité de Rome de l’Union européenne en 1958, on a enclenché une mécanique
infernale. A quoi bon fiche en l’air la vie de tous pour que quelques-uns deviennent
plus riches ? Le « non » des Français et des Néerlandais au référendum européen en
2005 a été un coup de semonce, et il semble urgent de sortir de notre aveuglement. Le
marché doit être cadré. On y viendra, forcément… On devrait avoir au minimum le
pragmatisme des Américains : ils sont libéraux quand ça les arrange, mais quand une
société de Dubai veut racheter leurs installations portuaires, ils savent devenir
protectionnistes…
Ensuite, il faut s’interroger sur les tabous liés à notre vieille logique de
l’honneur, et renouveler notre vision des métiers. Par exemple, il est important de
« donner leurs lettres de noblesse », comme disait Claude Allègre, lorsqu’il
était ministre de l’Education, aux filières techniques et à l’apprentissage,
de mettre de l’argent dans les formations, dans l’accompagnement des chômeurs.
Non, il n’est pas déshonorant d’être accompagné dans sa recherche
d’emploi. Oui, il est urgent de sauvegarder, voire de recréer, la dignité des
métiers.
Propos recueillis par Dominique Louise Pélegrin
Télérama n° 2932 - 21 mars 2006
La France est-elle menacée par le
communautarisme ?

Juifs, musulmans, Noirs, Blancs… Les communautés,
réelles ou imaginaires, deviennent le centre de gravité du débat en France. Faits
divers, banlieues, problèmes de société… En présentant comme un tout, uni, « la
» communauté musulmane ou « la » question noire, par exemple, cette vision
essentialiste amalgame, caricature, se nourrit de la peur de l’autre. Et le
vocabulaire ethnico-religieux répandu par une partie des élites de notre pays, à droite
comme à gauche, évite soigneusement d’aborder de front les questions économiques
et sociales. Qui sont souvent plus centrales que la question religieuse. Ce discours, qui
assigne chacun à une identité, prépare-t-il un dangereux « choc des communautés » ?
Michel Wieviorka, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, dresse le portrait d’une France en pleine crise identitaire.
Télérama : L’« ethnicisation » du débat correspond-elle à une réalité sur le
terrain ?
Michel Wieviorka : La question n’est pas nouvelle. Dès la fin des années soixante,
on a assisté à une poussée des identités régionales, bretonne et occitane, par
exemple. Les Juifs, à la même époque, sont devenus plus visibles ; encouragés par les
travaux des historiens, en particulier ceux de l’Américain Robert Paxton, ils ont
imposé un autre regard sur le rôle de la France de Vichy dans leur déportation. On
pourrait citer aussi le réveil arménien : après la phase terroriste des années
soixante-dix, il a abouti, sous le gouvernement Jospin, à la reconnaissance du génocide
de 1915. Mais, malgré toutes ces poussées identitaires, peu de communautés concrètes
existent aujourd’hui en France. Prenons les « banlieues » : on y trouve évidemment
des noyaux de vie communautaire, mais ces quartiers, qui accueillent souvent des
populations venant d’une vingtaine ou d’une trentaine de pays différents, sont
peu structurés sur un mode communautaire. Il est rare que des territoires soient
nettement marqués par des appartenances culturelles ou religieuses.
Télérama : A partir de quand, alors, peut-on parler de communautarisme ?
Michel Wieviorka : Quand il y a fermeture du groupe sur lui-même et subordination des
individus à sa loi. La femme est souvent la première à être soumise à cette loi du
groupe, avec les mariages forcés, par exemple. Le communautarisme commence quand un
groupe refuse les mariages mixtes et qu’il met en place ses propres institutions,
écoles, hôpitaux, services sociaux. A cet égard, l’évolution au sein du monde
juif est significative. Erik Cohen, un sociologue israélien qui vient d’enquêter en
France, a montré une tendance à la communautarisation. Le nombre d’enfants
scolarisés dans des écoles juives a considérablement augmenté depuis une quinzaine
d’années. Parfois, il est vrai, pour des raisons de sécurité. Allons-nous, pour
autant, vers un conflit entre la République et les identités particulière ? Pas
nécessairement. Regardez comment l’islam a volé au secours de la République lors
de l’enlèvement des journalistes Chesnot et Malbrunot en Irak. Des délégués du
Conseil français du culte musulman (CFCM) sont allés à Bagdad demander leur
libération, en affirmant à la fois leur identité musulmane et leur adhésion aux
valeurs républicaines.
Télérama : Mais, en encourageant ce type de démarches, alors que le CFCM a été créé
pour réglementer le culte et non pour représenter les musulmans, l’Etat ne
joue-t-il pas la logique communautaire
Michel Wieviorka : Certes, il y a un petit côté postcolonial, comme si l’Etat avait
dit à cette délégation : « Vous allez nous donner un coup de main puisqu’on vous
a reconnus… » Mais ça n’empêche pas divers acteurs musulmans d’agir de
leur propre initiative. On l’a vu lors des émeutes de cet automne quand des imams
ont demandé aux jeunes de ne pas se livrer à la violence. J’ajoute que les
musulmans ne se reconnaissent pas forcément tous dans le CFCM.
Télérama : Justement : on parle souvent de « la » communauté musulmane ou de « la »
communauté juive comme si elles formaient un tout homogène. Ces « communautés » ne
sont-elles pas imaginaires ?
Michel Wieviorka : Bien sûr ! L’anthropologue américaine Benedict Anderson l’a
expliqué dans son fameux livre sur les nations, Imagined Communities, les communautés
imaginaires (1). De plus en plus, l’appartenance à une communauté repose sur une
décision personnelle. Elle est alors non pas imposée, mais choisie. Et elle ne se
définit pas de la même façon pour tous ses membres. L’identité juive, par
exemple, n’est pas facile à cerner : comme l’a joliment dit Richard Marienstras
dans Etre un peuple en diaspora (éd. Maspero, 1975), le fait que les Juifs passent leur
temps à se demander ce qu’est l’identité juive est, peut-être, la définition
même de cette identité ! Tous les Juifs ne sont pas croyants, n’ont pas non plus la
même attitude à l’égard d’Israël, ni la même appréhension de la menace que
constitue l’antisémitisme actuel.
Télérama : Pourtant, le CFCM, pour les musulmans, et, depuis peu, le Cran, Conseil
représentatif des associations noires, semblent reproduire le modèle communautaire du
Crif, le Conseil représentatif des institutions juives...
Michel Wieviorka : Les Juifs de France ont plutôt réussi leur intégration. Ils ne se
heurtent pas à des discriminations, à des difficultés d’accès à l’emploi,
à l’école, au logement. Ils subissent par contre des menaces, de la haine, des
violences. Je qualifie leur mode d’intégration de « postrépublicain », car il
conjugue la plus grande adhésion à l’idéal républicain et une forte visibilité :
ils sont reconnus dans l’espace public. Evidemment, leur modèle donne des idées à
certains et du ressentiment ou de la jalousie à d’autres…
Télérama : Quand le chef du gouvernement et de nombreux ministres assistent au dîner
annuel du Crif, n’est-ce pas encourager le communautarisme ?
Michel Wieviorka : Le Crif n’est en rien contraire à l’idéal républicain.
Mais faut-il généraliser ce type d’instance ? En janvier dernier, au dîner du
Cran, cette jeune fédération d’associations noires qui se propose de lutter contre
le racisme et de promouvoir la diversité, il n’y avait quasiment aucun homme
politique. Mais il est vrai que le Cran n’a ni l’âge du Crif, vieux de plus de
soixante ans, ni sa légitimité historique. Nous sommes dans un pays où se constituent,
qu’on le veuille ou non, des identités particulières – pour éviter le mot «
communautés » – qui demandent à être reconnues dans l’espace public. Avec le
risque que se développent des lobbies. Mais ce phénomène a aussi un aspect positif :
dans une période de pertes de repères et de crise sociale, ces identités particulières
offrent un ancrage. Et ne sont pas forcément le contraire des valeurs universelles, le
Droit, la Raison…
Télérama : La discrimination positive, à l’image du modèle américain, apparaît
désormais aux yeux de beaucoup comme la réponse adaptée. Est-ce votre avis ?
Michel Wieviorka : Les politiques de discrimination positive sur des critères ethniques,
raciaux ou religieux, sont à proscrire ! Annoncer la nomination d’un « préfet
musulman », comme l’avait fait Nicolas Sarkozy avec Aïssa Dermouche en 2004, est
une catastrophe. Un préfet ne doit pas être choisi en tant que musulman, mais en
fonction de sa compétence. De même, ce n’est pas avec des quotas de journalistes de
couleur qu’on réglera la question, même si les Noirs – ou les Arabes –,
socialement défavorisés, sont peu présents dans la politique ou les médias… La
discrimination positive est acceptable si elle n’est ni ethnique ni raciale, mais
sociale. La droite et la gauche n’en ont pas la même vision. La version de droite,
libérale, donne aux meilleurs éléments d’un groupe défavorisé des chances de
réussir, au risque de laisser le reste du groupe tomber plus bas. Je préfère
réfléchir à des mesures permettant à tout le groupe de monter, comme pourrait le
faire, pour l’éducation, une vraie politique de ZEP (zones d’éducation
prioritaire).
Télérama : La France reconnaît désormais sa dimension multiculturelle. Est-elle en
train de changer de modèle ?
Michel Wieviorka : Elle vit un mouvement de bascule incertain entre un modèle classique
républicain, où il n’y a place que pour des individus égaux en droit, et une
formule nous rapprochant d’un modèle à l’anglo-saxonne, qui accueille les
différences, les minorités. Ce qui se passe avec le monde juif est peut-être la
première expression significative d’une telle configuration. Comment concilier les
valeurs universelles de l’idéal républicain, les identités particulières et les
subjectivités personnelles ? Pour cela, je suis favorable à la reconnaissance de «
droits culturels », mais à condition qu’ils soient mis à la disposition des
individus et non pas confiés à la gestion des groupes. Il ne faut pas avoir peur des
identités particulières, elles ne s’opposent pas à la République et à la Nation.
Propos recueillis par
Thierry Leclère
(1) Publié en France sous le titre : L’Imaginaire national. Réflexion sur
l’origine et l’essor du nationalisme (éd. La Découverte, 1993).
Télérama n° 2933 - 29 mars 2006
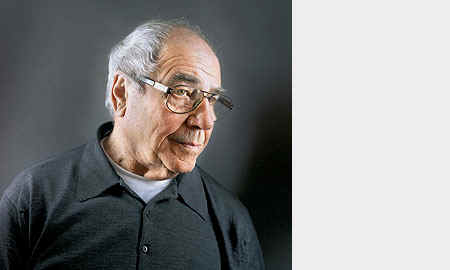
http://www.esprit.presse.fr/

Danemark / Grande première à la télévision
Le foulard islamique s'affiche à l'écran
Les Danois vont de controverses en controverses au sujet de
l'islam : après que leur pays eut été accusé d'offense à Mahomet, ils ont désormais
pour la première fois une présentatrice de télévision qui arbore fièrement le foulard
islamique.
Asmaa Abdol-Hamid : « On peut très bien être forte et indépendante même avec un
morceau d'étoffe sur la tête ». (Photo AFP)
Depuis deux semaines, chaque mercredi soir, la deuxième chaîne du service public danois,
DR2, propose une émission de débat intitulée « Adam et Asmaa » sur les conséquences
de l'affaire des caricatures du prophète Mahomet. Asmaa Abdol-Hamid, 24 ans, danoise
d'origine palestinienne, y interroge sans complaisance ses invités, en compagnie d'un
présentateur, Adam Holm qui, lui, est athée.
« Il ne faut pas me prendre
pour une fanatique »
La présentatrice explique que « notre but est de décortiquer dans une série de huit
programmes les incompréhensions entre l'islam et l'Occident ». Incisive, non dépourvue
d'humour, Asmaa, s'est attirée les foudres de nombre de Danois encore scandalisés par
l'attitude du monde musulman contre le Danemark après la publication des caricatures de
Mahomet dans la presse danoise. Dans le journal populaire Ekstra Bladet, un lecteur
dénonce ainsi « une présentatrice qui est en faveur de la sharia (loi islamique), dont
les règles sont barbares ».
Les yeux pétillants, Asmaa refuse, avec un large sourire, la main tendue d'un journaliste
venu l'interviewer. « Il ne faut pas pour autant me prendre pour une fanatique. Je ne le
suis pas, affirme-t-elle. Je veux montrer une image plus nuancée, et qui n'est pas celle
que l'on véhicule toujours: celle de femmes musulmanes opprimées parce qu'elles portent
le foulard », dit-elle.
« On peut très bien être forte et indépendante même avec un morceau d'étoffe sur la
tête » assure Asmaa, se défendant d'être « une intégriste » comme l'en accusent ses
détracteurs. Car cette incursion d'une femme voilée sur les écrans danois a suscité de
vives critiques de féministes.
« C'est une insulte à la fois aux femmes danoises et musulmanes », a protesté
l'association « Kvinder for frihed » (Femmes pour la liberté) qui a lancé une
pétition pour stopper ce programme. Même son de cloche au mouvement des « Droits des
femmes iraniennes », qui appelle les téléspectateurs mécontents à faire entendre
leurs voix.
La ministre danoise des Affaires sociales et de l'égalité, Eva Kjaer Hansen, s'est
immiscée dans le débat : « Je veux rappeler à DR 2 que ses employés ne doivent pas
faire oeuvre de missionnaires », a-t-elle dit. En revanche pour le mouvement «
Feministisk forum » (Forum féministe), cette embauche « constitue un pas dans la bonne
direction vers une représentation plus égalitaire dans le monde des médias ».
« Un fossé
d'incompréhension »
Selon Tim Jensen expert en religion à Syddansk universitet, ces remous « confirment
qu'il y a toujours un fossé d'incompréhension entre une bonne partie de la population
danoise et les musulmans qui vivent dans le pays ». Mais selon lui, l'apparition d'Asmaa
à l'écran constitue « une percée historique car on accepte pour la première fois que
les musulmanes, même avec un foulard, fassent partie de la société danoise et qu'elles
ne soient pas nécessairement des extrémistes ».
Face à toute cette controverse, la jeune femme note qu'elle « a reçu plus de
félicitations que de critiques ». Et de souligner que certains hommes musulmans «
auraient voulu me voir à la maison plutôt qu'en vedette sur un écran de télévision
».
DNA: 9/04/06
Misère des nations, richesse des migrants par Luc Chatel
Je ne te demande pas de me réserver le même accueil que nous te réservons chez nous en
Afrique. Je n’ai pas non plus la prétention d’exiger d’habiter dans tes
arrondissements prestigieux, pour tout dire, tes foyers Sonacotra me suffiraient, si tu
voulais bien veiller à leur entretien. Tout ce que je te demande, c’est de ne pas
oublier que nous venons d’un même souffle, le souffle de la vie. » Ce souffle de
vie qu’évoque Luc Bassong dans son excellent roman Comment immigrer en France en 20
leçons (1), c’est aussi celui qui permit à Kheira, Arezki, Djemaa et Ghaouti de ne
pas craquer une fois arrivés dans notre beau pays (2).
Le récit de ces chibanis présente un redoutable avantage : il nous permet d’aborder
la question de l’immigration avec le sourire. Pas le sourire béat d’un bonheur
artificiel où les différences seraient effacées, les drames oubliés et les vexations
niées. Non, ces vieux immigrés nous disent que le choix de vivre en France et de
s’impliquer dans l’organisation sociale et politique de ce pays est l’une
des meilleures choses qui leur soit arrivée. À charge pour nous d’ouvrir les yeux :
leur présence est l’une des meilleures choses qui nous soit arrivée. Tout comme la
venue des suivants, qu’ils soient originaires de Chine, du Mali ou d’Uruguay.
Nous ne les attendons pas seulement pour empiler des mœllons, astiquer des parquets
de préfecture ou concevoir des logiciels, mais pour tester notre capacité à rester
humain. Un défi qui ne semble pas intéresser le superflic de la place Beauvau.
Dans le projet de loi sur l’immigration qu’il présentera début mai, Nicolas
Sarkozy s’apprête à nous réciter son credo libéral-sécuritaire : rentabilité,
répression, ségrégation.
Rentabilité d’êtres humains perçus essentiellement comme des forces de travail,
répression de familles installées en France depuis des années, ségrégation
d’hommes et de femmes que l’on méprise parce qu’ils n’ont pas
l’immense mérite d’être nés riches et bien portants sous les Lumières de
l’Occident. Précisons que si Nicolas 1er, tsar de France, porte sur ses petites
épaules le poids d’une telle idéologie, elle est partagée par la plupart de ses
camarades de droite et - satanée surprise ! - par de plus en plus d’hommes et de
femmes de gauche. Dont acte. Puisque nous devons cesser de « subir » la présence de ces
corps étrangers pour enfin pouvoir les « choisir », pourquoi ne pas créer une «
immigr’academy » : Mira nous vient de New-Delhi, elle est informaticienne, si vous
voulez qu’elle reste dans la Maison France, tapez 1 ; pour Abdoulaye, pêcheur
sénégalais, tapez 2 ; pour Azouz, qui veut devenir ministre, tapez 3…
Outre son inspiration de type néandertalien, une telle approche de l’immigration
– chiffrée, rationnelle, utilitariste – porte en elle une profonde tristesse.
Un peu comme si la vie n’était plus une bonne nouvelle, comme si les hommes étaient
condamnés à se compter et se rejeter, comme si l’accueil, l’amitié, la
liberté passaient au rang de valeurs accessoires. Nos chères élites comprendront-elles
un jour qu’entre des pays pauvres où l’on crève de faim et des pays riches où
l’on crève d’ennui, la misère n’est pas forcément là où l’on
pense. Laissons le dernier mot à Luc Bassong : « Immigrer, pour nous, les désespérés
de la Terre, ce n’est pas la même chose qu’aller en vacances avec un bob sur la
tête et un appareil photo numérique autour du cou. C’est une question de survie. En
immigrant, j’accomplirai donc une des fonctions vitales qui font de moi un homme. Si
cela dérange quelqu’un, je m’excuse d’exister et d’avoir envie de
continuer à vivre.»
(1) un petit précis indispensable de lucidité, de générosité et de férocité qui
n’épargne personne, publié en mars 2006 aux éditions Max Milo, 186 pages, 16
€
. (2) lire notre dossier lié à la publication de «Nos ancêtres les chibanis»,
éditions Autrement, 200 pages, 19 €.
Copyright © Témoignage chrétien 2006

L'Express du 04/05/2006
Niger
Le combat pour la liberté
de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Stehli
Des milliers d'adultes et d'enfants continuent
d'être la propriété d'une personne ou d'une famille. Ceux qui, avec des ONG, luttent
contre cette exploitation, devenue illégale, doivent affronter le poids des coutumes et
des tabous. Quand ce n'est pas la menace des autorités...
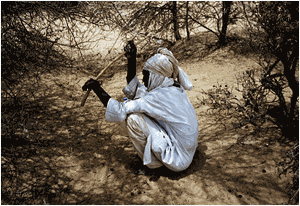 
Toute fière, Assibit Wanagada reçoit ses visiteurs
dans sa nouvelle maison: quelques arceaux de bois blanchis par le soleil brûlant,
récupérés aux alentours, recouverts de paille et de bouts d'étoffe disparates: un sac
d'aide alimentaire, un morceau de jean troué, un carré de tissu multicolore. Pour seul
mobilier, au centre de la structure de quelques mètres carrés, on a construit une
plate-forme de bois, surélevée, sur laquelle on jette une natte lorsqu'on veut se
reposer. Allongée dans un coin d'ombre - il fait 45 degrés - une biquette, unique
possession de la maîtresse de maison, prend le frais.
Ce petit édifice est peu de chose, une cabane que des enfants auraient pu bâtir,
mais, pour Assibit, c'est un palais. Il lui appartient et c'est la première fois de sa
longue vie que cette femme au beau visage à la peau très noire possède quelque chose.
Il y un an, en effet, elle est devenue libre. Depuis sa naissance - il y a environ
soixante ans, selon ses propres calculs - cette représentante de l'ethnie hrheran, au
Niger, était esclave: elle appartenait à un maître sur le territoire de Tamahel, à 900
kilomètres au nord de Niamey, la capitale du pays. Elle était née esclave de parents
eux-mêmes esclaves. "J'ai travaillé depuis que je suis toute petite,
raconte-t-elle. Je m'occupais de la maison, je conduisais le bétail au puits, je
transportais les provisions. De toute ma vie, je n'ai jamais eu plus de trois heures de
sommeil par nuit."
"Dans les zones nomades, un Touareg blanc est un maître, un Touareg noir est un
esclave"
Jamais elle n'avait songé à quitter son maître, qui possédait une dizaine
d'esclaves. "Je ne savais pas que c'était possible", explique-t-elle. Mais un
jour, en l'accompagnant au village de Tamaya, elle a entendu parler de Timidria, une
association laïque, inspirée des principes de Martin Luther King, qui aide les esclaves
à se libérer. Une nuit, elle a pris la fuite avec deux de ses enfants. Elle a marché
deux jours dans la brousse avant d'être recueillie. "Parfois, je courais. J'avais si
peur que les maîtres me rattrapent." Son mari et deux de ses enfants, eux, ne sont
toujours pas libres. Lorsque le représentant de l'association Timidria est allé
rencontrer le Touareg qui les détient afin de négocier leur libération, il a été
menacé avec un couteau et un fusil. Aujourd'hui, Assibit vend, sur le marché de Tamaya,
de l'eau de pluie et de la bouillie préparée avec du millet, la base de la nourriture
des habitants de cette région très pauvre. "Parfois je mange, parfois non. Je suis
pauvre, mais je préférerais être morte plutôt que de retourner chez mon maître."
Assibit était l'une de ces esclaves qui, par centaines de milliers, existent encore en
Afrique de l'Ouest. Au Niger notamment, durant des siècles, les nomades touareg - mais
ils n'étaient pas les seuls - ont pillé les villages des populations noires
sédentaires, réduisant en esclavage leurs captifs. Les responsables britanniques
d'Anti-Slavery International, la plus ancienne ONG, fondée (en 1832) pour lutter contre
la traite transatlantique, estiment qu'ils sont encore 43 000 au Niger. En 2002, Timidria,
seule association nigérienne de lutte contre l'esclavage, a réalisé une vaste étude,
la première du genre: dans huit régions du pays, l'ONG a envoyé ses enquêteurs en
brousse, sur les marchés, autour des points d'eau, dans les campements - de jour comme de
nuit, pour ne pas éveiller de soupçons - questionner les membres d'une famille ou ses
serviteurs sur le nombre d'esclaves dans leur entourage immédiat. Résultat: au Niger
(qui compte à peine plus de 10 millions d'habitants) 800 000 personnes seraient encore
propriété pleine et entière d'une personne ou d'une famille. "Dans les zones
nomades, raconte Ilguilas Weila, fondateur en 1991 de Timidria (mot haoussa:
"frère"), ce n'est même pas la peine de poser la question: un Touareg blanc
est un maître, un Touareg noir est un esclave. Tout le travail lui est confié: il va
chercher l'eau le matin, prépare la nourriture pour la famille, garde et abreuve les
animaux, tire l'eau dans des puits qui ont entre 80 et 150 mètres de profondeur, déplace
les tentes en fonction du soleil. Cela n'arrête jamais."
Pourtant, depuis 2004, grâce à la campagne de Timidria, le Parlement nigérien a fini
par mettre cette pratique hors la loi. Le régime du président Mamadou Tandja avait
rétabli la démocratie en 1999, après vingt-cinq ans de dictature militaire presque
ininterrompue. Il devenait difficile de ne pas condamner l'esclavage, au moins dans son
principe. Désormais, donc, tout propriétaire d'esclave encourt une peine de prison de
dix à trente ans et une amende de 1 à 5 millions de francs CFA (de 1 520 à 7 600
€). Jusqu'à cette date, ceux qui luttaient contre l'esclavage étaient pourchassés.
Premier militant de la lutte contre l'esclavage, Ahmed Rissa a été emprisonné 11 fois
par le gouvernement et a dû vivre en exil plus de dix ans. Les gens de son village,
Abalak, n'osaient plus lui parler. "Jusqu'alors, puisque le mot d'esclavage
n'existait pas dans la Constitution, il n'était pas possible de le combattre, explique
Ilguilas Weila. Aujourd'hui, il y a une loi, mais cela s'arrête là." Le
gouvernement ne veut surtout pas entendre parler d'esclavage.
"Au Niger, l'esclave est la propriété absolue d'un maître jusqu'à sa mort et
il le sert jour et nuit"
En mars 2005, un puissant chef touareg, Arrisal Ag Amdagh, a organisé une grande
cérémonie publique pour rendre la liberté aux 7 000 esclaves vivant sur son campement
d'Inatès, près de la frontière du Mali. Au dernier moment, le gouvernement a fait
annuler la cérémonie et Ilguilas Weila ainsi qu'Alassane Biga, un autre militant de
Timidria, ont été emprisonnés deux mois. Les charges n'ont toujours pas été levées,
ce qui permet d'exercer un chantage sur ces deux hommes. Chefs d'accusation: tentative
d'escroquerie et faux. "Le gouvernement prétend que la lettre du chef touareg est un
faux que nous avons fabriqué," ironise Weila. Cette réaction n'est pas tout à fait
surprenante. Le gouvernement est en effet constitué de chefs qui ont eux-mêmes des
esclaves. Par exemple, le président Seyni Kountché, à la tête de l'ancienne dictature
militaire, venait d'une famille de chefs. Le gouvernement n'encourage pas l'application de
la loi, car il estime que parler de cette pratique - fût-elle ancestrale - nuit à
l'image du pays. Bien qu'il ait fait voter l'abolition en mars 2003, Lompo Garba,
président de la Commission nationale des droits de l'homme, a menacé: "Toute
tentative de libération officielle d'esclaves sera jugée illégale et inacceptable dans
nos pays. Ceux qui le feront auront à subir la rigueur de la loi." Bref, on a le
droit, et même le devoir, d'affranchir ses esclaves, mais discrètement: il ne faut pas
que cela se sache. En deux ans, selon les chiffres de l'ONG, 231 esclaves seulement ont
été libérés.
Rares sont les Touareg de sang noble qui osent briser le tabou. Ahmadou Khamed Abdulai,
est l'un des chefs touareg d'Akoubounou, qui compte à peu près 21 000 personnes.
"Ici, l'esclavage n'existe pas. Moi, je n'en ai jamais vu, affirme-t-il. Tout le
Niger sait que l'esclavage est interdit. Mais, si une personne qui ne possède rien se met
sous la protection de quelqu'un et travaille sans rémunération en échange de
nourriture, ce n'est pas de l'esclavage. C'est simplement de la pauvreté. J'ai quelqu'un
avec moi qui ne veut pas de rémunération parce que je le nourris. C'est cela,
l'esclavage qui reste dans notre pays." Le Niger est l'un des pays les plus pauvres
du monde, avec un revenu par habitant de moins de 2 dollars.
Mustapha Kadi, lui, a franchi le pas. En 2003, ce chef touareg du village d'Illéla a
convaincu sa mère de libérer leurs 11 esclaves. "Ma sœur était violemment
contre, se souvient-il. On ne peut pas libérer nos biens!" protestait-elle. Mustapha
Kadi, qui préside également l'association des chefs traditionnels de la région de
Tahoua, tenait à montrer l'exemple. "A l'occasion de cette libération,
raconte-t-il, j'ai proposé d'inviter tous les chefs et d'organiser une cérémonie
officielle. Juste avant qu'elle démarre, le gouverneur de la région a demandé à la
police de nous chasser et de saisir les pellicules photo des journalistes. Ceux qui
résistaient étaient menacés de prison. L'affaire est allée jusqu'à Niamey. J'ai été
convoqué par le ministre de l'Intérieur avec mon père. Il m'a dit: au Niger,
l'esclavage n'existe pas. On ne veut pas en entendre parler."
"Le Coran interdit de prendre plus de quatre femmes, mais, si vous en voulez une
autre, vous l'achetez"
Le terme d'esclavage désigne parfois des formes particulièrement inhumaines de
travail, comme celui des enfants. Au Niger, le mot a gardé son sens premier: l'esclave
est la propriété absolue d'un maître jusqu'à sa mort et il le sert jour et nuit. C'est
le maître qui lui choisit un conjoint et, lorsque des enfants naissent, ils sont la
propriété de la femme de ce maître. Elle en fait généralement cadeau à ses propres
enfants ou bien les inclut dans la dot de la jeune mariée. Dans un pays où,
traditionnellement, les biens sont rattachés à l'homme, cette dépendance à la femme
marque de manière forte le statut inférieur de l'esclave. Il n'a pas de père: c'est
donc, humiliation supplémentaire, un bâtard. Lorsqu'un esclave s'enfuit, il arrive que
le maître le tue ou, comme cela s'est parfois produit dans la région de Tchin Tabaraden,
qu'il le castre. Au Niger, le commerce d'esclaves a disparu depuis la colonisation
française. Mais les choses se perpétuent par héritage: on est descendant d'un
arrière-grand-parent enlevé à la suite d'une guerre tribale. "Il existe aussi
l'esclavage passif, explique Weila. C'est le cas des personnes qui ont appartenu à un
maître et qui, une fois affranchies, continuent de se faire appeler esclaves de celui-ci.
Ils vivent sur sa terre et la cultivent. Au moment de la récolte, le maître prend ce
qu'il désire, sans aucune forme de compensation. Ils sont victimes des mêmes
discriminations que les autres. Ils vivent souvent dans des quartiers d'esclaves qu'on
appelle dabey. Kounti-Koira, un village à 40 kilomètres de Niamey, ne compte que des
esclaves parmi sa population. Dans l'ouest du pays, chaque village est divisé en deux
bourgs: une partie exclusivement réservée aux esclaves et l'autre aux maîtres."
A Tamaya, un Touareg libre vient chercher Ahmed Rissa, le grand militant
anti-esclavagisme. Il s'appelle Abdelaï Alhassen et veut montrer ce qui vient de lui
arriver. Il cultive des patates douces, des oignons, des salades, des aubergines, du tabac
à chiquer, quelques melons. "Il y a une dizaine de jours, explique-t-il, le chef
touareg est venu brûler quatre jardins. "Ce sont des esclaves, ils n'ont pas le
droit", aurait lancé ce dernier pour justifier son geste. La terre sous les pieds
d'Abdelaï est noire, calcinée. Le statut d'esclave est en effet irréversible, même
lorsqu'on est libre depuis cent ans.
Dès qu'une famille apprend qu'un homme vient d'une famille d'anciens esclaves, elle
annule le mariage. "A Niamey, cela arrive tous les jours", affirme Rissa. A
Biga, en rentrant chez lui, un soir, un homme a trouvé son tout jeune enfant seul et sa
maison vide. Sa femme avait fui en Libye proche, convaincue par ses frères que son mari
était une sorte d'intouchable à cause de son histoire familiale. Dans ce pays à 98%
musulman, "il existe encore une autre forme d'esclavage, poursuit le président de
Timidria. C'est le système dit de la cinquième épouse. Le Coran interdit de prendre
plus de quatre femmes, mais, si vous en voulez une autre, vous l'achetez. Elle n'aura
aucun droit et peut être violée quand le chef de famille le veut."
"J'espère qu'un jour, je serai libre, mais, si Dieu ne l'a pas voulu, je resterai
ce que je suis"
Pour arriver au puits de Koutou, en pleine brousse, à 90 kilomètres d'Abalak, il faut
faire deux heures de route avec un guide. Dans ce paysage de terre jaune et de petits
arbustes aux redoutables épines, il n'y a même plus de piste. Aucun représentant de
l'Etat du Niger n'a jamais mis les pieds dans ce coin abandonné d'un pays grand comme
près de trois fois la France, mais désertique aux deux tiers. La plupart des habitants
ignorent même que la France a un jour colonisé le pays, pas plus qu'ils ne savent qui
est à la tête de l'Etat - ou même s'il y a un Etat. A partir de 5 heures, chaque matin,
c'est l' "heure de pointe". Avant la grosse chaleur - le thermomètre peut
monter jusqu'à 50 degrés - hommes et animaux s'activent autour de ce point d'eau de 80
mètres de profondeur. Le puits appartient à Abdulaï Achen, un Touareg "rouge"
(c'est-à-dire de couleur claire, par opposition aux Touaregs noirs), qui
"possède" 100 esclaves. Yahaya Mohamet, membre de l'ethnie igdalen, est né
ici. Cela fait cinquante ans qu'il travaille pour Abdulaï Achen. Il s'occupe de ses
chèvres. Demain, il revient avec les ânes pour porter de l'eau, commence-t-il à
raconter, accroupi sous un maigre buisson qui projette quelques centimètres carrés
d'ombre, avant d'être vite rejoint par l'un de ses maîtres. Sur ses dix enfants, cinq
ont pris la fuite.
Quelques kilomètres plus loin, Bilal Benou s'active autour du puits de Sabara,
propriété d'Aboubakar Achen. "Toutes les femmes qui sont là, confie-t-il,
appartiennent aussi à Aboubakar." Le matin, il vient au puits, puis retourne chez
son maître et attend ses instructions: chercher les animaux en brousse, aller cultiver le
millet ou les haricots, mais il n'a plus de force pour ces durs travaux, explique-t-il en
montrant ses bras maigres. Il doit parfois mendier sa nourriture auprès de gens qu'il
connaît dans la brousse. Souvent son maître le maltraite. Pourtant, il n'a jamais songé
à s'enfuir. "Comment peut-on se poser la question? demande-t-il. J'espère qu'un
jour, je serai libre, mais, si Dieu ne l'a pas voulu, je resterai ce que je suis."
Bilal Benou ignore que la loi interdit l'esclavage dans son pays. Dans cette région, on
se soucie peu de ce genre de lois. La vie continue comme depuis des générations.
"Lorsque je suis allé voir mon père pour qu'il s'enfuie, raconte Ahmed Rissa, il
m'a dit: "C'est Dieu qui a voulu cela. Tu n'es pas un bon musulman!""
Idrissir Anasbagahar, le jeune secrétaire de la section de Timidria d'Abouhaya, à une
centaine de kilomètres dans la brousse, a mené son enquête pour essayer de dénombrer
les esclaves. "Près d'ici, il y a deux puits et 6 000 esclaves. En continuant
au-delà du troisième puits, il y en a 20 000."
Il est à peine 8 heures, mais la foule se presse déjà dans les couloirs du tribunal
d'instance d'Abalak. Ibrahim Djirmey, en poste depuis à peine quelques mois, fait office
de juge d'instruction, de procureur, de juge d'application des peines, de juge des
mineurs. Beaucoup pour un seul homme. "Lorsque j'ai pris mes fonctions, explique le
jeune magistrat, ma première surprise a été de constater à quel point la pratique de
l'esclavage était tenace. Certains viennent à moi en me disant que c'est l'ordre de
marche normal de la société et qu'il y a les maîtres et les esclaves." Deux mois
après son arrivée, il a été saisi du cas d'une jeune fille d'environ 18 ans, Halota
Ibrahim, qui avait marché trois jours pour échapper aux mauvais traitements de son
maître. La toute jeune femme - elle ignore son âge - qui a fui avec son petit garçon de
5 ans, Seidoumo, raconte d'une voix à peine audible que son propriétaire la battait sans
cesse. "Nous avons une justice du tiers-monde, déplore le juge, fataliste. Rien que
pour enquêter sur place, il faut soulever des montagnes afin de se procurer du carburant.
Il y a un seul véhicule de gendarmerie pour 800 000 habitants, pas de téléphone. Avant
que nous n'arrivions sur les lieux, à cause de la perméabilité des frontières, les
gens sont partis. Une justice sans moyens ne peut fonctionner que partiellement."
Pour faire face à l'inertie du gouvernement, Timidria, qui a réussi à implanter 690
bureaux à travers le pays - en général la modeste maison de son représentant - éduque
les Nigériens en organisant des grandes assemblées de la population jusque dans les
coins les plus reculés du pays. L'ONG accueille les esclaves en fuite, démunis, n'ayant
parfois même pas de vêtements, les prend en charge, les aide à devenir autonomes. Rien
qu'avec trois chèvres - deux femelles et un mâle - les gens obtiennent un troupeau de
dix têtes en deux ans. Les nomades peuvent ainsi tenter de s'installer et de subsister.
Le coût est modeste: une chèvre vaut entre 15 000 et 25 000 francs CFA (de 23 à 38
€). Timidria, aidé par l'ONG britannique Oxfam, a également créé 15 écoles pour
les enfants de nomades libérés; dix autres seront ouvertes cette année. "La
libération est liée à l'instruction, explique Weila. Pour réussir à convaincre les
esclaves de partir, il faut à tout prix réussir la réinsertion, sinon nous aurons
mauvaise réputation et nous ne pourrons plus agir." Le chemin de la libération ne
fait que commencer.
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/niger/dossier.asp?ida=438200
|


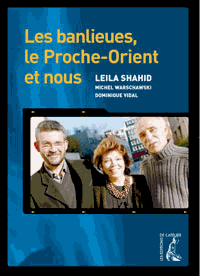 Ce dernier dialogue a lieu fin novembre 2005. Le 27 octobre, deux
adolescents, Zyed Benna et Buna Traoré, mouraient électrocutés dans un transformateur
électrique à Clichy-sous-Bois. Un troisième, Muhattin Altun, grièvement blessé,
indiquait que tous trois tentaient d’échapper à un énième contrôle de police. Ce
drame, suivi, le 30 octobre, du tir d’une grenade lacrymogène à quelques
centimètres de l’entrée de la mosquée Bilal de la ville, a déclenché dans plus
de 400 banlieues – sur fond de déclarations du ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy vécues comme de véritables provocations – un mouvement de révolte sans
précédent. Moins dans les formes qu’elle a empruntées – y compris une
violence de jeunes adolescents, qu’ils ont retournée notamment contre les
équipements collectifs de leurs propres quartiers – que dans son ampleur et sa
durée, tandis qu’une loi de 1955, datant de la guerre d’Algérie et instaurant
l’état d’urgence, était réactivée par l’Assemblée nationale. Les
alertes des acteurs de terrain comme des chercheurs, pourtant, ne manquaient pas quant aux
discriminations sociales, économiques, culturelles, mémorielles, qui traversent la
société française et que subissent ces banlieues, et sur lesquelles vous avez eu
l’occasion de revenir à plusieurs reprises. Palestinienne, Israélien, Français :
à l’appui des deux ans et demi de votre aventure, quel regard portez-vous finalement
sur cette actualité et sur ce qu’elle dit ?
Ce dernier dialogue a lieu fin novembre 2005. Le 27 octobre, deux
adolescents, Zyed Benna et Buna Traoré, mouraient électrocutés dans un transformateur
électrique à Clichy-sous-Bois. Un troisième, Muhattin Altun, grièvement blessé,
indiquait que tous trois tentaient d’échapper à un énième contrôle de police. Ce
drame, suivi, le 30 octobre, du tir d’une grenade lacrymogène à quelques
centimètres de l’entrée de la mosquée Bilal de la ville, a déclenché dans plus
de 400 banlieues – sur fond de déclarations du ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy vécues comme de véritables provocations – un mouvement de révolte sans
précédent. Moins dans les formes qu’elle a empruntées – y compris une
violence de jeunes adolescents, qu’ils ont retournée notamment contre les
équipements collectifs de leurs propres quartiers – que dans son ampleur et sa
durée, tandis qu’une loi de 1955, datant de la guerre d’Algérie et instaurant
l’état d’urgence, était réactivée par l’Assemblée nationale. Les
alertes des acteurs de terrain comme des chercheurs, pourtant, ne manquaient pas quant aux
discriminations sociales, économiques, culturelles, mémorielles, qui traversent la
société française et que subissent ces banlieues, et sur lesquelles vous avez eu
l’occasion de revenir à plusieurs reprises. Palestinienne, Israélien, Français :
à l’appui des deux ans et demi de votre aventure, quel regard portez-vous finalement
sur cette actualité et sur ce qu’elle dit ?