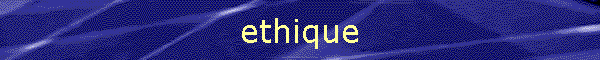|
Position de l'église
| |
 | Génome , Biologie et Racisme : Axel Khan in Le Monde du 5/09/2001 |
 | Ce serait un contre sens de vouloir fonder l'engagement antiraciste sur
la science.Il n'existe pas de définition scientifique de la dignité humaine,il sagit là
d'un concept philosophique. |
 | La question de l'embryon ne relève pas de la science mais de
l'humanité: Didier Sicard in Le Monde du 24/02/03 |
 | Une société de réparation : Didier Sicard |
 | Le débat bioéthique tel que nous le voyons : Le Groupe Paroles in le
Monde du 7 Juillet 2001. |
 | Vers la réification de l'être humain : Israél Nisand in le Monde du
12/07/2001 |
 | Clonage thérapeutique :Gardons nous des fantasmes: Henri Atlan in Le
Monde du 16/01/2002 |
 | Déclaration des évéques de France : |
Ethique à l’ENS
Organisé par : Monique Canto-Sperber (CNRS) |
Cycle de rencontre-débats organisé par Monique Canto-Sperber.
Ressources en ligne
 | Économie,
finances, confiance : les enjeux éthiques du 13 janvier 2003 par Monique
Canto-Sperber, Daniel Cohen, André Orléan et Olivier Favereau
Table-ronde présentée par Monique Canto-Sperber.
|
 | Les
problèmes de la naissance : questions de limites, question de droits du 27 janvier 2003 par
Monique Canto-Sperber, Anne Fagot-Largeault, René Frydman et Didier
Sicard
Table-ronde autour de Monique Canto-Sperber.
|
 | Droits
et normes internationales du 3 février 2003 par Monique Canto-Sperber, Laurence
Tubiana, Catherine Audard et Angel Asensio
Table-ronde organisée par Monique Canto-Sperber autour de Droits et normes
internationales : hiérarchie des normes ou droit mondial ? Des règles éthiques
mondiales sont-elles concevables ?.
|
 | OGM
et biotechnologies du 24 février 2003 par Monique Canto-Sperber, Françoise
Moisand, Guy Paillotin et Agnès Ricroch
Table-ronde organisée par Monique Canto-Sperber autour de OGM et biotechnologies : les
progrès de la science du vivant jugés à l’aune de l’éthique.
|
 | Le
vivant comme marchandise ? du 10 mars 2003 par Monique Canto-Sperber, Hélène
Gaumont-Prat, Nicole Questiaux et Gérard Teboul
Table-ronde organisée par Monique Canto-Sperber autour de Le vivant comme marchandise
? Problèmes éthiques posés par la commercialisation du vivant et la création de
biobanques.
|
 | Les
questions éthiques de l’avenir : fantasmes ou menaces? du 24 mars 2003 par Monique
Canto-Sperber, Henri Atlan, Jean-Pierre Dupuy et Irène Théry
Table-ronde organisée par Monique Canto-Sperber avec :
- Irène Théry : Les dilemmes réels qui vont se poser en matière de choix
individuels d’appartenance collective aussi bien sous l’angle de la filiation
que dans la perspective de la différenciation sexuelle et des capacités d’agir
revendiquées par les individus.
- Henri Atlan : Clonage et utérus artificiel : innovations technologiques à venir en
matière de procréation et dont l’effet sera de dissocier sexualité et procréation
; et quel sera le rôle des femmes si elles ne sont plus représentées comme celles qui
portent les enfants ?
- Jean-Pierre Dupuy : Les nanotechnologies et la recomposition de notre environnement
que cela va occasionner.
|
 | Comment
poser les questions éthiques ? Principes, concepts et normes du 19 janvier 2004 par Monique
Canto-Sperber, Catherine Larrère, Ruwen Ogien et Otto Pfersmann
Catherine Larrère : Comment traiter des questions d’éthique appliquée ? Le cas
de l’environnement
Ruwen Ogien : Les principes et les conséquences
Otto Pfersmann : Normes morales et normes juridiques
|
 | Problèmes
éthiques dans les sciences de la vie et de la santé du 8 mars 2004 par Monique
Canto-Sperber, Maxime Seligmann, Véronique Fournier et Jean-Pierre
Changeux
Maxime Seligmann : Accès aux soins, et essais de médicaments
Jean-Pierre Changeux : Cellules souches embryonnaires et toxicomanie
Véronique Fournier
|
 | Problèmes
d’éthique en relations internationales : le droit, la force, les choix moraux du 26
janvier 2004 par Monique Canto-Sperber, Frédéric Encel, Pierre
Hassner et Tzetan Todorov
Frédéric Encel : Les nouvelles menaces
Pierre Hassner : Entre l’empire et la terreur
Tzvetan Todorov : Le juste et le droit
|
 | Problèmes
d’éthique dans les nouvelles sciences et technologies : à la convergence de la
biologie et de la physique du 2 février 2004 par Monique Canto-Sperber, Claude
Debru, Jean-Pierre Dupuy et Jean-Claude Ameisen
Jean-Claude Ameisen : Les questions éthiques à la frontière de la biologie
Jean-Pierre Dupuy : Ethique et technologies convergentes
Claude Debru : Biotechnologies et éthique
|
 | Les
sciences dans la société : nouveaux dangers, nouvelles responsabilités du 22 mars 2004 par
Monique Canto-Sperber, Jean Petitot, Gérard Toulouse et Etienne-Emile
Baulieu
Monique Canto-Sperber reçoit Etienne-Emile Baulieu, Jean Petitot et Gérard Toulouse
autour de Les sciences dans la société : nouveaux dangers, nouvelles responsabilités.
|
Présentation
L’éthique n’est pas seulement un mot à la mode ou un produit
passe-partout. Ce n’est pas un simple supplément d’âme pour les marchands ou
un cache-misère pour des journalistes en mal de copie. Ce n’est pas de la
philosophie morale au rabais. C’est la forme actuelle, et sans doute historiquement
nécessaire, que prennent certaines des réflexions et controverses qui interrogent,
déchirent mais aussi vivifient nos sociétés, nos établissements universitaires, nos
institutions démocratiques, notre développement technique, nos recherches scientifiques.
L’École doit participer, à sa manière, à ces discussions par ces études de cas.
Elle a donc chargé Monique Canto-Sperber, directrice de recherches au CNRS, membre du
Conseil consultatif national d’éthique, qui a joué depuis longtemps un rôle
déterminant dans la position de ces controverses en France, d’organiser une série
de rencontres-débats, autour
de quelques experts, sur des sujets qui ne peuvent pas être tranchés
seulement par des experts.
(Gabriel Ruget, Pascale Briand, Francis Wolff)
La série de débats Éthique à l’ENS est l’expression de la volonté de
créer à l’École normale supérieure un lieu de réflexion éthique. Ces débats
sont destinés à familiariser les élèves, chercheurs et enseignants avec
l’interrogation éthique. Sur des questions aussi diverses que celles suscitées par
l’économie contemporaine, la bioéthique, le droit international et la gouvernance
mondiale, les biotechnologies, la commercalisation du vivant, les nanotechnologies et la
filiation, ils veulent présenter l’exemplarité d’une démarche soucieuse de
définir des principes éthiques fondamentaux ainsi que les règles et les limites de
l’action humaine. Ces débats souhaitent offrir l’occasion d’un dialogue
entre les disciplines enseignées à l’ENS et les activités de recherche qui y sont
menées. Ils doivent ouvrir sur une véritable formation intellectuelle.
(Monique Canto-Sperber)
 |
Monique Canto-Sperber (CNRS) Monique Canto-Sperber est philosophe et directrice de
recherche au CNRS, membre du Comité consultatif national d’éthique. Elle chargée
de mission du directeur de l’ENS pour l’éthique à l’ENS. |
Le débat bioéthique tel que nous le voyons : Le Groupe
Parole
LE débat bioéthique n'est pas une affaire de spécialistes ! Le problème ne réside pas
dans la scientificité des questions, comme on voudrait trop souvent le faire croire, mais
dans leurs implications philosophiques, ou, plus simplement, humaines. Toutes les
questions tournent en effet autour de la vie même: de la naissance et de la mort.
Aux deux bouts de la vie, les choix sont dictés par des volontés qui ressortissent à
trois ordres: scientifique, médical, économique.
Ces trois instances ne peuvent évidemment, à elles seules, dicter les décisions qui les
dépassent: là où le biologiste veut aller de l'avant en imitant son confrère
astronome, la conscience se révolte. Le médecin, face à une demande d'avortement ou
d'euthanasie, n'est pas suffisamment "outillé" pour répondre avec pertinence:
ce qu'il peut techniquement faire, a-t-il le droit de l'accorder ou de le refuser ? Sur ce
point, le serment d'Hippocrate est plus sévère que toutes nos législations actuelles.
Mais la juridicisation de la société met les médecins mal à l'aise et peut les pousser
à se protéger de façon excessive.
Quant à la sphère économique, elle ne peut être d'aucune aide, bien au contraire, car
la recherche du profit maximal combinée avec la loi du marché et régulée par elle ne
peut être ici d'aucun secours.
C'est donc l'éthique, baptisée dans ce cas bioéthique, qui doit orienter les choix et
fixer des normes à ce qui est acceptable. Quand l'éthique propose des points de repère,
elle apparaît froide et inhumaine, peu soucieuse des situations particulières. Mais le
souci de compassion, absolument nécessaire dans l'application des règles, ne doit pas
dispenser de leur énonciation. D'ailleurs, les experts du Comité consultatif national
d'éthique ne peuvent se substituer au politique. C'est à lui qu'il appartient de fixer,
par la loi, les normes qu'une culture se donne en ces matières. Sans oublier qu'en
dernier ressort la conscience reste souveraine, car, sur ces débats incertains où la
ligne de démarcation est floue, la loi admet l'objection de conscience, comme elle le
fait pour les soldats, les journalistes, etc. Le Comité consultatif national d'éthique
s'est donné, presque dès sa création (1983), en France, deux critères essentiels pour
arriver à un consensus. Le premier, sur lequel personne n'est jamais revenu, repose sur
la non-commercialisation du corps humain ou de ses produits (organes, sang, etc.). Le
second fait référence à la philosophie kantienne: agis de telle sorte de prendre
toujours l'être humain comme une fin, jamais comme un moyen.
Si le premier principe est assez bien respecté en France, le second a toujours fait
l'objet d'un débat passionné, non dénué d'arrière-pensées défensives ou
utilitaristes: à partir de quel moment un embryon devient-il une personne ? Sous-entendu:
jusqu'à quel moment pouvons-nous "l'éliminer" ou "l'utiliser", et à
partir de quel moment mérite-t-il le respect dû à une personne humaine "à part
entière" ? La question est, en son principe, piégée.
Quoi qu'il en soit, personne jusqu'ici n'est parvenu à trancher le débat de façon
convaincante et consensuelle.
Le Comité d'éthique a défini l'embryon comme "personne humaine potentielle"
dès sa conception. On devine l'embarras derrière la formule: personne humaine, certes -
la dignité due à tout être humain de sa conception à sa mort est ici fortement
reconnue -, mais potentielle néanmoins, ce qui laisse la porte ouverte à cette idée
selon laquelle la potentialité pourrait admettre des "seuils", qui rendraient
les interventions de plus en plus acceptables moralement au fur et à mesure qu'elles se
rapprocheraient du moment de la conception.
Sur ce point, il faut choisir son camp: celui de la potentialité ou celui de la personne.
Le magistère de l'Eglise, les catholiques et bon nombre de croyants ont choisi cette
seconde perspective. Et si certains parmi eux admettent l'avortement, thérapeutique ou
non, c'est toujours comme un moindre mal au sein d'un conflit de devoirs. Jamais comme un
droit.
Quant au clonage, thérapeutique ou non, il contredit les deux critères de la
bioéthique. Tout d'abord, il contrevient à l'idée qui consiste à prendre tout être
non comme un moyen, mais comme une fin. Ensuite, il implique l'idée qu'un embryon, dans
la mesure où il est obtenu artificiellement, n'a pas un statut de personne, potentielle
ou non.
Mais surtout - c'est peut-être ce qui crée aujourd'hui les réactions les plus vives -
il confère à l'homme un pouvoir exorbitant: celui de pouvoir se reproduire "à
l'identique", ce qui est contraire au principe fondamental de l'humain qui veut que
chaque être soit singulier et, en cela justement, digne de respect. Dans la même ligne
de raisonnement, le clonage est une reproduction non sexuée; en ce sens, il efface une
dimension fondamentale dans le processus de la reproduction: l'altérité sexuelle, source
et symbole de toute altérité et de toute différence.
Toutes les questions relatives au diagnostic préimplantatoire ou à la thérapie génique
doivent être replacées dans ce contexte.
D'autres voies restent cependant ouvertes: tout d'abord la recherche sur les cellules
souches adultes "pluripotentes", très prometteuse, et qui ne pose aucun des
problèmes relatifs au clonage, mais aussi celle qui concerne les embryons
"surnuméraires" qui, sans projet parental, semblent promis à la mort ou, ce
qui y ressemble fort, à une congélation indéfinie. Il faudrait cependant, en ce cas, un
encadrement légal très strict qui prendrait notamment acte du fait que c'est seulement
une carence dans la technique des procréations médicalement assistées qui produit
momentanément cette situation anormale.
Reste l'autre bout de la vie: la mort. Ici, nous avons trois termes que l'on accole
souvent mais qui doivent être radicalement dissociés: euthanasie, acharnement
thérapeutique, soins palliatifs.
La question du refus de l'acharnement thérapeutique et celle du choix des soins
palliatifs est globalement la même: comment éviter la souffrance en fin de vie ? Comment
accompagner, de façon la moins douloureuse, la plus humaine possible, une vie qui
s'achève ? Le consensus est axé sur cette position humaniste et humanisante qui
réfléchit au cas par cas et associe tout l'entourage familial ou soignant du malade.
Par contre, les oppositions se radicalisent à propos de l'euthanasie, qui implique un
changement fondamental de la norme sociale, sanctionné par la loi comme un véritable
choix de société. Ceux qui revendiquent en effet le "droit de mourir dans la
dignité" ne souhaitent pas seulement pour eux, au cas par cas, l'accompagnement le
plus approprié et le plus humain possible. Ils souhaitent - ils le disent et le
proclament eux-mêmes - un droit. Ce droit de vie et de mort sur soi, droit au suicide
assisté, ne peut être inscrit dans aucune loi.
Les chrétiens, dans ce débat, ont longtemps été vus comme se situant du côté du
courant vitaliste (qui défendrait "la vie" à tout prix et qu'il est assez
facile de disqualifier). En réalité, il n'en est rien. Le courant chrétien, s'il adopte
parfois (malheureusement) des arguments "vitalistes", est d'inspiration
essentiellement personnaliste. C'est à ce niveau que les chrétiens doivent sans cesse
resituer les questions: telle technique, tel progrès scientifique nous promeut-il en tant
que personne et nous rend-il, chacun et tous ensemble, plus hommes ?
Ce qui se joue au début et à la fin de la vie humaine concerne en réalité la dignité
de chaque être humain. Parce que toute personne doit être infiniment respectée, nous ne
pouvons admettre que quiconque s'arroge le droit de fixer arbitrairement les bornes en
deçà desquelles la vie humaine n'aurait plus à être respectée. Et parce que toute
personne a droit à un infini respect, nous pensons que doit s'exercer envers chacun un
devoir de compassion sans bornes qui peut parfois conduire jusqu'à la transgression.
Paradoxe ? Sans doute. Mais c'est la grandeur et le tragique de la vie humaine qui sont
ici en jeu.
Le groupe paroles est constitué de seize personnalités catholiques, de générations, de
sensibilités et d'expériences différentes.
par le Groupe Paroles
ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 07.07.01

articles du monde sur l'éthique: http://olivier.hammam.free.fr/imports/lemonde/sciences/serie03.htm
|