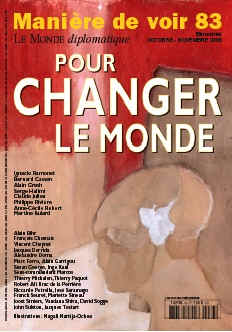
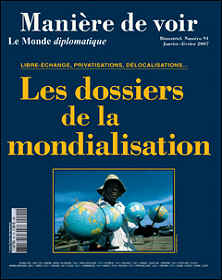
http://rezo.net/
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/05-06prefig/html/index.htm
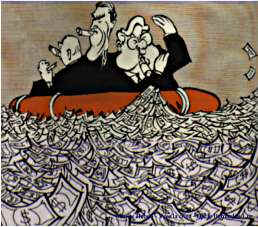
Mondialisation : http://www.attac.org/fra/themes/mondialisation.htm
Il s'agit tout simplement de se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde.

Quelles Démocratie Voulons Nous?
Sous la Direction de Alain Caillé: La Découverte 2006;

DE L’ANTITERRORISME À LA GUERRE
La violence de la mondialisation
Par Jean Baudrillard
Philosophe, auteur, entre autres, de La guerre du Golfe n’a pas eu lieu (1991), Le
Crime parfait (1994) et L’Esprit du terrorisme (2002), tous parus chez Galilée. Ce
texte est tiré de son nouvel essai, Power Inferno (Galilée, Paris, 96 pages, 12 ?),
disponible en librairie le 13 novembre.© Editions Galilée pour le monde entier.
Y a-t-il une fatalité de la mondialisation ? Toutes les cultures autres que la nôtre
échappaient de quelque façon à la fatalité de l’échange indifférent. Où est le
seuil critique de passage à l’universel, puis au mondial ? Quel est ce vertige qui
pousse le monde à l’abstraction de l’Idée, et cet autre vertige qui pousse à
la réalisation inconditionnelle de l’Idée ?
Car l’universel était une Idée. Lorsqu’elle se réalise dans le mondial, elle
se suicide comme Idée, comme fin idéale. L’humain devenu seule instance de
référence, l’humanité immanente à elle-même ayant occupé la place vide du Dieu
mort, l’humain règne seul désormais, mais il n’a plus de raison finale.
N’ayant plus d’ennemi, il le génère de l’intérieur, et sécrète toutes
sortes de métastases inhumaines.
De là cette violence du mondial - violence d’un système qui traque toute forme de
négativité, de singularité, y compris cette forme ultime de singularité qu’est la
mort elle-même - violence d’une société où nous sommes virtuellement interdits de
conflit, interdits de mort - violence qui met fin en quelque sorte à la violence
elle-même, et qui travaille à mettre en place un monde affranchi de tout ordre naturel,
que ce soit celui du corps, du sexe, de la naissance ou de la mort. Plus que de violence,
il faudrait parler de virulence. Cette violence est virale : elle opère par contagion,
par réaction en chaîne, et elle détruit peu à peu toutes nos immunités et notre
capacité de résistance.
Cependant, les jeux ne sont pas faits, et la mondialisation n’a pas gagné
d’avance. Face à cette puissance homogénéisante et dissolvante, on voit se lever
partout des forces hétérogènes - pas seulement différentes, mais antagonistes.
Derrière les résistances de plus en plus vives à la mondialisation, résistances
sociales et politiques, il faut voir plus qu’un refus archaïque : une sorte de
révisionnisme déchirant quant aux acquis de la modernité et du « progrès », de rejet
non seulement de la technostructure mondiale, mais de la structure mentale
d’équivalence de toutes les cultures. Cette résurgence peut prendre des aspects
violents, anomaliques, irrationnels au regard de notre pensée éclairée - des formes
collectives ethniques, religieuses, linguistiques -, mais aussi des formes individuelles
caractérielles ou névrotiques. Ce serait une erreur que de condamner ces sursauts comme
populistes, archaïques, voire terroristes. Tout ce qui fait événement aujourd’hui
le fait contre cette universalité abstraite - y compris l’antagonisme de
l’islam aux valeurs occidentales (c’est parce qu’il en est la contestation
la plus véhémente qu’il est aujourd’hui l’ennemi numéro un).
Qui peut faire échec au système mondial ? Certainement pas le mouvement de
l’antimondialisation, qui n’a pour objectif que de freiner la dérégulation.
L’impact politique peut être considérable, l’impact symbolique est nul. Cette
violence-là est encore une sorte de péripétie interne que le système peut surmonter
tout en restant maître du jeu.
Ce qui peut faire échec au système, ce ne sont pas des alternatives positives, ce sont
des singularités. Or, celles-ci ne sont ni positives ni négatives. Elles ne sont pas une
alternative, elles sont d’un autre ordre. Elles n’obéissent plus à un jugement
de valeur ni à un principe de réalité politique. Elles peuvent donc être le meilleur
ou le pire. On ne peut donc les fédérer dans une action historique d’ensemble.
Elles font échec à toute pensée unique et dominante, mais elles ne sont pas une
contre-pensée unique - elles inventent leur jeu et leurs propres règles du jeu.
Les singularités ne sont pas forcément violentes, et il en est de subtiles, comme celle
des langues, de l’art, du corps ou de la culture. Mais il en est de violentes - et le
terrorisme en est une. Elle est celle qui venge toutes les cultures singulières qui ont
payé de leur disparition l’instauration de cette seule puissance mondiale.
Il ne s’agit donc pas d’un « choc de civilisations », mais d’un
affrontement, presque anthropologique, entre une culture universelle indifférenciée et
tout ce qui, dans quelque domaine que ce soit, garde quelque chose d’une altérité
irréductible.
Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que l’orthodoxie religieuse,
toutes les formes différentes et singulières sont des hérésies. A ce titre, elles sont
vouées soit à rentrer de gré ou de force dans l’ordre mondial, soit à
disparaître. La mission de l’Occident (ou plutôt de l’ex-Occident,
puisqu’il n’a plus depuis longtemps de valeurs propres) est de soumettre par
tous les moyens les multiples cultures à la loi féroce de l’équivalence. Une
culture qui a perdu ses valeurs ne peut que se venger sur celles des autres. Même les
guerres - ainsi celle d’Afghanistan - visent d’abord, au-delà des stratégies
politiques ou économiques, à normaliser la sauvagerie, à frapper d’alignement tous
les territoires. L’objectif est de réduire toute zone réfractaire, de coloniser et
de domestiquer tous les espaces sauvages, que ce soit dans l’espace géographique ou
dans l’univers mental.
La mise en place du système mondial est le résultat d’une jalousie féroce : celle
d’une culture indifférente et de basse définition envers les cultures de haute
définition - celle des systèmes désenchantés, désintensifiés, envers les cultures de
haute intensité -, celle des sociétés désacralisées envers les cultures ou les formes
sacrificielles.
Pour un tel système, toute forme réfractaire est virtuellement terroriste (1). Ainsi
encore l’Afghanistan. Que, sur un territoire, toutes les licences et libertés «
démocratiques » - la musique, la télévision ou même le visage des femmes - puissent
être interdites, qu’un pays puisse prendre le contrepied total de ce que nous
appelons civilisation - quel que soit le principe religieux qui soit invoqué, cela est
insupportable au reste du monde « libre ». Il n’est pas question que la modernité
puisse être reniée dans sa prétention universelle. Qu’elle n’apparaisse pas
comme l’évidence du Bien et l’idéal naturel de l’espèce, que soit mise
en doute l’universalité de nos moeurs et de nos valeurs, fût-ce pour certains
esprits immédiatement caractérisés comme fanatiques, cela est criminel au regard de la
pensée unique et de l’horizon consensuel de l’Occident.
Cet affrontement ne peut être compris qu’à la lumière de l’obligation
symbolique. Pour comprendre la haine du reste du monde envers l’Occident, il faut
renverser toutes les perspectives. Ce n’est pas la haine de ceux à qui on a tout
pris et auxquels on n’a rien rendu, c’est celle de ceux à qui on a tout donné
sans qu’ils puissent le rendre. Ce n’est donc pas la haine de la dépossession
et de l’exploitation, c’est celle de l’humiliation. Et c’est à
celle-ci que répond le terrorisme du 11 septembre : humiliation contre humiliation.
Le pire pour la puissance mondiale n’est pas d’être agressée ou détruite,
c’est d’être humiliée. Et elle a été humiliée par le 11 septembre, parce
que les terroristes lui ont infligé là quelque chose qu’elle ne peut pas rendre.
Toutes les représailles ne sont qu’un appareil de rétorsion physique, alors
qu’elle a été défaite symboliquement. La guerre répond à l’agression, mais
pas au défi. Le défi ne peut être relevé qu’en humiliant l’autre en retour
(mais certainement pas en l’écrasant sous les bombes ni en l’enfermant comme un
chien à Guantánamo).
La base de toute domination, c’est l’absence de contrepartie - toujours selon la
règle fondamentale. Le don unilatéral est un acte de pouvoir. Et l’empire du Bien,
la violence du Bien, c’est justement de donner sans contrepartie possible. C’est
occuper la position de Dieu. Ou du Maître, qui laisse la vie sauve à l’esclave, en
échange de son travail (mais le travail n’est pas une contrepartie symbolique, la
seule réponse est donc finalement la révolte et la mort). Encore Dieu laissait-il place
au sacrifice. Dans l’ordre traditionnel, il y a toujours la possibilité de rendre,
à Dieu, à la nature, ou à quelque instance que ce soit, sous la forme du sacrifice.
C’est ce qui assure l’équilibre symbolique des êtres et des choses.
Aujourd’hui, nous n’avons plus personne à qui rendre, à qui restituer la dette
symbolique - et c’est cela la malédiction de notre culture. Ce n’est pas que le
don y soit impossible, c’est que le contre-don y soit impossible, puisque toutes les
voies sacrificielles ont été neutralisées et désamorcées (il ne reste plus
qu’une parodie de sacrifice, visible dans toutes les formes actuelles de la
victimalité).
Nous sommes ainsi dans la situation implacable de recevoir, toujours recevoir, non plus de
Dieu ou de la nature, mais de par un dispositif technique d’échange généralisé et
de gratification générale. Tout nous est virtuellement donné, et nous avons droit à
tout, de gré ou de force. Nous sommes dans la situation d’esclaves à qui on a
laissé la vie, et qui sont liés par une dette insoluble. Tout cela peut fonctionner
longtemps grâce à l’inscription dans l’échange et dans l’ordre
économique, mais, à un moment donné, la règle fondamentale l’emporte, et à ce
transfert positif répond inévitablement un contre-transfert négatif, une abréaction
violente à cette vie captive, à cette existence protégée, à cette saturation de
l’existence. Cette réversion prend la forme soit d’une violence ouverte (le
terrorisme en fait partie), soit du déni impuissant, caractéristique de notre
modernité, de la haine de soi et du remords, toutes passions négatives qui sont la forme
dégradée du contre-don impossible.
Ce que nous détestons en nous, l’obscur objet de notre ressentiment, c’est cet
excès de réalité, cet excès de puissance et de confort, cette disponibilité
universelle, cet accomplissement définitif - le destin que réserve au fond le Grand
Inquisiteur aux masses domestiquées chez Dostoïevski. Or, c’est exactement ce que
réprouvent les terroristes dans notre culture - d’où l’écho que trouve le
terrorisme et la fascination qu’il exerce.
Tout autant que sur le désespoir des humiliés et des offensés, le terrorisme repose
ainsi sur le désespoir invisible des privilégiés de la mondialisation, sur notre propre
soumission à une technologie intégrale, à une réalité virtuelle écrasante, à une
emprise des réseaux et des programmes qui dessine peut-être le profil involutif de
l’espèce entière, de l’espèce humaine devenue « mondiale » (la suprématie
de l’espèce humaine sur le reste de la planète n’est-elle pas à l’image
de celle de l’Occident sur le reste du monde ?). Et ce désespoir invisible - le
nôtre - est sans appel, puisqu’il procède de la réalisation de tous les désirs.
Si le terrorisme procède ainsi de cet excès de réalité et de son échange impossible,
de cette profusion sans contrepartie et de cette résolution forcée des conflits, alors
l’illusion de l’extirper comme un mal objectif est totale, puisque, tel
qu’il est, dans son absurdité et son non-sens, il est le verdict et la condamnation
que cette société porte sur elle-même.
Protestataires, unissez-vous !
Ignacio Ramonet
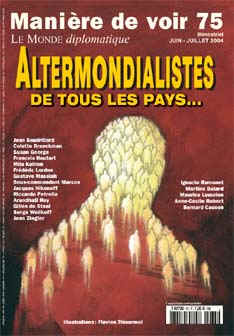
LES SERGENTS RECRUTEURS DE LA CONTESTATION
Certains bons esprits s’interrogent sur l’avenir du mouvement altermondialiste.
L’élémentaire bon sens indique pourtant que ce mouvement tire sa force initiale de
la violence sociale et culturelle de la mondialisation réellement existante. Et, de ce
point de vue, les premiers sergents recruteurs des rangs de la contestation sont les
gouvernements, les organismes patronaux, les institutions internationales (OMC, FMI et
Banque mondiale) ou européennes, qui, malgré quelques inflexions verbales, poursuivent
partout et sans relâche leur politique d’augmentation des injustices et de
destruction de tout ce qui « fait société ».

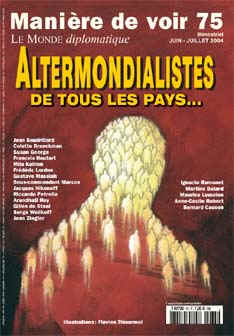
http://carpediemcom.free.fr
DE LA MONDIALISATION NEOLIBERALE, OU COMMENT SCIER LA
BRANCHE...
"Aujourd'hui, la question primordiale n'est plus la production, mais la répartition.
L'appareil productif mondial, considéré globalement, produit plus de biens que
nécessaire à la satisfaction de tous les besoins de base de l'humanité. Selon l'ONU, la
production dépasse de 23% les besoins fondamentaux : tout le monde pourrait donc manger
à sa faim...". René Passet* lance un cri d'alarme et dénonce les dangers de la
vision mondiale à très court terme des économistes néolibéraux.
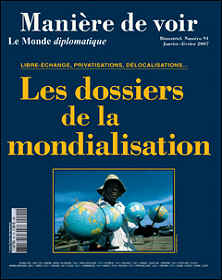
Véronique Anger : Que signifie être alter mondialisme aujourd'hui ? L'alter mondialiste
est-il, avant tout, un humaniste ? Comment concilier humanisme et mondialisation ?
René Passet : Les alter mondialistes entendent démontrer que, face à une mondialisation
établie sur la rationalité de l'argent, une autre mondialisation, fondée sur les
finalités humaines de l'économie, est non seulement possible mais nécessaire.
L'humanisme qu'on leur jette à la face, comme si c'était une tare, n'est pas seulement
une question de bons sentiments mais, bien plus encore, de rationalité. Ce n'est pas
"le cœur contre la raison", mais "rationalité contre
rationalité".
Ceux -dont je suis- qui s'opposent à la mondialisation néolibérale ont été longtemps
présentés comme des "anti-mondialistes". Accusation fausse, car le vrai
mondialisme est celui qui s'efforce de rapprocher les peuples dans le monde(1) et non
celui qui se contente d'offrir ce monde à la rapacité des puissances financières. Nous
voulons démontrer que la mondialisation actuelle, qui prétend au monopole de la
rationalité, repose en fait sur des conditions économiques et des conventions d'un autre
temps qui n'ont plus aucun fondement aujourd'hui.
VA : Ce à quoi les néolibéraux rétorquent inlassablement : "Vous êtes des
humanistes ; votre vision du monde moderne n'est pas rationnelle"...
RP : Comme j'ai tenté de l'expliquer notamment dans mon livre "Eloge du mondialisme
par un "anti" présumé(2)" ce que les économistes orthodoxes considèrent
comme étant "la rationalité" s'est constitué à la fin XVIIIème/début
XIXème, alors que le niveau de vie de 90 % de la population était proche du minimum
vital. De Quesnay à Stuart Mill en passant par Adam Smith et Karl Marx, tous les
économistes sont d'accord sur ce constat. Dans ces conditions, il est évident que le
mieux-être des populations passait prioritairement par l'accroissement quantitatif des
productions : le plus était aussi le mieux ; deux quintaux de blé permettaient
satisfaire davantage de besoins alimentaires qu'un seul quintal... Dans ce contexte, le
problème principal était donc de produire le plus efficacement possible et au meilleur
coût. Cela vaut tout particulièrement pour l'alimentation et pour l'ensemble des besoins
fondamentaux.
Produire le plus possible et au meilleur coût dépend de l'efficacité de l'instrument
productif. La concurrence est le moyen par lequel les entreprises sont obligées de
rechercher en permanence cette efficacité pour conserver leur place sur le marché. En
une phrase, dans cette situation la satisfaction des besoins passe en premier lieu par
l'organisation rationnelle de l'appareil productif. C'est ce que les économistes
appellent "rationalité instrumentale".
En outre, ce souci de "produire plus" se situait dans le contexte d'une nature
qui n'était pas encore menacée dans ses régulations par les activités humaines. Cette
nature semblait alors tellement hors d'atteinte qu'elle apparaissait, pour reprendre les
termes de Ricardo : "inépuisable, indestructible, inaltérable dans son
principe". Comme le dit alors Jean-Baptiste Say, elle n'est pas produite par les
hommes et n'a pas à être reproduite par eux ; elle n'entre donc pas dans le champ du
calcul économique et, dans ce sens, on déclare qu'elle constitue un "bien
libre". Donc, ce "plus" produit davantage de bien-être sans menacer le
milieu qui porte les activités économiques et dont les dégradations menaceraient les
populations humaines.
Ajoutons enfin que le capital technique, fabriqué par les hommes, était de ce fait le
seul facteur relativement rare dont le rythme d'accumulation commandait le taux de
croissance de l'économie. Il était donc rationnel de rapporter la performance au facteur
qui en était la cause la plus directe. La rationalité instrumentale se polarisait
essentiellement sur le capital.
Dans ces conditions, les "pères fondateurs" de l'économie, dont je ne partage
pas le libéralisme, avaient raison dans le choix des conventions de base sur lesquelles
ils appuyaient leurs raisonnements. Ces conventions correspondaient aux réalités de leur
temps. Malheureusement, de nos jours la plupart des économistes continuent à raisonner
sur les mêmes bases et à s'appuyer sur une rationalité rigoureusement instrumentale
alors que les conditions qui la fondaient ont changé et que les conventions ne peuvent
plus rester les mêmes.
VA : Vous voulez dire que nous ne sommes plus à l'ère de la rationalité instrumentale ?
RP : C'est bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, la question primordiale n'est plus la
production, mais la répartition. L'appareil productif mondial, considéré globalement,
produit plus de biens que nécessaire à la satisfaction de la plupart des besoins
fondamentaux de l'humanité. Selon l'ONU, la production alimentaire dépasse de 23% les
besoins fondamentaux et théoriquement, tout le monde devrait donc pouvoir donc manger à
sa faim. Par ailleurs, dans de nombreux secteurs -comme l'automobile, l'agro-industriel,
les industries lourdes, la production de logiciels,…- la situation
"normale" n'est pas la rareté, mais la surproduction. La part prépondérante
des coûts fixes oblige de produire le plus possible à l'échelle mondiale pour étaler
ces coûts sur le plus grand nombre d'unités. La compétition qui en résulte impose à
chacun d'abaisser ses prix - donc ses coûts- et cela ne peut être obtenu que par de
nouveaux accroissements de production. En d'autres termes, la surproduction engendre la
surproduction. C'est un cercle vicieux. Le "plus" cesse d'être le mieux.
D'autant qu'il débouche sur la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, on le sait,
les limites sont franchies. Produire plus signifie notamment l'épuisement des ressources
naturelles, l'accumulation des déchets ; l'accroissement de la consommation d'énergie
engendre l'effet de serre et le dérèglement des climats…La nature n'est plus le
"bien libre" des siècles précédents. Sa reproduction entre dans le champ du
calcul économique. Ainsi apparaît la question des finalités : produire plus pour qui,
pour quoi, à quelles fins? La question primordiale devient celle de la répartition.
Ainsi, alors que nous produisons plus de denrées et de biens fondamentaux qu'il n'en
faudrait pour satisfaire les besoins vitaux de toute l'humanité, 850 millions d'individus
sont sous-alimentés et 1 milliard 300 millions meurent de faim. Un premier problème de
partage apparaît donc entre riches et pauvres à l'intérieur des générations
présentes.
Il se complique d'un problème de partage inter générationnel. Lorsque nous détruisons
la biosphère, c'est le sort des générations futures qui est en jeu. La Commission
Bruntland(3), à l'origine de la définition du développement durable, prône la
solidarité entre générations : "Le développement durable répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs". Alors surgit une question : au nom de quoi doit-on se sacrifier au profit de
gens que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas encore nés? La réponse ne se situe
pas dans le champ de l'économie, mais dans celui des valeurs morales et de la
philosophie. C'est notre conception de la vie et de la solidarité de l'espèce qui est en
cause.
VA : Nous sommes soucieux des générations qui suivent immédiatement, pourtant, notre
comportement destructeur vis-à-vis de l'environnement montre à quel point notre sens de
la solidarité à l'égard des générations futures est limité... Quelle est la solution
?
RP : L'économie n'a pas de théorie de l'optimum de répartition. Vilfredo Pareto(4), le
grand théoricien de l'optimum économique le soulignait lui-même : "Mon
optimum" -disait-il en substance- "est un optimum de production qui varie avec
l'état de répartition. Autant de répartitions différentes, autant de besoins
différents et autant de conceptions différentes de l'optimum de production. Mais aucune
considération d'ordre strictement économique ne me permet de dire s'il vaut mieux une
nation riche et inégalitaire ou une nation moins riche et plus égalitaire... C'est une
affaire de sentiments.". Autrement dit, c'est une affaire de conscience et de
jugement de valeur. Ainsi, la question de la répartition est indissociable des valeurs et
des finalités.
La rationalité se déplace donc du champ de l'instrument vers le celui des finalités,
c'est-à-dire de l'humain car l'activité économique ne transforme la nature qu'en vue de
satisfaire les besoins humains. Cela me conduit à dire qu'il faut substituer à la
finalité instrumentale une rationalité finalisée, définie en fonction de la couverture
des besoins humains. Ce qui compte à propos d'une décision, c'est l'impact qu'elle aura
sur ce que François Perroux appelait "la couverture des coûts de
l'homme"… la concurrence cède le pas à la solidarité.
VA : Evoquer la solidarité comme élément clé de l'économie... Il fallait oser ! On
est loin de la théorie de l'offre et de la demande!
RP : L'économie traditionnelle entend démontrer que le libre jeu du marché permet
d'ajuster l'offre et la demande dans les meilleures conditions d'efficacité possibles.
Or, la demande n'est pas le besoin, mais seulement le besoin "solvable",
c'est-à-dire accompagné d'un pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Or, la finalité de l'économie c'est de couvrir les besoins humains, solvables ou non,
accompagnés ou non d'un pouvoir d'achat ; c'est un changement important que la
rationalité finalisée impose de prendre en compte.
Les conséquences sont considérables. J'en donnerai un seul exemple, mais, en fait, il
n'est pas un domaine de l'économie qui n'en soit bouleversé. Lorsque sur le marché
mondial la petite agriculture vivrière des pays pauvres doit affronter la concurrence de
l'agriculture fortement mécanisée des pays industrialisés, la différence de
productivité est telle (jusqu'à 500 et 1.000 fois plus grande par tête en faveur de la
seconde) que le résultat ne fait aucun doute. C'est l'éradication totale des productions
vivrières. A partir de là, deux discours sont tenus : celui de la rationalité
instrumentale qui constate que le plus efficace ayant éliminé le moins efficace,
l'efficacité moyenne dans le monde s'est accrue et en conclut que tout est très bien
ainsi ; celui de la rationalité finalisée qui voit le coût humain subi par les
populations déracinées ayant perdu leur instrument de travail et leurs moyens de
subsistance et qui conteste le sens d'une "efficacité" dont le résultat sera,
le plus souvent de produire davantage de biens existant déjà en quantités excessives :
plus de trop, ce qui est absurde. La conséquence en termes de politique économique sera
totalement différente : là où les premiers préconiseront le libre échange, nous
revendiquerons le droit des peuples à satisfaire par eux-mêmes leurs besoins
fondamentaux… et à se protéger pour cela, si c'est nécessaire, pour se doter des
moyens techniques leur permettant d'accroître leur productivité et de s'ouvrir un jour
à la compétition. C'est ainsi que tous les pays aujourd'hui développés, ont agi par le
passé. L'Angleterre elle-même, premier pays à s'industrialiser, et hier champion du
libéralisme, a commencé par éliminer la concurrence hollandaise en s'assurant un
monopole commercial grâce aux Actes de Navigation(5) de Cromwell.
Les champions de la mondialisation néolibérale se trompent d'époque. Ils se fondent sur
la rationalité des siècles passés sans vouloir remarquer que le monde et les temps ont
changé.
VA : Vous parlez de changer de paradigme ! C'est tout un système de pensée qui doit
évoluer...
RP : Je suis conscient que ce n'est pas rien... Mais au fil du temps et des générations,
les idées font leur chemin. Vous savez, la vision mondialiste actuelle, qui ne sait voir
que le très court terme, est tout simplement suicidaire.
Ses tenants sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis... Selon les
scénarios modérés d'évolution démographique élaborés par les Nations unies, la
population mondiale devrait se situer aux environs de 9 milliards d'individus vers 2050.
La quasi totalité des accroissements de population va se produire principalement dans les
pays du Sud et tout particulièrement dans les pays les plus pauvres qui verront leur
population tripler. Globalement, la population du monde riche stagne et celle de l'Europe
régresse, tout en vieillissant -l'une et l'autre- beaucoup plus rapidement que celle des
pays du Sud.
Que se passera-t-il lorsqu'un petit îlot, constitué de populations stationnaires
vieillissantes et accumulant de plus en plus de richesses, sera entouré d'un océan de
misère ne cessant de gonfler et dont l'âge moyen augmentera beaucoup moins vite? Il faut
être fou pour croire que cette situation serait tenable. Voilà pourquoi je pense que la
politique "réaliste" des néolibéraux conduit l'humanité droit au suicide.
Voulons-nous, oui ou non, devancer les catastrophes? Il est encore temps de réagir, mais
il devient plus qu'urgent d'alerter l'opinion mondiale sur ces questions.
(1) "Mondialisme : réaliser l'unité de la communauté humaine" (définition du
Robert)
(2) Editions Fayard. 2001
(3) Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement, dite Commission
Bruntland, du nom de Madame Gro Harlem Bruntland qui l'a présidée (1987)
(4) Sociologue et économiste (1848-1923), connu pour sa " courbe de Pareto ",
successeur de Léon Walras à la chaire d'économie politique de l'université de
Lausanne, il fonde l'économie sur les méthodes mathématiques et approfondit le concept
d'" optimum économique "
(5) En 1651 Cromwell fait voter l'" Acte de Navigation " qui assure à
l'Angleterre un monopole commercial : seuls des navires anglais peuvent transporter des
marchandises vers le pays. Cette mesure, dirigée contre les Hollandais, est à l'origine
du formidable développement de la marine anglaise.
*René Passet, professeur émérite de sciences économiques à la Sorbonne, ancien
président du conseil scientifique de l'association ATTAC (Association pour la Taxation
des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens). Il a notamment publié :
"L'illusion néolibérale" (Flammarion. 01) ; "Eloge du mondialisme par un
"ant "présumé" (Fayard. 01) ; "L'économique et le vivant"
(couronné par l'Académie des sciences morales et politiques - Payot 1979 ) ; "Une
économie de rêve" (Calmann-Levy 1995. Nouvelle édition Mille et une Nuits 2003).
Voir aussi : http://www.france.attac.org/au831
René Passet dans Les Di@logues Stratégiques et Des Idées & des Hommes :
L'Homme, mesure de toute chose (juillet 2002)
Parce que le monde et les temps changent (juin 2002)
Voir aussi :
POUR UNE VISION POSITIVE DE LA MONDIALITE (Patrick Viveret. Des Idées & des Hommes
Février 05)
http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-399088,0.html

Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef
anger@carpediemcommunication.com
L'HOMME, MESURE DE TOUTE CHOSE
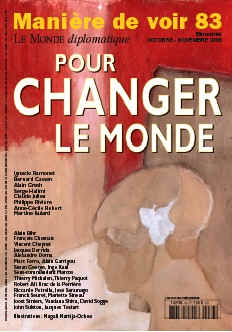
"Alors qu'aujourd'hui l'économie est la fin et la personne humaine le moyen de la
servir, je pense qu'il faut retrouver le sens de l'humain -non pas en bonnes intentions-
mais en tant que finalité. C'est notre défi.". Ce message est essentiel pour René
Passet*, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de
Paris I et l'un des pionniers mondiaux de l'étude des relations de l'économique et du
vivant.
Véronique Anger : Vous êtes l'un des premiers à avoir étudier les relations entre
économie et écologie. Pensez-vous que la notion d'état stationnaire(1) -non pas la
croissance "0"(2), mais le changement en douceur- pourrait être la solution du
développement durable(3) : une fois tout le monde pourvu, le développement pourrait se
poursuivre harmonieusement ?
René Passet : Vous avez raison de préciser "changement progressif " et non
"croissance 0". En effet, l'univers, la vie, sont en constante évolution.
Votre question me conduit à faire le parallèle avec l'image de "l'état
stationnaire", la phase ultime du développement telle que la concevaient Stuart
Mill(4) ou Adam Smith(5).
Selon Stuart Mill, les modes de consommation vont se modifier au fur et à mesure du
développement, jusqu'à ce que les besoins fondamentaux des hommes soient satisfaits. Une
fois la demande saturée, les prix vont baisser. Les secteurs les plus touchés vont alors
cesser d'intéresser les investisseurs. Par conséquent, les consommations de type
"matérielles" deviendront de moins en moins rentables.
Stuart Mill pensait que la croissance matérielle allait céder le pas au développement
du secteur immatériel (culture, enseignement, loisirs, santé,…). Plus largement,
selon son idée, tout ce qui participe à la joie de vivre devait se situer hors économie
marchande. Un beau rêve, qui plaidait pour la gratuité de l'épanouissement des
individus.
Nous constatons aujourd'hui, qu'en même temps que les moteurs du développement et les
modes de consommation se déplacent vers l'immatériel (vers les services) ils sont
absorbés par l'économie marchande. On tente effectivement de libéraliser la culture,
l'enseignement, la santé, de breveter le vivant.
L'évolution vers des formes plus immatérielles me semble un des moyens de s'orienter
vers un développement plus soutenable. Nous, pays riches, avons atteint le seuil de
saturation de nos besoins fondamentaux et, au-delà, de nos besoins de confort.
En revanche, pour toute la partie pauvre de l'humanité -je pense principalement à la
Chine et à l'Inde- le développement va passer par une accumulation de moyens matériels.
Va alors se poser la question de l'équilibre du monde : la planète pourra-t-elle
supporter la généralisation, à l'échelle mondiale, des modes de vie et des niveaux de
vie occidentaux ? La réponse est clairement "non". Je vois cependant deux
issues possibles :
1° Une croissance plus économe en énergie et en matières : les procédés existent,
mais ils ne sont pas encore suffisamment exploités. Pourtant, leur utilisation
permettrait à tous les pays (riches et pauvres) de poursuivre leur croissance matérielle
tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie. Benjamin Dessus(6) en
France ou Jose Goldenberg au Brésil en ont d'ailleurs fait la démonstration.
2° Poursuivre notre développement, mais sous une forme plus "immatérielle",
en attendant que les pays moins industrialisés s'engagent à leur tour dans cette voie.
VA : Dans la revue Transversales Science/Culture, vous parlez souvent d'économie avec
marché et pas seulement de marché. Pouvez-vous développer votre idée ?
RP : Cette approche est celle du Groupe des Dix(7). Nous parlons d'économie
"avec" marché parce que nous ne souhaitons pas renoncer aux avantages du
marché. Nous lui prêtons au moins deux aspects positifs.
Il libère les énergies humaines et la créativité individuelle. Par ailleurs, c'est un
excellent stimulant, ce qui n'est pas le cas des économies planifiées. Devant un
obstacle majeur, l'économie intégralement planifiée des pays de l'Est s'est effondrée
brusquement. Lorsqu'elle a cessé d'écraser, c'est elle qui s'est écrasée…
C'est également un régulateur spontané, un facteur d'équilibre. Le marché est
multiple. Face à un obstacle, des millions de centres de décision vont réagir, chacun
à sa façon. Le système en sortira modifié, mais mieux adapté. Par exemple, le
capitalisme a survécu à la crise de 29, mais sous une forme différente.
Evidemment, le marché comporte aussi des inconvénients. En particulier, il ne sait pas
satisfaire les besoins, mais uniquement la demande accompagnée d'un pouvoir d'achat. Il
ne sait pas non plus calculer à très long terme, ni prendre en compte l'intérêt
général.
C'est aussi le véhicule de la domination. Le marché permet à quelques secteurs clés de
s'emparer du pouvoir et d'imposer leur loi à l'ensemble de l'économie. De mon point de
vue, l'emprise des marchés financiers sur l'ensemble de l'économie, avec les
conséquences parfois désastreuses que nous connaissons à l'échelle mondiale, constitue
le principal problème.
Pour toutes ces raisons, nous préférons l'économie "avec" marché à
l'économie "de" marché. Le concept d'économie "plurielle"
(développé dans Transversales) conjugue initiative individuelle et régulation marchande
tout en permettant la prise en compte de l'intérêt général par la collectivité,
l'état, les services publics et le secteur de l'économie solidaire.
Initiative individuelle, régulation marchande et intérêt général : trois éléments
dont les logiques sont partiellement contradictoires. C'est pourquoi des arbitres (non
seulement l'état, mais tous les stakeholders(8) et l'ensemble des mouvements citoyens)
doivent veiller à la préservation de l'intérêt général.
VA : Comment s'organiser pour contrebalancer les grands pouvoirs (économiques,
militaires, politiques, médiatiques) ?
RP : Il existe divers moyens pour contrebalancer les grands pouvoirs, notamment la loi et
la coopération entre les gouvernements. Quand les pouvoirs financiers sont mondiaux, la
loi, limitée aux frontières, ne suffit plus.
Sans aller jusqu'à imaginer un gouvernement mondial, la coopération entre états (dans
des secteurs limités) est une solution possible. Ceux-ci pourraient accepter de coopérer
dans tous les domaines où les problèmes sont universels (effet de serre, contrôle de la
sphère financière, mouvements de capitaux,…).
Les lendemains de Manhattan prouvent que cette entente est possible. Huit jours après les
attentats du 11 septembre, les états se sont alliés pour neutraliser les filières du
financement du terrorisme.
Parallèlement à cela, les mouvements civiques, citoyens, les ONG authentiques,…
constituent un réel contre-pouvoir. Mon expérience à ATTAC m'a convaincu de
l'efficacité de telles organisations. Grâce à l'informatique, et en particulier à
l'effet amplificateur d'internet, des millions de personnes sur la planète peuvent
réagir en un temps record.
Cette mobilisation mondiale a déjà fait échouer l'Accord Multilatéral sur
l'Investissement (AMI). De même, Monsanto, leader mondial des aliments transgéniques, a
abandonné la commercialisation de son gène "Terminator" sous la pression des
internautes. Les grandes firmes pharmaceutiques qui ont attaqué le gouvernement
sud-africain ont provoqué un tel tollé qu'elles ont finalement dû retirer leur
plainte(9). Les mouvements civiques disposent de moyens d'actions efficaces ; les exemples
de ce type ne manquent pas.
Les citoyens sont concernés par les grands enjeux. Contrairement à certaines idées
reçues, ils ne se désintéressent pas de la politique, mais d'une façon politicienne
d'exercer la politique.
VA : Concernant les biotechnologies, les réseaux, la bio-électronique,… comment
vous situez-vous par rapport à Jeremy Rifkin(10) ou à Bill Joy(11) qui jouent plutôt
les Cassandre ?
RP : Vous savez, quoi qu'en pensent certains, les technologies et l'organisation en
réseaux se développeront, inéluctablement.
Je pense que l'évolution technologique est porteuse du meilleur comme du pire. Je peux
simplement constater qu'au fur et à mesure qu'elle se développe, elle offre à
l'humanité des pouvoirs de plus en plus considérables, parfois très inquiétants.
Pendant des siècles, nous parlions de la "nature". Il existait un "ordre
naturel", avec ses régulations et sa "nature humaine", qui semblait hors
de portée de l'humain et impossible à transformer. Chacun se comportait conformément
aux lois naturelles, qui lui servaient de repères.
Subitement, l'accélération de l'évolution des nouvelles technologies a permis aux
humains d'agir sur la nature, leur environnement, ces forces de l'évolution qui les ont
produits. L'humain est devenu tout-puissant, mais il ignore toujours les réponses aux
grandes questions métaphysiques qui le hantent depuis l'aube de l'humanité : Qu'est-ce
que la vie ? Pourquoi la mort ? Que faisons-nous sur terre ?…
Les technologies -porteuses de grands espoirs dans de nombreux domaines- ne peuvent être
tenues pour responsables des actes commis par certains individus (au détriment des autres
et de la nature) uniquement guidés par la rentabilité financière.
En voulant gérer le monde à très court terme, on interfère avec les grands cycles
régulateurs de la planère qui s'envisagent à d'autres échelles. Pour moi, c'est cela
qui est en jeu.
VA : En tant qu'enseignant, quel message aimeriez-vous que vos étudiants retiennent de
vous ?
RP : Le message que j'aimerais qu'ils retiennent est simple, mais essentiel.
Protagoras(12) disait : "L'homme est la mesure de toute chose". J'espère qu'ils
n'oublieront jamais cette phrase, car rien n'a de sens autrement.
Alors qu'aujourd'hui l'économie est la fin et la personne humaine le moyen de la servir,
je pense qu'il faut retrouver le sens de l'humain -non pas en bonnes intentions- mais en
tant que finalité. C'est notre défi.
*René Passet est professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris
I (Panthéon - Sorbonne) où il a dirigé le "Centre Economie Espace
Environnement" et Président du conseil scientifique du mouvement ATTAC (Association
pour la Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens créée en juin 98
par l'équipe dirigeante du Monde Diplomatique). Il a également publié :
"L'illusion néo-libérale" (Flammarion. 01) ; "Eloge du mondialisme par un
"anti "présumé" (Fayard. 01) ; "L'économique et le vivant"
(couronné par l'Académie des sciences morales et politiques - Payot 1979 ) ; "Une
économie de rêve" (Calmann-Levy 1995),...
Plus d'infos sur : http://perso.respublica.fr/cafeco/passet2002.htm et
http://attac.org/france/
(1) Etat stationnaire : en physique, l'état stationnaire est l'état d'un système dans
lequel certaines grandeurs caractéristiques, dont l'énergie, restent constantes au cours
du temps. Plus d'infos sur :
http://www.chm.ulaval.ca/~chm19079/cinetique_A98/cc96_1/node45.html
(2) En 1971, le Club de Rome lance un vrai pavé dans la marre en publiant " Halte à
la croissance ". Face à la surexploitation des ressources naturelles liée à la
croissance économique et démographique, cette association privée internationale créée
en 1968, prône la " croissance zéro " : le développement économique est
alors présenté comme incompatible avec la protection de la planète à long terme (plus
d'infos sur le site du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable).
(3) Selon la définition de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement, dite Commission Bruntland du nom de Madame Gro Harlem Bruntland qui l'a
présidée (1987 : "Le développement durable répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs"
(4) Philosophe et économiste britannique (1806-1873) Stuart Mill considère la logique
comme une science de la vérité et non comme une science de la déduction. Il est l'un
des représentants les plus marquants de l'utilitarisme. En économie, il se rattache au
courant libéral.
(5) Économiste et philosophe britannique (1723-1790) fondateur de l'école classique
d'économie politique, Adam Smith est connu notamment pour son ouvrage "La Richesse
des nations" dans lequel les principes du " laissez faire " économique de
la société marchande. Il a eu une grande influence sur les théories économiques
postérieures, en particulier sur celles de Ricardo ou de Keynes. Plus d'infos sur :
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Adam_Smith
(6) Pour en savoir plus sur Benjamin Dessus :
http://www.celfosc.org/news/990906.lemonde.htm
(7) Le Groupe des Dix est né en 1966 de l'idée d'intellectuels (Henri Atlan, Henri
Laborit, Edgar Morin, René Passet, Jacques Robin, Michel Rocard, Joël de Rosnay, Michel
Serres, Jacques Testard,…) appartenant à des disciplines différentes (biologie,
économie, sciences sociales, écologie, philosophie, juridique, politique,…) de
confronter leurs savoirs dans le but d'élaborer une réflexion dynamique sur la
société. Si le thème de réflexion majeur portait sur les apports possibles de la
connaissance scientifique au domaine politique, elle a peu à peu posé le problème de
l'importance de la techno science et de son asservissement à l'économie de marché
(8) On appelle "stakeholders" toutes les parties prenantes de l'entreprise : les
salariés, clients, actionnaires, partenaires sociaux, fournisseurs, pouvoirs
publics,…
(9) Au printemps 97, une trentaine de grandes firmes pharmaceutiques ont, en effet,
attaqué en justice l'Afrique du Sud, car Pretoria entendait privilégier les importations
de médicaments génériques pour soigner les "townships"
(10) Militant du Mouvement pour la Paix dans les années 60, l'américain Jeremy Rifkin
est expert en économie et en relations internationales, et président de "Foundation
on Economic Trends". Conférencier sollicité dans le monde entier, conseiller privé
de nombreux chefs d'états, il doit sa notoriété à ses nombreux ouvrages, en
particulier : "La Fin du travail" (La Découverte - 96) traitant de l'impact des
changements techniques et scientifiques sur l'économie, l'emploi, la société et
l'environnement.
Plus d'infos sur : http://mapage.noos.fr/tic-iep/travaux_etudiants/Jeremy_Rifkin.htm
(11) Bill Joy est Directeur de Recherche chez Sun Microsystems. Voir aussi son article
publié dans "Wired" en avril dernier : "Pourquoi le futur n'a pas besoin
de nous ?". Il a été l'un des créateurs du langage informatique Java et il a
co-présidé la Commission américaine sur l'avenir de la recherche sur les technologies
de l'information.
Plus d'infos sur : http://www.tecsoc.org/innovate/focusbilljoy.htm
(12) Protagoras (philosophe humaniste) sophiste grec (486-410 av. J-C.)

POUR UNE VISION POSITIVE DE LA MONDIALITE
Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef
anger@carpediemcommunication.com (DS n°35 - 07/02)
Les idées développées par Patrick Viveret* dans son essai "Pourquoi ça ne va pas
plus mal ?(1)" -pour originales qu'elles soient- ne sont pas utopistes, mais
constructives. Au-delà des idéologies politiques, religieuses ou mercantiles, Patrick
Viveret -qui sort du jargon politique et de la langue de bois auxquels nous ont habitués
les leaders d'opinion- se fonde sur la rationalité et l'analyse scientifique pour
permettre à chacun de nous de comprendre les grands défis de l'humanité de ce siècle
et trouver le chemin qui donnera du sens à sa vie.
Patrick Viveret appartient à l'école humaniste, dans la droite ligne des Lumières et de
la Renaissance. Son livre est, à mon sens, l'un des plus importants depuis ces vingt
dernières années.
Dans son interview de juin 2002 aux Di@logues Stratégiques, "Il faut créer une
énergie transformatrice", Patrick Viveret pointait du doigt la lente dérive de nos
démocraties vers un populisme conservateur, rappelant que l'émergence d'une démocratie
et d'une citoyenneté mondiales sur le terrain politique permettrait de contrecarrer ce
risque. Il nous proposait également une nouvelle approche de l'économie (plus sociale,
plus juste et solidaire) capable de pallier les inégalités d'une mondialisation trop
libérale.
Vivre en paix avec son voisin ne va pas de soi
Dans son essai, "Pourquoi ça ne va pas plus mal?", nous
retrouvons tous les thèmes chers à l'auteur : la prise en charge des enjeux
émotionnels, l'angoisse existentielle (les questions du sens et de la reconnaissance) ;
le citoyen renvoyé à un univers de besoins pour tromper son malaise ; les discours
"régressifs" répondant aux peurs humaines ; l'ambivalence de l'être humain et
la question du désamour (vivre en paix avec son voisin ne va pas de soi) ; enseigner un
art de vivre permettant à chacun de vivre intensément et pacifiquement le voyage
d'humanité.
Plus qu'un simple constat d'échec de la société de consommation et un inventaire des
ravages tant matériels que psychologiques causés par la guerre économique et le
capitalisme totalitaire, Patrick Viveret nous livre ici une réflexion philosophique sans
équivalent sur le mal être de nos sociétés.
Les êtres humains : des êtres d'émotion et de passion
Comment peut-on supporter que la misère continue d'exister alors que l'humanité produit
suffisamment de richesses pour satisfaire les besoins fondamentaux de la planète tout
entière(2)? nous alerte l'auteur qui cite à ce propos Gandhi : "Il y a suffisamment
de ressources pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire le désir
de possession de chacun". L'auteur s'interroge également sur les raisons qui nous
font ignorer les grands enjeux de ce siècle et dénonce notre "politique de
l'autruche" alors que les déséquilibres écologiques s'aggravent : "De
multiples signaux alertent l'humanité sur les dangers qui la menacent, et tout se passe
comme si, à l'échelle planétaire, l'espèce humaine ne se sentait pas
concernée.". Enfin, il se demande d'où vient cette angoisse existentielle qui
gangrène nos sociétés modernes ? Le pouvoir, l'argent, la consommation, le travail, les
drogues,... sont de piètres palliatifs face à nos angoisses. "A travers la
subsistance, c'est en fait une tentative de faire reculer l'angoisse de la mort qui
s'exprime ; on n'est plus alors face à un simple besoin de nourriture, mais face à un
désir de richesse. Et si ce désir est orienté vers l'avoir plutôt que vers l'être, il
va être la source d'une passion d'accaparement bien au-delà que nécessaire.".
Est-ce, comme il le soulignait avec pertinence dans sa première interview aux
"Di@logues Stratégiques" parce que "les êtres humains ne sont pas
simplement des êtres de raison et de besoins ; ils sont aussi des êtres d'émotion et de
passion. L'humanité a cette caractéristique d'être une espèce qui sait qu'elle va
mourir. On ne vit pas, conscient qu'on va disparaître un jour, sans se poser des
questions fondamentales sur le sens de la trajectoire de vie, de la reconnaissance, que ce
soit à titres personnel ou collectif". Cette question, aussi métaphysique que
fondamentale, symbolise la faille de tout être humain vivant dans les sociétés,
notamment occidentales. Aucune espèce n'a, plus que la nôtre, développé la conscience
de la mort (de soi-même et de ses semblables) avec pour conséquence l'angoisse de la
mort. "Dans ce système de lutte contre la mort " écrit-il encore "
construire du sens peut se faire aussi bien par la croyance que par la connaissance(...).
La passion du sens, lorsqu'elle n'est pas régulée, fait le lit des intégrismes, qui
refusent toute autre approche que la leur". Pour Patrick Viveret "seules les
approches qui prennent en compte cet enjeu émotionnel chez l'être humain peuvent nous
guider efficacement.".
Une dépression nerveuse universelle
Alors que l'humanité vit l'un des tournants les plus décisifs de son histoire (nous
sommes confrontés à des dangers d'une gravité inédite pour l'humanité et la
biosphère : risques sanitaires et écologiques, usage dangereux de la révolution du
vivant,..) Patrick Viveret diagnostique une "dépression nerveuse universelle".
Nos sociétés seraient donc maniaco-dépressives... Nous souffrons de ne pouvoir
"être à la bonne heure". En d'autres termes, nous sommes incapables de vivre
intensément le présent, de nous sentir bien dans notre époque et nos baskets... Ce mal
contemporain nous transforme en "mammifères rationnels" pire, en
"mammifères consommant", et la société de consommation fait de nous
d'éternels insatisfaits.
C'est cette "misanthropie du quotidien" qui nous empoisonne la vie : "Il
existe en effet un rapport entre la culture de guerre économique et les grands
dérèglements psychiques qui sont aujourd'hui à la racine de ce que l'on pourrait
appeler(...) le nouveau malaise dans la civilisation de ce début de siècle(...). La
crise n'est pas économique, elle est culturelle et mentale(...). Pourquoi ne
pourrions-nous pas émettre l'hypothèse que les crises dites économiques que nous vivons
sont en fait des crises culturelles liées à la sortie de l'économique?(...). Il est
vrai qu'à travers la culture de crise, nous avons été ramenés un demi-siècle en
arrière, mobilisés par la peur du chômage et de la pauvreté.".
Patrick Viveret compare la situation actuelle avec les aspects psychiques et culturels de
la crise de 1929 qui ont mené le monde à la guerre. Ainsi, nous sommes "en
présence de pathologies mentales collectives dont une face est constituée par la guerre
économique, l'autre étant celle de l'intégrisme et de la purification ethnique. La
première conduit au "nettoyage social"(...). La seconde aux nouvelles guerres
de religion, au terrorisme et au "nettoyage ethnique"(...). Ainsi, l'humanité
en proie aux angoisses et aux rivalités est en train de basculer dans un nouveau cycle de
pestes émotionnelles(3).".
Il ne tient qu'à nous de mieux maîtriser nos passions collectives, explique-t-il encore.
Il nous faut nous "désintoxiquer de nos peurs qui conduisent à l'enfermement
identitaire, de cette dépression qui compense de plus en plus mal l'excitation maladive
du désir de possession ou de consommation(...). Contrairement à ce que pourrait laisser
croire un certain fatalisme ambiant, l'essentiel des problèmes auxquels l'humanité est
confrontée peut trouver des solutions. A condition de comprendre que la plupart des
difficultés ne se situent pas dans l'ordre de l'avoir, celui des ressources physiques,
monétaires, techniques, mais dans l'ordre de l'être, de la façon de concevoir sa place
dans l'univers, de donner un sens à sa vie, de s'en sentir responsable et de se montrer
solidaire de la vie des autres.".
Pour une mondialisation plus humaine
Ainsi, se réapproprier la mondialisation implique de redonner sa place à l'imagination
et à la créativité. Alors seulement pourra apparaître une nouvelle qualité de
participation citoyenne, une conscience planétaire capable de débloquer nos démocraties
devenues perverses, car de plus en plus fondées sur l'obsession de la compétition et de
la domination. "La guerre à autrui, la plupart des sagesses et des traditions
spirituelles (au sens des spiritualités agnostiques ou athées) nous le disent, résulte
directement de notre absence de paix intérieure(...) Voilà pourquoi il nous faut faire
de la question de l'art de vivre et de la sagesse un enjeu politique et pas seulement
individuel". Selon Patrick Viveret, il n'est donc pas utopique de "promouvoir
une vision, une stratégie positives de la mondialité qui soient fondées sur une logique
de coopération, de citoyenneté et d'art de vivre. Les nouvelles technologies peuvent
être un atout dans ce projet, et la réduction du temps de vie consacré au travail n'est
pas fatalement vouée à prendre la forme sauvage du chômage de masse(...). Mais il nous
faut pour cela changer de paradigme et aborder avec une tout autre vision les problèmes
de notre temps(...). Cela suppose de sortir de la logique de guerre, singulièrement de la
guerre économique, d'inventer un autre rapport à la richesse (et à la monnaie), au
pouvoir et à la vie elle-même(...). L'art de vivre, la capacité à surmonter la peur et
le développement de logiques de coopération constituent les axes majeurs d'un projet
politique pour le siècle, un projet qui prendra la forme d'une vision et d'une stratégie
positives de la mondialité.".
C'est donc à nous qu'il appartient de construire une mondialisation plus humaine en
inventant une autre gouvernance reposant sur l'émergence d'un mouvement civique mondial
(l'alter mondialisme) capable d'influencer le politique et le culturel. Cet alter
mondialisme en construction pose la question des intérêts vitaux de l'humanité :
"Qu'allons-nous faire de notre planète, qu'allons-nous faire de notre espèce,
qu'allons-nous faire de notre vie ? Ces trois interrogations radicales qui s'adressent
aujourd'hui à l'humanité à l'échelle mondiale, comment l'Europe les prend-elle en
charge ?" s'interroge -et nous interroge- l'auteur. "La peur qu'elles suscitent
peut très bien déboucher sur de grandes régressions, et en tout cas sur des processus
non démocratiques. Une gouvernance, ou au moins une régularisation mondiale, sera de
toute façon nécessaire compte tenu de l'ampleur des enjeux.".
Que le meilleur gagne !
Pourquoi ai-je aimé ce livre ? J'ai aimé ce livre, vous l'aurez compris, parce qu'il est
bouleversant d'humanité, de profondeur et d'optimisme. N'en déplaise aux Cassandre, cet
essai lumineux est véritablement optimiste et le message de Patrick Viveret plein
d'espoir. Comme l'auteur nous y invite : "Que le meilleur gagne!". Non
pas le plus efficace ou le plus malin, mais le plus humain. Celui qui laissera s'exprimer
ce qu'il y a de meilleur en lui gagnera.
Nous sommes tous concernés par ce livre, car c'est à nous qu'il appartient
"d'inventer une autre vision du politique, pleinement écologique, citoyenne et
planétaire, qui placerait le désir de l'humanité au coeur de sa perspective.". Et,
si on en croit l'auteur, il est encore temps pour chacun d'entre nous de trouver le chemin
pour changer la vie, et changer de vie. Avant que ça aille encore plus mal...?
(1) "Pourquoi ça ne va pas plus mal?" (Editions Fayard. Collection
Transversales. 2005). Préface de Jacques Robin et de Joël de Rosnay. Extraits.
(2) Selon le Rapport mondial sur le développement humain (1998) du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) : "Il serait possible avec 40 milliards de
dollars supplémentaires par an de s'attaquer pour de bon à la famine, aux problèmes
d'accès à l'eau potable et à ces maladies souvent mortelles que l'on sait pourtant
soigner ou prévenir à coûts réduits, comme la tuberculose, la diphtérie, le
paludisme,... Peut-on prétendre que l'on est incapable de mobiliser de telles sommes
alors que dans le même temps les seules dépenses en cigarettes en Europe s'élevaient en
1998 à 50 milliards de dollars et celles en boissons alcoolisées à 105 milliards de
dollars(...), le seul achat des crèmes glacées à 11 milliards de dollars ?" pour
ne citer que ces exemples.
(3) Expression de Wilhelm Reich (1897-1957. L'une des figures les plus connues de la
dissidence freudienne) pour caractériser les grandes régressions psychiques des années
30.
*Patrick Viveret est philosophe, ancien rédacteur en chef de la revue Transversales
Science/Culture, et l'un des initiateurs du processus "Dialogues en humanité".
Conseiller à la Cour des comptes, il est également l'auteur du rapport
"Reconsidérer la richesse" (pour une autre approche de la richesse. Editions de
l'Aube. 2004).

VERS L'HOMME UNIVERS, OU DE LA NECESSITE DE RENDRE LA PAROLE A
L'HOMME
Historien, diplomate, homme de théâtre, écrivain, *Marc Agi est tout cela à la fois.
En 1964, alors qu'il n'a que 28 ans, il rencontre René Cassin(1), compagnon de la
Libération et grand défenseur des droits de l'Homme. Cette rencontre va marquer un
tournant décisif dans son existence. Il lui consacrera plusieurs ouvrages(2) dont un
doctorat d'État sur sa vie et son œuvre.
Depuis 2001, Marc Agi préside l'Académie Internationale des Droits de l'Homme(3).
N'appartenant à aucune école de pensée, à aucun parti politique, à aucun courant
religieux, à aucun mouvement syndical, il essaie -selon ses termes- "de rendre, tout
simplement, la parole à l'Homme".
Véronique Anger : Quelle est votre définition des droits de l'Homme ?
Marc Agi: Pour ceux qui croient en l'existence de la transcendance, les droits
fondamentaux puisent leur source dans les "droits naturels", œuvre de la
divinité. L'Homme est créé par Dieu et, de ce fait, possède une part de sacré
(l'Homme créé à l'image de Dieu) qu'il faut préserver. Cette définition est parfaite
si vous êtes croyant. Si vous ne l'êtes pas - qui que vous soyez et où que vous soyez -
vous avez également droit au respect de vos droits fondamentaux. La notion de droits de
l'Homme est, en quelque sorte, une laïcisation des droits naturels.
Mais il existe plusieurs doctrines juridiques sur les droits de l'Homme. Celles-ci restent
évidemment hors de portée des citoyens ordinaires, tout au moins de ceux qui n'ont
jamais vraiment eu la possibilité de s'adonner au droit. Selon la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme, l'expression "droits de l'Homme" a acquis un
sens philosophique et politique précis : " Elle recouvre l'affirmation des droits
individuels dans un rapport à l'État, à la société et au système socio-économique.
Elle n'exclut pas la diversité des cultures. La Déclaration universelle des droits de
l'Homme marque clairement l'universalité et l'unicité des droits, civils, politiques,
sociaux, culturels et économiques ".
VA : Cette définition peut-elle varier d'un pays à l'autre ?
MA : Quels que soient sa culture et son lieu de vie, l'Homme a droit au respect de ses
droits et libertés fondamentales (même si ceux-ci comportent une large part
d'affectivité et de subjectivité). Il s'agit d'un droit universel. Comme j'essaie de le
montrer dans mon livre(4), l'Homme avec un grand "H" est un être à trois
dimensions, essentielles et concomitantes : l'espace, le temps, le langage - à la
différence des animaux qui ne possèdent pas de langage au sens culturel ou
technologique. Ainsi, chaque être humain vit dans un lieu qui lui est propre, accomplit
au cours de son existence un certain nombre de gestes nécessaires à sa survie, tout en
ayant la faculté de comprendre les autres (ou de ne pas les comprendre). Conscient en
tout cas de leur existence et de leur égale dignité, il est personnellement concerné
dans sa vie et sa chair par la mise en œuvre et le respect des droits de l'Homme.
VA : " De nos jours, nul n'a le droit de ne parler que du haut de lui-même(...). Il
serait plus prudent avant d'ouvrir la bouche, de se mettre en conformité avec une entité
quelconque, comme si conformité était synonyme de légitimité ". Je cite un
extrait de votre livre " L'Homme Univers ". Vous regrettez que les individus ne
puissent s'exprimer que s'ils possèdent une " légitimité ". De quelle
légitimité parlez-vous ?
MA : Je pense que le simple fait d'être un citoyen ordinaire constitue en soi une
légitimité. C'est justement parce que chacun représente le " premier venu "
comme je le nomme, qu'il est légitime. Si on se présente comme appartenant à une
corporation, une association, une " chapelle " de pensée, on exprime le message
de son groupe. Mon interlocuteur va alors me "cataloguer" comme médecin, comme
professeur, comme chrétien, comme juif, musulman,... et interprétera mes paroles dans ce
contexte, c'est-à-dire : en conformité avec une entité bien identifiée. C'est pourquoi
j'oppose le discours des groupes à la parole des hommes (les " premiers venus
").
Dès lors que l'on souhaite contribuer au bien commun, œuvrer pour l'éthique des
droits de l'Homme, le problème de la légitimité se pose. De quel droit travaille-t-on
dans son coin pour le "bien" des autres ? Si chacun attend de recevoir une
légitimité élective ou associative pour agir, rien ne se produira. À travers mon
livre, j'essaie de montrer que, chacun étant le premier venu, il a un rôle à jouer. Or,
les opportunités d'améliorer les libertés, notamment dans le cadre de son travail, sont
multiples. Je pense en particulier à toutes les professions que j'appelle "à
éthique" (médecins, avocats, policiers, enseignants...) parce qu'elles s'exercent
directement sur la personne humaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve.
À chaque "profession à éthique" correspond un droit fondamental qu'elle a
pour mission de promouvoir et de défendre. Exercer sa pratique sur la personne humaine
revient en effet à mettre en œuvre certains droits fondamentaux : l'accès aux
soins, à l'éducation, le droit à la justice, à l'information… Par conséquent, si
chacun exerce " éthiquement " son métier, il peut se rendre universellement
utile et, ainsi, contribuer au bien commun sans cesser d'être le premier venu.
VA : Est-il politiquement possible d'envisager une application éthique des droits de
l'Homme à travers ces professions, et dans le monde entier ?
MA : Je ne pense pas que cela soit utopique. En effet, si tous les professionnels
possédaient la même éthique, le monde progresserait sans doute beaucoup plus
rapidement. Ce n'est pas une question d'identité culturelle, mais d'éthique universelle,
et surtout de pratique.
Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais été sollicité pour
organiser une formation aux droits de l'Homme dans un pays d'Amérique latine que je ne
citerai pas. Le public était uniquement composé de policiers. Comme vous le savez, la
police de certains pays a la fâcheuse réputation de dégainer avant de dire bonjour - en
particulier à l'occasion de manifestations de rue. Dans ce contexte un peu difficile, je
me suis demandé quelle serait la meilleure façon de leur parler des droits de l'Homme.
J'ai alors demandé à des policiers français, spécialistes de la répression
"douce", de venir m'assister. Leurs pratiques "professionnelles"
permettent en effet de disperser les manifestants sans tuer. Si cette technique
fonctionnait en Europe, elle pouvait aussi donner de bons résultats dans d'autres pays.
C'est ce qui a été fait, et nos enseignants policiers ont réussi à sensibiliser
l'auditoire au respect de la vie humaine sans, à aucun moment, avoir à prononcer
l'expression "droits de l'Homme".
Quelques mois seulement après cette formation, une manifestation eut lieu dans le pays.
La foule, réprimée par les policiers qui avaient suivi le stage, n'a subi aucune perte.
En revanche, on a comptabilisé 34 morts du côté des manifestants réprimés par les
troupes de gendarmes utilisant leurs techniques habituelles. Même si l'on est impuissant,
politiquement, à faire respecter les droits de l'Homme dans un pays, cette illustration
est la preuve que la compétence technique dans l'exercice d'une profession à éthique
permet de progresser, ne serait-ce que grâce à la préservation des vies - ce qui est
primordial quand on s'occupe de droits de l'Homme. Je pense que cette démonstration est
valable pour toutes les professions à éthique et applicable aux quatre coins de la
planète.
VA : Dans votre livre l'Homme Univers(4)", vous apportez également quelques
précisions sémantiques, en particulier au sujet des droits de l'Homme et des "
droits-de-l'hommisme ", et dénoncez les " saboteurs de vocabulaire ".
Aurions-nous perdu le sens et la valeur des mots ?
MA : On doit la première Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen à la
Révolution française. La Déclaration d'Indépendance des États-Unis, qui est de 1776,
est plutôt l'expression d'une décolonisation et ne parle pas de l'Homme universel, celui
avec un grand "H" qu'évoque la Déclaration de 1789. On n'y trouve pas non plus
la notion d'indivisibilité des droits de l'Homme, qu'on trouvera plus tard dans la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (universalité des droits civils et
politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels). Ce sont les doctrines
socialistes et le marxisme qui les premiers, au milieu du XIXe siècle, ont défini les
droits économiques et sociaux, en déclarant que l'homme ne devait pas être exploité
par l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que les défenseurs des droits de l'Homme
ont longtemps été étiquetés "de gauche".
Avec le temps - et beaucoup de travail - tout le monde a fini par accepter l'idée d'une
indivisibilité des droits de l'Homme dans ses aspects à la fois civils et politiques,
mais aussi économiques et sociaux. En dépit de cela, certains, ceux que j'appelle
volontiers les "saboteurs de vocabulaire" - généralement quelques détracteurs
plus maladroits que malintentionnés - critiquent la doctrine même des droits de l'Homme,
en essayant de faire croire qu'il s'agit d'une simple idéologie. Ce sont ceux qui parlent
de "droits-de-l'hommisme". Or, les droits de l'Homme sont tout sauf une
idéologie, puisque leur but est de nous protéger contre toutes les idéologies. Cette
expression de droits-de-l'hommisme est, à mon sens, caricaturale de ceux qui
l'utilisent...
VA : Vous proposez de "constituer la parole humaine" en fondant une
"Organisation des peuples unis,(...) sorte de conscience de l'humanité" pour
pallier "la mondialisation économique, la fossilisation des partis politiques
traditionnels et la démobilisation des citoyens". Comment y parvenir sans verser
dans la politique ou l'idéologie ?
AV : C'est en cela que mon entreprise peut paraître difficile et même périlleuse.
J'interpelle chaque citoyen en lui demandant ce qu'il fait pour contribuer au respect de
l'éthique des droits de l'Homme et du bien commun. Je ne lui demande pas de s'inscrire à
un mouvement associatif ou politique. Comme disait René Dumont(5) : "Il faut que
chacun, dans son coin à son niveau, fasse ce qu'il y a à faire".
VA : Œuvrer chacun à son niveau pour le bien commun de l'humanité, est-ce votre
définition de l'Homme Univers ?
MA : En vérité, "l'Homme Univers" est une représentation de la conscience de
l'humanité. L'homme Univers est seulement à l'état d'idéal commun, car il n'existe
encore aucun réel mouvement universel, sorte de société civile internationale
suffisamment organisée, pour pouvoir exercer une influence positive sur la marche du
monde. Pourtant, il me semble plus qu'urgent d'œuvrer à la constitution d'une
"citoyenneté universelle". Faire pression sur nos élus pour qu'eux aussi
obéissent à une éthique des droits de l'Homme et contribuent de cette manière au
progrès du bien commun, mais aussi nous inciter les pouvoirs publics à faire avancer le
droit international, tant du point de vue du respect des droits civils et politiques que
de celui des droits économiques, sociaux et culturels - notamment par la mise en
œuvre effective de la Cour pénale internationale.
VA : Vous constatez que la dénonciation systématique des violations des droits de
l'Homme "peut avoir pour conséquence inattendue l'assoupissement des
consciences". En somme, vous craignez que trop d'horreur ne banalise l'horreur... Les
médias doivent-ils cesser de montrer la souffrance des hommes ? Que faut-il faire alors ?
MA : La mission d'une presse libre consiste à débusquer les violations où qu'elles se
produisent. D'ailleurs, La Cour européenne des droits de l'Homme attribue à la presse un
rôle de "chien de garde de la démocratie". J'observe simplement qu'il existe
un réel décalage entre l'information et, parfois, le plaisir malsain que certains
éprouvent parfois au spectacle de l'horreur.
À mon sens, il existe deux façons de lutter pour les droits de l'Homme : dénoncer les
violations, certes, mais aussi se battre de façon positive pour bâtir un avenir
meilleur. Ce qui est gênant dans la dénonciation des violations, c'est que
l'objectivité y est impossible. Comment faire abstraction de ce que l'on est, de ses
propres convictions ? Par exemple, dans le conflit du Proche Orient, certaines
associations dénoncent les Israéliens ; d'autres associations les Palestiniens. Même
les grandes organisations internationales ne peuvent éviter la partialité.
On se pose en s'opposant... En dénonçant l'autre comme un scélérat, je pense me
grandir. Combien d'intellectuels, de gens de valeur, épousent systématiquement la cause
du plus faible même si le faible commet des actes inacceptables ? Nos jugements nous
jugent...
Malgré nos différences d'opinion, il faut continuer à dénoncer l'ensemble des
violations d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient commises et quels qu'en soient les
auteurs. La construction d'un monde plus libre se nourrit de cette pluralité. Cependant,
nos divergences de vues ne doivent pas aboutir à l'anéantissement de ceux qui ne
partagent pas nos opinions.
Contrairement à une idée très répandue, je ne crois pas que nos différences (de
couleur, culturelles, sociales...) soient à l'origine des guerres. Si on a reçu
l'éducation nécessaire, on est capable d'accepter l'autre dans ses différences. Comme
l'a écrit Jean Rostand : "Le biologique ignore le culturel(...) De tout ce que
l'homme a appris, éprouvé, ressenti au long des siècles, rien ne s'est déposé dans
son organisme, rien n'a passé dans sa bête. Rien du passé humain n'a imprégné ses
moelles.(...) Chaque génération doit refaire tout l'apprentissage. Et si, demain, la
civilisation entière était détruite, l'homme aurait tout à recommencer, il repartirait
du même point d'où il est parti voilà quelque cent ou deux cent mille ans.(...) La
civilisation de l'homme ne réside pas dans l'homme, elle est dans les bibliothèques,
dans les musées et dans les codes.". Aucun progrès humain n'étant, hélas,
génétiquement transmissible, on doit surtout compter sur l'éducation (l'école, les
universités) et la formation (professionnelle) pour travailler en profondeur. En
attendant que des partisans des droits de l'Homme soient élus à la tête de tous les
États, il faut s'armer de persévérance et poursuivre sa tâche de sensibilisation,
d'éducation et de formation, qui représentent, à mes yeux, la meilleure façon de
changer les mentalités.
(1) "Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'Homme seront
violés en quelque partie du monde." René Cassin, prix Nobel de la Paix (1968).
(2) "René Cassin, fantassin des droits de l'homme" (1979. Editions Plon).
"René Cassin, Père de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme"
(1998. Perrin).
(3) L'objectif de l'Académie Internationale des droits de l'Homme est de contribuer dans
les milieux professionnels à la mise en œuvre d'une éthique des droits de l'Homme.
(4) A paraître en 2005.
(5) René Dumont (1904-2001) citoyen engagé, agronome, pacifiste, tiers-mondiste,
écologiste.
*Marc Agi est également l'auteur de " l'Encyclopédie des libertés " (1997.
Editions Fondation de l'Arche de la Fraternité). Par ailleurs, de 1993 à 2001, il a
été directeur général de la Fondation Internationale des Droits de l'Homme, l'Arche de
la Fraternité et, de 1991 à 2002, membre de la Commission nationale consultative des
droits de l'Homme (président de la sous-commission pour l'éducation et la formation aux
droits de l'Homme) où il a notamment œuvré pour l'adoption d'une " Charte
d'éthique commune aux professions s'exerçant directement sur la personne humaine ".
Il est actuellement chargé d'un cours sur " Les éthiques professionnelles et
l'éthique des droits de l'Homme " à l'université de Nantes. Depuis quarante ans,
Marc Agi combat pour faire mieux connaître les valeurs sur lesquelles reposent les droits
de l'homme, et construire un monde un peu moins injuste, un peu plus libre, un peu plus
solidaire. Marc Agi participe également à la XIIe UNIVERSITÉ D'ÉTÉ INTERNATIONALE DE
FORMATION DE FORMATEURS en droits de l'Homme et Citoyenneté démocratique du 11 au 31
juillet 2005 au Pôle universitaire et technologique de Vichy. Biographie.
Quelques liens vers des textes fondamentaux sur les droits de l'Homme et libertés
fondamentales :
La Convention internationale des droits de l'Enfant du 20 novembre 1989
La Convention européenne des droits de l'Homme de 1950
La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948
La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Des droits de l'Homme aux droits de l'enfant
A lire également (ou à relire) dans Les Di@logues Stratégiques ou Des Idées & des
Hommes :
"L'Homme, mesure de toute chose" René Passet (juillet 02)
"Il faut créer une énergie transformatrice" Patrick Viveret (juin 02)
"Parce que le monde et les temps changent" Edgar Morin, René Passet, Joël de
Rosnay (juin 2002)
Propos recueillis par Véronique Anger, Rédactrice en Chef
anger@carpediemcommunication.com

